 |
| Rex Woods, d'après Robert Harris. Les Pères de la Confédération, 1884 |
DU
PROCESSUS DE «CANADIANISATION» DES QUÉBÉCOIS
Aujourd'hui,
1er juillet 2017, le Canada fête son cent-cinquantième
anniversaire. En fait, son anniversaire constitutionnel. D'une
Constitution qui n'en était pas vraiment une, mais seulement une loi
du Colonial Office négociée entre des provinces résiduelles de l'Amérique du Nord britannique
et sanctionnée par le Parlement britannique. Rien de comparable
avec la Constitution américaine ou les nombreuses constitutions des républiques françaises.
D'ailleurs,
le pays reste profondément marqué par cette non-constitution (qui
ne le devint réellement qu'en 1982), suite d'une entreprise d'union
des quatre provinces maritimes à Charlottetown,  à laquelle le Premier ministre du
Canada-Uni, John A. Macdonald, s'invita plutôt effronté-
à laquelle le Premier ministre du
Canada-Uni, John A. Macdonald, s'invita plutôt effronté-
 à laquelle le Premier ministre du
Canada-Uni, John A. Macdonald, s'invita plutôt effronté-
à laquelle le Premier ministre du
Canada-Uni, John A. Macdonald, s'invita plutôt effronté-
ment, pour
proposer une alliance des provinces de l'Empire britannique en
Amérique du Nord. Des quatre provinces maritimes, deux refusèrent
de s'engager immédiatement, de sorte qu'il n'y eut que quatre
provinces pour sceller le tout : Ontario, Québec,
Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse, et encore dans cette province, y avait-il un fort mouvement de séparatisme.
On
a parlé de la Confédération – puisque tel était le statut du
nouveau Dominion qui n'en restait pas moins une colonie de la
Grande-Bretagne – comme d'un pacte économique qui défiait les forces naturelles du continent. Contre ces forces qui vont du Nord au
Sud, on voulut établir un système économique Est-Ouest. Ce
protectionnisme devait d'abord servir les intérêts coloniaux de
Londres, mais aussi protéger les riches hommes d'affaires venus
faire fortune dans la colonie. Des banquiers, des industriels, des
grands commerçants, des armateurs qui trouvaient des débouchées
dans le marché américain voyaient leurs avantages menacés par la
 guerre civile de nos Voisins du Sud. De plus, après que l'Angleterre
eut appuyée tacitement le Sud après
que le vaisseau neutre, le Trent,
fut
saisi par les Nordistes avec, à bord, deux émissaires sudistes et leur
famille en route pour négocier une reconnaissance de la
Confédération des États du Sud par l'Angleterre et la France, la
sécurité de la frontière canadienne devenait incertaine. Des
députés du Nord promettaient de s'en prendre au Canada si les
armées sudistes finissaient par l'emporter.
guerre civile de nos Voisins du Sud. De plus, après que l'Angleterre
eut appuyée tacitement le Sud après
que le vaisseau neutre, le Trent,
fut
saisi par les Nordistes avec, à bord, deux émissaires sudistes et leur
famille en route pour négocier une reconnaissance de la
Confédération des États du Sud par l'Angleterre et la France, la
sécurité de la frontière canadienne devenait incertaine. Des
députés du Nord promettaient de s'en prendre au Canada si les
armées sudistes finissaient par l'emporter.
 guerre civile de nos Voisins du Sud. De plus, après que l'Angleterre
eut appuyée tacitement le Sud après
que le vaisseau neutre, le Trent,
fut
saisi par les Nordistes avec, à bord, deux émissaires sudistes et leur
famille en route pour négocier une reconnaissance de la
Confédération des États du Sud par l'Angleterre et la France, la
sécurité de la frontière canadienne devenait incertaine. Des
députés du Nord promettaient de s'en prendre au Canada si les
armées sudistes finissaient par l'emporter.
guerre civile de nos Voisins du Sud. De plus, après que l'Angleterre
eut appuyée tacitement le Sud après
que le vaisseau neutre, le Trent,
fut
saisi par les Nordistes avec, à bord, deux émissaires sudistes et leur
famille en route pour négocier une reconnaissance de la
Confédération des États du Sud par l'Angleterre et la France, la
sécurité de la frontière canadienne devenait incertaine. Des
députés du Nord promettaient de s'en prendre au Canada si les
armées sudistes finissaient par l'emporter.
Création
d'un marché artificiel et menaces d'invasion américaine sont à
l'origine du Canada. À cela s'ajoute les imperfections de l'Acte d'Union de 1840. Des parlements houleux, des
ministères bicéphales qui tombaient régulièrement; les crises
culturelles des minorités anglophones (au Québec) et francophones
(en Ontario),  entraînant, entre autres, l'incendie du Parlement de Montréal en 1848 par des Orangistes; l'immense territoire de l'Ouest qui appartenait à la
Compagnie de la Baie d'Hudson avant d'atteindre la Colombie
Britannique sur la côte du Pacifique : tous ces défis
appelaient une action politique. Le Canada est donc né d'une
réaction. Le Canada n'agit pas, à moins qu'il ne soit poussé dans ses derniers retranchements. Il réagit, c'est tout. Velléitaire, il se montre
incapable de tracer son destin sans qu'on le mette devant des
échéances vitales. Retenons quelques exemples fameux.
entraînant, entre autres, l'incendie du Parlement de Montréal en 1848 par des Orangistes; l'immense territoire de l'Ouest qui appartenait à la
Compagnie de la Baie d'Hudson avant d'atteindre la Colombie
Britannique sur la côte du Pacifique : tous ces défis
appelaient une action politique. Le Canada est donc né d'une
réaction. Le Canada n'agit pas, à moins qu'il ne soit poussé dans ses derniers retranchements. Il réagit, c'est tout. Velléitaire, il se montre
incapable de tracer son destin sans qu'on le mette devant des
échéances vitales. Retenons quelques exemples fameux.
 entraînant, entre autres, l'incendie du Parlement de Montréal en 1848 par des Orangistes; l'immense territoire de l'Ouest qui appartenait à la
Compagnie de la Baie d'Hudson avant d'atteindre la Colombie
Britannique sur la côte du Pacifique : tous ces défis
appelaient une action politique. Le Canada est donc né d'une
réaction. Le Canada n'agit pas, à moins qu'il ne soit poussé dans ses derniers retranchements. Il réagit, c'est tout. Velléitaire, il se montre
incapable de tracer son destin sans qu'on le mette devant des
échéances vitales. Retenons quelques exemples fameux.
entraînant, entre autres, l'incendie du Parlement de Montréal en 1848 par des Orangistes; l'immense territoire de l'Ouest qui appartenait à la
Compagnie de la Baie d'Hudson avant d'atteindre la Colombie
Britannique sur la côte du Pacifique : tous ces défis
appelaient une action politique. Le Canada est donc né d'une
réaction. Le Canada n'agit pas, à moins qu'il ne soit poussé dans ses derniers retranchements. Il réagit, c'est tout. Velléitaire, il se montre
incapable de tracer son destin sans qu'on le mette devant des
échéances vitales. Retenons quelques exemples fameux. Le
Canada est un pays qui n'a jamais pris son destin en main. Sa
mentalité coloniale, tant du côté anglophone que du côté
franco-
Le
Canada est un pays qui n'a jamais pris son destin en main. Sa
mentalité coloniale, tant du côté anglophone que du côté
franco-
phone, est une tare dont il ne s'est jamais départi. On le
voit, au XIXe siècle, laisser l'Angleterre décider du tracé de ses
frontières : ainsi, en 1842, lors de la négociation du traité Webster-Ashburton sur le tracé de la frontière du Nouveau-Brunswick
et du Maine. D'un côté on parla de la
capitulation d'Ashburton, de
l'autre, le gouvernement de Washington dut verser $ 150,000 de
compensation au Maine qui n'était pas du tout content. Le traité
Rush-Bagot avait fixé la frontière américaine au 49° parallèle à
partir de la pointe du Lac Supérieur jusque vers le Pacifique. Mais,
à cette époque l'Oregon s'étirait jusque vers l'Alaska,
prétendant  annexer une petite colonie espagnole située au 42° de
latitude. En 1844, au plus fort de la crise nationaliste du Manifest
Destiny, les
Américains se montrèrent agressifs envers l'Angleterre : «54°
40' ou la guerre!», criaient les plus enragés. Toutefois,
Washington et Londres préférèrent s'en remettre à l'arbitrage et
finalement, on poursuivit la ligne du 49° sans que l'île de
Vancouver soit annexée par les Américains. Cependant, la question
de l'Alaska n'était pas réglée pour autant. Elle devint épineuse à partir de 1867 lorsque les Américains l'achetèrent aux Russes. On y
découvrait des mines d'or qui semblaient s'étendre vers le Yukon.
De plus, la capitale du territoire, Juneau, s'érigeait sur une lisière
qui longeait la Colombie
annexer une petite colonie espagnole située au 42° de
latitude. En 1844, au plus fort de la crise nationaliste du Manifest
Destiny, les
Américains se montrèrent agressifs envers l'Angleterre : «54°
40' ou la guerre!», criaient les plus enragés. Toutefois,
Washington et Londres préférèrent s'en remettre à l'arbitrage et
finalement, on poursuivit la ligne du 49° sans que l'île de
Vancouver soit annexée par les Américains. Cependant, la question
de l'Alaska n'était pas réglée pour autant. Elle devint épineuse à partir de 1867 lorsque les Américains l'achetèrent aux Russes. On y
découvrait des mines d'or qui semblaient s'étendre vers le Yukon.
De plus, la capitale du territoire, Juneau, s'érigeait sur une lisière
qui longeait la Colombie  Britannique, devenue province
canadienne. Les ports situés sur cette lisière devaient-ils
appartenir au Canada ou aux États-Unis? Le Premier ministre Laurier
accepta l'arbitrage de six juristes dont deux seulement
représentaient le Canada et un troisième, l'Anglais Lord
Alverstone pour Londres. Le Président Théodore Roosevelt avait également choisi
trois négociateurs. Roosevelt, sans doute l'un des présidents les
plus impérialistes de l'histoire américaine, annonça les résultats
de la négociation avant
Britannique, devenue province
canadienne. Les ports situés sur cette lisière devaient-ils
appartenir au Canada ou aux États-Unis? Le Premier ministre Laurier
accepta l'arbitrage de six juristes dont deux seulement
représentaient le Canada et un troisième, l'Anglais Lord
Alverstone pour Londres. Le Président Théodore Roosevelt avait également choisi
trois négociateurs. Roosevelt, sans doute l'un des présidents les
plus impérialistes de l'histoire américaine, annonça les résultats
de la négociation avant  la ratification de l'entente. Alverstone en
tint compte et vota du côté des trois représen-
la ratification de l'entente. Alverstone en
tint compte et vota du côté des trois représen-
 annexer une petite colonie espagnole située au 42° de
latitude. En 1844, au plus fort de la crise nationaliste du Manifest
Destiny, les
Américains se montrèrent agressifs envers l'Angleterre : «54°
40' ou la guerre!», criaient les plus enragés. Toutefois,
Washington et Londres préférèrent s'en remettre à l'arbitrage et
finalement, on poursuivit la ligne du 49° sans que l'île de
Vancouver soit annexée par les Américains. Cependant, la question
de l'Alaska n'était pas réglée pour autant. Elle devint épineuse à partir de 1867 lorsque les Américains l'achetèrent aux Russes. On y
découvrait des mines d'or qui semblaient s'étendre vers le Yukon.
De plus, la capitale du territoire, Juneau, s'érigeait sur une lisière
qui longeait la Colombie
annexer une petite colonie espagnole située au 42° de
latitude. En 1844, au plus fort de la crise nationaliste du Manifest
Destiny, les
Américains se montrèrent agressifs envers l'Angleterre : «54°
40' ou la guerre!», criaient les plus enragés. Toutefois,
Washington et Londres préférèrent s'en remettre à l'arbitrage et
finalement, on poursuivit la ligne du 49° sans que l'île de
Vancouver soit annexée par les Américains. Cependant, la question
de l'Alaska n'était pas réglée pour autant. Elle devint épineuse à partir de 1867 lorsque les Américains l'achetèrent aux Russes. On y
découvrait des mines d'or qui semblaient s'étendre vers le Yukon.
De plus, la capitale du territoire, Juneau, s'érigeait sur une lisière
qui longeait la Colombie  Britannique, devenue province
canadienne. Les ports situés sur cette lisière devaient-ils
appartenir au Canada ou aux États-Unis? Le Premier ministre Laurier
accepta l'arbitrage de six juristes dont deux seulement
représentaient le Canada et un troisième, l'Anglais Lord
Alverstone pour Londres. Le Président Théodore Roosevelt avait également choisi
trois négociateurs. Roosevelt, sans doute l'un des présidents les
plus impérialistes de l'histoire américaine, annonça les résultats
de la négociation avant
Britannique, devenue province
canadienne. Les ports situés sur cette lisière devaient-ils
appartenir au Canada ou aux États-Unis? Le Premier ministre Laurier
accepta l'arbitrage de six juristes dont deux seulement
représentaient le Canada et un troisième, l'Anglais Lord
Alverstone pour Londres. Le Président Théodore Roosevelt avait également choisi
trois négociateurs. Roosevelt, sans doute l'un des présidents les
plus impérialistes de l'histoire américaine, annonça les résultats
de la négociation avant  la ratification de l'entente. Alverstone en
tint compte et vota du côté des trois représen-
la ratification de l'entente. Alverstone en
tint compte et vota du côté des trois représen-
tants américains,
laissant les deux repré-
sentants canadiens (un anglophone, Aylesworth
et un franco-
phone, L.-A. Jetté) sur le carreau qui refusèrent de
signer l'entente. Furieux, Laurier déclara que désormais le Canada
devrait pourvoir au règlement de ses propres affaires. Ce n'était
que des mots. On le vit bien, en 1927, lorsque l'agrandissement du
Québec par l'Ungava posa la question du Labrador, cette bande de
terre où se trouvaient
de nombreuses et puissantes forces hydrauliques que le Canada et Terre-Neuve, alors colonie directement sous la tutelle de l'Angleterre,
convoitaient. En 1926, on porta le litige devant le Conseil Privé
qui statua, l'année suivante, en faveur de Terre-Neuve qui reçut
ainsi 111,300 milles carrés sur le territoire géographique
québécois. En se faisant ainsi amputer de ce territoire, c'est tout
le Canada et non le Québec seul qui perdait ces 111,300 milles
carrés ...qu'il récupéra seulement lors de l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération (1949).
Toutes
ces frontières perdues, pourtant essentielles dans
l'affirmation d'un pays, d'une nation ou même d'une confédération
à buts économiques, montrent la tare canadienne dans sa germination.
Le Canada n'agit pas. Non seulement parce qu'il n'a pas la puissance
démographique, ou le développement technologique ou la liberté de
mouvement au niveau commercial. Il ne bouge pas parce qu'il n'a pas
de stimuli
qui
le forceraient à se doter des moyens d'action. Alors, il ne lui reste plus qu'à réagir. Il
 faut qu'un problème se pose de manière urgente pour qu'il prenne
une décision et il arrive rarement qu'il prenne la bonne décision,
soit parce que ses dirigeants ne prennent pas le temps de réfléchir
et de prévoir, soit parce qu'il se laisse entraîner par des
signatures de traités ou des conventions qui lui prescrivent de faire
ceci ou cela. Ainsi, si Laurier put laisser la volonté libre aux
Canadiens de participer aux guerres de l'Empire, sur le Nil ou en
Afrique du Sud
faut qu'un problème se pose de manière urgente pour qu'il prenne
une décision et il arrive rarement qu'il prenne la bonne décision,
soit parce que ses dirigeants ne prennent pas le temps de réfléchir
et de prévoir, soit parce qu'il se laisse entraîner par des
signatures de traités ou des conventions qui lui prescrivent de faire
ceci ou cela. Ainsi, si Laurier put laisser la volonté libre aux
Canadiens de participer aux guerres de l'Empire, sur le Nil ou en
Afrique du Sud  à la fin du XIXe siècle, Borden et Laurier, dans une
union
sacrée pour la défense de l'Angleterre, engagèrent
automatiquement le Canada dans la guerre contre les Puissances centrales en
1914. Lorsque après les hécatombes de 1915-1916, on s'aperçut que
le volontariat ne suffisait pas, on procéda alors à la
conscription, ce qui réveilla les consciences puisque les intérêts
canadiens avaient peu à tirer de cette guerre européenne. Le vote
de cette conscription souleva colère et résistance, au Québec sans
doute, où il y eut des morts à la Pâques 1918 à Québec, mais
aussi dans le Canada anglophone. De toutes façons, la guerre tirait
pratiquement à sa fin avec l'entrée des États-Unis dans le conflit
et l'épuisement de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. La même
gaffe, mais pimenté d'un cynisme honteux, se répéta en 1942. King entra dans la Seconde Guerre
mondiale comme Borden dans la Première. Lui,
à la fin du XIXe siècle, Borden et Laurier, dans une
union
sacrée pour la défense de l'Angleterre, engagèrent
automatiquement le Canada dans la guerre contre les Puissances centrales en
1914. Lorsque après les hécatombes de 1915-1916, on s'aperçut que
le volontariat ne suffisait pas, on procéda alors à la
conscription, ce qui réveilla les consciences puisque les intérêts
canadiens avaient peu à tirer de cette guerre européenne. Le vote
de cette conscription souleva colère et résistance, au Québec sans
doute, où il y eut des morts à la Pâques 1918 à Québec, mais
aussi dans le Canada anglophone. De toutes façons, la guerre tirait
pratiquement à sa fin avec l'entrée des États-Unis dans le conflit
et l'épuisement de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. La même
gaffe, mais pimenté d'un cynisme honteux, se répéta en 1942. King entra dans la Seconde Guerre
mondiale comme Borden dans la Première. Lui,  qui avait rencontré
person-nellement le Fuhrer Adolf Hitler et l'avait trouvé bon garçon, suivit la parade des États du Common-wealth en
septembre 1939. En 1942, le désastre de Dieppe refroidit les ardeurs
canadiennes. King recourut à la même solution que son prédécesseur
et proposa la conscription, mais en forçant l'ingurgitation de la pilule par un référendum pan-canadien. Manière d'opposer les deux Canadas pour faire passer sa décision unilatérale. Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, il y eut belle résistance parmi les Canadiens français. Le
maire de Montréal, l'impétueux Camilien Houde, fut arrêté selon la
loi et conduit à Petawawa sous haute surveillance. Des déserteurs
furent poursuivis, l'un même fut tué par la police militaire.
L'Angleterre envoyait ses prisonniers de guerre au Canada et, à
l'exemple des États-Unis, le gouvernement fédéral érigea des
prisons pour y détenir des membres civils de la communauté japonaise sur
la côte ouest ou des Allemands et des Italiens militants pour l'Axe.
qui avait rencontré
person-nellement le Fuhrer Adolf Hitler et l'avait trouvé bon garçon, suivit la parade des États du Common-wealth en
septembre 1939. En 1942, le désastre de Dieppe refroidit les ardeurs
canadiennes. King recourut à la même solution que son prédécesseur
et proposa la conscription, mais en forçant l'ingurgitation de la pilule par un référendum pan-canadien. Manière d'opposer les deux Canadas pour faire passer sa décision unilatérale. Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, il y eut belle résistance parmi les Canadiens français. Le
maire de Montréal, l'impétueux Camilien Houde, fut arrêté selon la
loi et conduit à Petawawa sous haute surveillance. Des déserteurs
furent poursuivis, l'un même fut tué par la police militaire.
L'Angleterre envoyait ses prisonniers de guerre au Canada et, à
l'exemple des États-Unis, le gouvernement fédéral érigea des
prisons pour y détenir des membres civils de la communauté japonaise sur
la côte ouest ou des Allemands et des Italiens militants pour l'Axe.
 faut qu'un problème se pose de manière urgente pour qu'il prenne
une décision et il arrive rarement qu'il prenne la bonne décision,
soit parce que ses dirigeants ne prennent pas le temps de réfléchir
et de prévoir, soit parce qu'il se laisse entraîner par des
signatures de traités ou des conventions qui lui prescrivent de faire
ceci ou cela. Ainsi, si Laurier put laisser la volonté libre aux
Canadiens de participer aux guerres de l'Empire, sur le Nil ou en
Afrique du Sud
faut qu'un problème se pose de manière urgente pour qu'il prenne
une décision et il arrive rarement qu'il prenne la bonne décision,
soit parce que ses dirigeants ne prennent pas le temps de réfléchir
et de prévoir, soit parce qu'il se laisse entraîner par des
signatures de traités ou des conventions qui lui prescrivent de faire
ceci ou cela. Ainsi, si Laurier put laisser la volonté libre aux
Canadiens de participer aux guerres de l'Empire, sur le Nil ou en
Afrique du Sud  à la fin du XIXe siècle, Borden et Laurier, dans une
union
sacrée pour la défense de l'Angleterre, engagèrent
automatiquement le Canada dans la guerre contre les Puissances centrales en
1914. Lorsque après les hécatombes de 1915-1916, on s'aperçut que
le volontariat ne suffisait pas, on procéda alors à la
conscription, ce qui réveilla les consciences puisque les intérêts
canadiens avaient peu à tirer de cette guerre européenne. Le vote
de cette conscription souleva colère et résistance, au Québec sans
doute, où il y eut des morts à la Pâques 1918 à Québec, mais
aussi dans le Canada anglophone. De toutes façons, la guerre tirait
pratiquement à sa fin avec l'entrée des États-Unis dans le conflit
et l'épuisement de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. La même
gaffe, mais pimenté d'un cynisme honteux, se répéta en 1942. King entra dans la Seconde Guerre
mondiale comme Borden dans la Première. Lui,
à la fin du XIXe siècle, Borden et Laurier, dans une
union
sacrée pour la défense de l'Angleterre, engagèrent
automatiquement le Canada dans la guerre contre les Puissances centrales en
1914. Lorsque après les hécatombes de 1915-1916, on s'aperçut que
le volontariat ne suffisait pas, on procéda alors à la
conscription, ce qui réveilla les consciences puisque les intérêts
canadiens avaient peu à tirer de cette guerre européenne. Le vote
de cette conscription souleva colère et résistance, au Québec sans
doute, où il y eut des morts à la Pâques 1918 à Québec, mais
aussi dans le Canada anglophone. De toutes façons, la guerre tirait
pratiquement à sa fin avec l'entrée des États-Unis dans le conflit
et l'épuisement de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. La même
gaffe, mais pimenté d'un cynisme honteux, se répéta en 1942. King entra dans la Seconde Guerre
mondiale comme Borden dans la Première. Lui,  qui avait rencontré
person-nellement le Fuhrer Adolf Hitler et l'avait trouvé bon garçon, suivit la parade des États du Common-wealth en
septembre 1939. En 1942, le désastre de Dieppe refroidit les ardeurs
canadiennes. King recourut à la même solution que son prédécesseur
et proposa la conscription, mais en forçant l'ingurgitation de la pilule par un référendum pan-canadien. Manière d'opposer les deux Canadas pour faire passer sa décision unilatérale. Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, il y eut belle résistance parmi les Canadiens français. Le
maire de Montréal, l'impétueux Camilien Houde, fut arrêté selon la
loi et conduit à Petawawa sous haute surveillance. Des déserteurs
furent poursuivis, l'un même fut tué par la police militaire.
L'Angleterre envoyait ses prisonniers de guerre au Canada et, à
l'exemple des États-Unis, le gouvernement fédéral érigea des
prisons pour y détenir des membres civils de la communauté japonaise sur
la côte ouest ou des Allemands et des Italiens militants pour l'Axe.
qui avait rencontré
person-nellement le Fuhrer Adolf Hitler et l'avait trouvé bon garçon, suivit la parade des États du Common-wealth en
septembre 1939. En 1942, le désastre de Dieppe refroidit les ardeurs
canadiennes. King recourut à la même solution que son prédécesseur
et proposa la conscription, mais en forçant l'ingurgitation de la pilule par un référendum pan-canadien. Manière d'opposer les deux Canadas pour faire passer sa décision unilatérale. Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, il y eut belle résistance parmi les Canadiens français. Le
maire de Montréal, l'impétueux Camilien Houde, fut arrêté selon la
loi et conduit à Petawawa sous haute surveillance. Des déserteurs
furent poursuivis, l'un même fut tué par la police militaire.
L'Angleterre envoyait ses prisonniers de guerre au Canada et, à
l'exemple des États-Unis, le gouvernement fédéral érigea des
prisons pour y détenir des membres civils de la communauté japonaise sur
la côte ouest ou des Allemands et des Italiens militants pour l'Axe.
Dans l'état obsidional du glacis nord-américain, la
Guerre Froide fit passer la dépendance de l'Angleterre aux
États-Unis. Au début des années 50, le génie militaire canadien avait développé
un avion  intercepteur, l'Avro CF-105 Arrow. Cet avion atteignait des vitesses records. Au début, le coût de
chaque appareil était estimé entre $ 2 et 4 millions de dollars,
puis, lorsque l'Aviation royale du Canada pris le projet en main,
l'estimation passa à $ 12,500,000. Le 20 février 1959, le
Premier ministre Diefenbaker annonça l'annulation du projet Arrow
sous le prétexte qu'il était trop coûteux et ne répondait
plus aux exigences depuis l'apparition des missiles
intercontinentaux. Il était préférable de confier la
intercepteur, l'Avro CF-105 Arrow. Cet avion atteignait des vitesses records. Au début, le coût de
chaque appareil était estimé entre $ 2 et 4 millions de dollars,
puis, lorsque l'Aviation royale du Canada pris le projet en main,
l'estimation passa à $ 12,500,000. Le 20 février 1959, le
Premier ministre Diefenbaker annonça l'annulation du projet Arrow
sous le prétexte qu'il était trop coûteux et ne répondait
plus aux exigences depuis l'apparition des missiles
intercontinentaux. Il était préférable de confier la  défense aux
missiles sol-air BOMARC américains, efficaces à la fois contre les
bombardiers et les missiles, mais utile que s'il était porteur d'une
tête nucléaire. Dans l'ensemble, ces super-avions intercepteurs
appartenaient au passé puisqu'on entrait dans l'ère des missiles
guidés. Mais l'annulation de l'Arrow
coïncidait avec la construction de la ligne DEW, (Distant Early Warning Line) cette ligne de
surveillance établie à la circonférence du cercle polaire. Le
Canada avait déjà financé deux lignes de protection radar, la
ligne Pinetree, de Terre-Neuve à l'île de Vancouver, puis la ligne
Mid-Canada, plus au nord, du haut-Labrador jusqu'à la Colombie
Britannique. Devenues obsolètes par le développement technologique
soviétique, les deux pays
défense aux
missiles sol-air BOMARC américains, efficaces à la fois contre les
bombardiers et les missiles, mais utile que s'il était porteur d'une
tête nucléaire. Dans l'ensemble, ces super-avions intercepteurs
appartenaient au passé puisqu'on entrait dans l'ère des missiles
guidés. Mais l'annulation de l'Arrow
coïncidait avec la construction de la ligne DEW, (Distant Early Warning Line) cette ligne de
surveillance établie à la circonférence du cercle polaire. Le
Canada avait déjà financé deux lignes de protection radar, la
ligne Pinetree, de Terre-Neuve à l'île de Vancouver, puis la ligne
Mid-Canada, plus au nord, du haut-Labrador jusqu'à la Colombie
Britannique. Devenues obsolètes par le développement technologique
soviétique, les deux pays  s'entendirent, le 15 février 1954, pour
ériger une troisième ligne, cette fois-ci dans l'Arctique, le long
du 69° parallèle, à 300 kilomètres au nord du cercle Arctique.
Devant les hésitations du Canada, les États-Unis acceptèrent de
payer le coût de la ligne tout en utilisant de la main-d'œuvre
canadienne. La majorité des stations canadiennes seraient sous la
responsabilité de l'aviation royale du Canada alors que d'autres
seraient gérées conjointement avec l'United States Air Force.
Pourtant, le gouvernement canadien continuait toujours de ne voir
aucune
s'entendirent, le 15 février 1954, pour
ériger une troisième ligne, cette fois-ci dans l'Arctique, le long
du 69° parallèle, à 300 kilomètres au nord du cercle Arctique.
Devant les hésitations du Canada, les États-Unis acceptèrent de
payer le coût de la ligne tout en utilisant de la main-d'œuvre
canadienne. La majorité des stations canadiennes seraient sous la
responsabilité de l'aviation royale du Canada alors que d'autres
seraient gérées conjointement avec l'United States Air Force.
Pourtant, le gouvernement canadien continuait toujours de ne voir
aucune  valeur intrinsèque dans le projet, mais il s'inquiéta
rapidement de l'amé-
valeur intrinsèque dans le projet, mais il s'inquiéta
rapidement de l'amé-
 intercepteur, l'Avro CF-105 Arrow. Cet avion atteignait des vitesses records. Au début, le coût de
chaque appareil était estimé entre $ 2 et 4 millions de dollars,
puis, lorsque l'Aviation royale du Canada pris le projet en main,
l'estimation passa à $ 12,500,000. Le 20 février 1959, le
Premier ministre Diefenbaker annonça l'annulation du projet Arrow
sous le prétexte qu'il était trop coûteux et ne répondait
plus aux exigences depuis l'apparition des missiles
intercontinentaux. Il était préférable de confier la
intercepteur, l'Avro CF-105 Arrow. Cet avion atteignait des vitesses records. Au début, le coût de
chaque appareil était estimé entre $ 2 et 4 millions de dollars,
puis, lorsque l'Aviation royale du Canada pris le projet en main,
l'estimation passa à $ 12,500,000. Le 20 février 1959, le
Premier ministre Diefenbaker annonça l'annulation du projet Arrow
sous le prétexte qu'il était trop coûteux et ne répondait
plus aux exigences depuis l'apparition des missiles
intercontinentaux. Il était préférable de confier la  défense aux
missiles sol-air BOMARC américains, efficaces à la fois contre les
bombardiers et les missiles, mais utile que s'il était porteur d'une
tête nucléaire. Dans l'ensemble, ces super-avions intercepteurs
appartenaient au passé puisqu'on entrait dans l'ère des missiles
guidés. Mais l'annulation de l'Arrow
coïncidait avec la construction de la ligne DEW, (Distant Early Warning Line) cette ligne de
surveillance établie à la circonférence du cercle polaire. Le
Canada avait déjà financé deux lignes de protection radar, la
ligne Pinetree, de Terre-Neuve à l'île de Vancouver, puis la ligne
Mid-Canada, plus au nord, du haut-Labrador jusqu'à la Colombie
Britannique. Devenues obsolètes par le développement technologique
soviétique, les deux pays
défense aux
missiles sol-air BOMARC américains, efficaces à la fois contre les
bombardiers et les missiles, mais utile que s'il était porteur d'une
tête nucléaire. Dans l'ensemble, ces super-avions intercepteurs
appartenaient au passé puisqu'on entrait dans l'ère des missiles
guidés. Mais l'annulation de l'Arrow
coïncidait avec la construction de la ligne DEW, (Distant Early Warning Line) cette ligne de
surveillance établie à la circonférence du cercle polaire. Le
Canada avait déjà financé deux lignes de protection radar, la
ligne Pinetree, de Terre-Neuve à l'île de Vancouver, puis la ligne
Mid-Canada, plus au nord, du haut-Labrador jusqu'à la Colombie
Britannique. Devenues obsolètes par le développement technologique
soviétique, les deux pays  s'entendirent, le 15 février 1954, pour
ériger une troisième ligne, cette fois-ci dans l'Arctique, le long
du 69° parallèle, à 300 kilomètres au nord du cercle Arctique.
Devant les hésitations du Canada, les États-Unis acceptèrent de
payer le coût de la ligne tout en utilisant de la main-d'œuvre
canadienne. La majorité des stations canadiennes seraient sous la
responsabilité de l'aviation royale du Canada alors que d'autres
seraient gérées conjointement avec l'United States Air Force.
Pourtant, le gouvernement canadien continuait toujours de ne voir
aucune
s'entendirent, le 15 février 1954, pour
ériger une troisième ligne, cette fois-ci dans l'Arctique, le long
du 69° parallèle, à 300 kilomètres au nord du cercle Arctique.
Devant les hésitations du Canada, les États-Unis acceptèrent de
payer le coût de la ligne tout en utilisant de la main-d'œuvre
canadienne. La majorité des stations canadiennes seraient sous la
responsabilité de l'aviation royale du Canada alors que d'autres
seraient gérées conjointement avec l'United States Air Force.
Pourtant, le gouvernement canadien continuait toujours de ne voir
aucune  valeur intrinsèque dans le projet, mais il s'inquiéta
rapidement de l'amé-
valeur intrinsèque dans le projet, mais il s'inquiéta
rapidement de l'amé-
ricanisation du nord et le passage des militaires
américains dans le cercle arctique éveilla des insécurités. Le
gouvernement chargea donc la G.R.C. et les forces canadiennes de se
montrer plus présentes à travers un programme de «défense active»
qui consistait à minimiser la présence des Américains dans
l'Arctique canadien, d'augmenter l'influence du gouvernement dans le
projet de la ligne DEW et la pleine participation du Canada dans la
défense de l'Arctique. Ce que nous dit tout ceci, c'est que le
Canada, prompt à se laisser engager dans des interventions
internationales, se montre incapable de veiller sur son propre
territoire. Plutôt qu'une défense
active, il
pratique une agressivité
passive. (On a vu ce que donnait  cette stratégie en Bosnie, dans les années 1990, lorsque le casque bleu canadien, Patrick Rechner, fut tenu en otage, et même ligoté à un poteau par les Serbes contre d'éventuels bombardements de l'OTAN; l'impuissance du détachement conduit par le général Roméo Dallaire devant le génocide rwandais proviendrait, elle aussi, de cette agressivité passive stérile). Bref, le Canada
paie avec l'argent des contribuables son effort pratique, laissant aux entreprises
privées le soin de perfectionner le développement technique tout en
légiférant, une législation qui peut très bien aller en faveur de
l'engagement (financer le projet Arrow, contribuer comme porteur
d'eau à
l'érection de la ligne DEW) que du désengagement et de la mise à
mort des projets (le retrait de Diefenbaker en 1959, le refus de
financer la ligne DEW tout en «profitant des retombées»). On pourrait sans doute trouver de multiples autres
exemples – grands ou petits – qui alimenteraient la discussion.
cette stratégie en Bosnie, dans les années 1990, lorsque le casque bleu canadien, Patrick Rechner, fut tenu en otage, et même ligoté à un poteau par les Serbes contre d'éventuels bombardements de l'OTAN; l'impuissance du détachement conduit par le général Roméo Dallaire devant le génocide rwandais proviendrait, elle aussi, de cette agressivité passive stérile). Bref, le Canada
paie avec l'argent des contribuables son effort pratique, laissant aux entreprises
privées le soin de perfectionner le développement technique tout en
légiférant, une législation qui peut très bien aller en faveur de
l'engagement (financer le projet Arrow, contribuer comme porteur
d'eau à
l'érection de la ligne DEW) que du désengagement et de la mise à
mort des projets (le retrait de Diefenbaker en 1959, le refus de
financer la ligne DEW tout en «profitant des retombées»). On pourrait sans doute trouver de multiples autres
exemples – grands ou petits – qui alimenteraient la discussion.
 cette stratégie en Bosnie, dans les années 1990, lorsque le casque bleu canadien, Patrick Rechner, fut tenu en otage, et même ligoté à un poteau par les Serbes contre d'éventuels bombardements de l'OTAN; l'impuissance du détachement conduit par le général Roméo Dallaire devant le génocide rwandais proviendrait, elle aussi, de cette agressivité passive stérile). Bref, le Canada
paie avec l'argent des contribuables son effort pratique, laissant aux entreprises
privées le soin de perfectionner le développement technique tout en
légiférant, une législation qui peut très bien aller en faveur de
l'engagement (financer le projet Arrow, contribuer comme porteur
d'eau à
l'érection de la ligne DEW) que du désengagement et de la mise à
mort des projets (le retrait de Diefenbaker en 1959, le refus de
financer la ligne DEW tout en «profitant des retombées»). On pourrait sans doute trouver de multiples autres
exemples – grands ou petits – qui alimenteraient la discussion.
cette stratégie en Bosnie, dans les années 1990, lorsque le casque bleu canadien, Patrick Rechner, fut tenu en otage, et même ligoté à un poteau par les Serbes contre d'éventuels bombardements de l'OTAN; l'impuissance du détachement conduit par le général Roméo Dallaire devant le génocide rwandais proviendrait, elle aussi, de cette agressivité passive stérile). Bref, le Canada
paie avec l'argent des contribuables son effort pratique, laissant aux entreprises
privées le soin de perfectionner le développement technique tout en
légiférant, une législation qui peut très bien aller en faveur de
l'engagement (financer le projet Arrow, contribuer comme porteur
d'eau à
l'érection de la ligne DEW) que du désengagement et de la mise à
mort des projets (le retrait de Diefenbaker en 1959, le refus de
financer la ligne DEW tout en «profitant des retombées»). On pourrait sans doute trouver de multiples autres
exemples – grands ou petits – qui alimenteraient la discussion.
Ce
que cela nous dit, au niveau de la psychologie collective canadienne,
c'est le côté anhistorique de ce pays. C'est un pays qui laisse
les autres battre la mesure de son destin. S'il est maître de son
gouvernement, son État est toujours représenté par une reine
étrangère qui a été nationalisée avec la Constitution de 1982.
La  reine Elizabeth du Canada – dont on ne sait pas si on doit
l'appeler Elizabeth II d'Angleterre ou Elizabeth Ière du Canada,
chose à laquelle on ne semble pas avoir songé jusqu'à présent -, envers qui, comme nous l'a enseignée la vieille tradition des colonies britanniques, qui
forment aujourd'hui les États-Unis, nous prêtons allégeance sans jamais nous assujettir (enseignement transmis par
les Loyalistes en fuite en 1774), fait d'une démocratie américaine
un heureux mariage avec la monarchie constitutionnelle. La
Constitution de 1982 est ainsi remplie de symboles archaïques et
anachroniques (Dieu, la Reine, le Sénat, les protocoles
parlementaires, le gentilhomme huissier à la verge noire (à
l'Assemblée nationale du Québec comme aux Communes à Ottawa) qui
sont des exhibits baroques qui ne disent plus rien au commun des
mortels sinon qu'un rite folklorique pour touristes.
reine Elizabeth du Canada – dont on ne sait pas si on doit
l'appeler Elizabeth II d'Angleterre ou Elizabeth Ière du Canada,
chose à laquelle on ne semble pas avoir songé jusqu'à présent -, envers qui, comme nous l'a enseignée la vieille tradition des colonies britanniques, qui
forment aujourd'hui les États-Unis, nous prêtons allégeance sans jamais nous assujettir (enseignement transmis par
les Loyalistes en fuite en 1774), fait d'une démocratie américaine
un heureux mariage avec la monarchie constitutionnelle. La
Constitution de 1982 est ainsi remplie de symboles archaïques et
anachroniques (Dieu, la Reine, le Sénat, les protocoles
parlementaires, le gentilhomme huissier à la verge noire (à
l'Assemblée nationale du Québec comme aux Communes à Ottawa) qui
sont des exhibits baroques qui ne disent plus rien au commun des
mortels sinon qu'un rite folklorique pour touristes.
 reine Elizabeth du Canada – dont on ne sait pas si on doit
l'appeler Elizabeth II d'Angleterre ou Elizabeth Ière du Canada,
chose à laquelle on ne semble pas avoir songé jusqu'à présent -, envers qui, comme nous l'a enseignée la vieille tradition des colonies britanniques, qui
forment aujourd'hui les États-Unis, nous prêtons allégeance sans jamais nous assujettir (enseignement transmis par
les Loyalistes en fuite en 1774), fait d'une démocratie américaine
un heureux mariage avec la monarchie constitutionnelle. La
Constitution de 1982 est ainsi remplie de symboles archaïques et
anachroniques (Dieu, la Reine, le Sénat, les protocoles
parlementaires, le gentilhomme huissier à la verge noire (à
l'Assemblée nationale du Québec comme aux Communes à Ottawa) qui
sont des exhibits baroques qui ne disent plus rien au commun des
mortels sinon qu'un rite folklorique pour touristes.
reine Elizabeth du Canada – dont on ne sait pas si on doit
l'appeler Elizabeth II d'Angleterre ou Elizabeth Ière du Canada,
chose à laquelle on ne semble pas avoir songé jusqu'à présent -, envers qui, comme nous l'a enseignée la vieille tradition des colonies britanniques, qui
forment aujourd'hui les États-Unis, nous prêtons allégeance sans jamais nous assujettir (enseignement transmis par
les Loyalistes en fuite en 1774), fait d'une démocratie américaine
un heureux mariage avec la monarchie constitutionnelle. La
Constitution de 1982 est ainsi remplie de symboles archaïques et
anachroniques (Dieu, la Reine, le Sénat, les protocoles
parlementaires, le gentilhomme huissier à la verge noire (à
l'Assemblée nationale du Québec comme aux Communes à Ottawa) qui
sont des exhibits baroques qui ne disent plus rien au commun des
mortels sinon qu'un rite folklorique pour touristes.
Il
en va ainsi du nouveau billet de $10.00 émis par l'Hôtel de la
Monnaie pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération
 canadienne. Depuis une quarantaine d'année, on y voyait la figure du premier Premier ministre du Canada, John A. Macdonald. On sait, depuis la Haute Antiquité, que le profil ou les
emblèmes figurant sur une pièce de monnaie ont pour but d'agir
comme propagande pour le Roi, l'Empereur, le Pape, bref pour l'État. Incalculables sont
les billets émis dans les différents pays du Commonwealth
britannique avec le profil ou le visage de la reine Elizabeth. George Washington, sur le billet de un dollar américain, ou Lincoln, ou
Jackson ou Benjamin Franklin agissent de même
canadienne. Depuis une quarantaine d'année, on y voyait la figure du premier Premier ministre du Canada, John A. Macdonald. On sait, depuis la Haute Antiquité, que le profil ou les
emblèmes figurant sur une pièce de monnaie ont pour but d'agir
comme propagande pour le Roi, l'Empereur, le Pape, bref pour l'État. Incalculables sont
les billets émis dans les différents pays du Commonwealth
britannique avec le profil ou le visage de la reine Elizabeth. George Washington, sur le billet de un dollar américain, ou Lincoln, ou
Jackson ou Benjamin Franklin agissent de même  avec les symboles
maçon-
avec les symboles
maçon-
 canadienne. Depuis une quarantaine d'année, on y voyait la figure du premier Premier ministre du Canada, John A. Macdonald. On sait, depuis la Haute Antiquité, que le profil ou les
emblèmes figurant sur une pièce de monnaie ont pour but d'agir
comme propagande pour le Roi, l'Empereur, le Pape, bref pour l'État. Incalculables sont
les billets émis dans les différents pays du Commonwealth
britannique avec le profil ou le visage de la reine Elizabeth. George Washington, sur le billet de un dollar américain, ou Lincoln, ou
Jackson ou Benjamin Franklin agissent de même
canadienne. Depuis une quarantaine d'année, on y voyait la figure du premier Premier ministre du Canada, John A. Macdonald. On sait, depuis la Haute Antiquité, que le profil ou les
emblèmes figurant sur une pièce de monnaie ont pour but d'agir
comme propagande pour le Roi, l'Empereur, le Pape, bref pour l'État. Incalculables sont
les billets émis dans les différents pays du Commonwealth
britannique avec le profil ou le visage de la reine Elizabeth. George Washington, sur le billet de un dollar américain, ou Lincoln, ou
Jackson ou Benjamin Franklin agissent de même  avec les symboles
maçon-
avec les symboles
maçon-
niques, le In
God We Trust et
l'aigle royal à tête blanche. Mais, en général, on ne met qu'un
visage, car ce visage ramène à lui l'unité de la nation. Au niveau de
l'Imaginaire collectif, il est un des nombreux symboles qui porte le
sens de l'unité de
la collectivité. Une nation se dit une
et indivisible par
ce visage. Que les Francs français aient eu Blaise Pascal, Berlioz,
Saint-Exupéry ou Montesquieu, ce n'était, là encore, qu'hommages
rendus à la culture nationale en évitant de prendre des
personnalités trop contestées.
Or,
ce nouveau billet de $10.00 nous dit beaucoup sur le sens
de l'unité canadienne,
et surtout son Imaginaire historique. Sur le billet mauve qui portait
jusqu'à ce jour le visage de John A. Macdonald, l'artisan rusé de
la Confédération de 1867, voici qu'on l'entoure de trois autres
personnages. George E. Cartier, qui fut son acolyte québécois dans
le processus de la Confédération (après la touche anglo avec
Macdonald, la touche franco avec Cartier), Agnes Macphail – Nounou
Mcphee? -, militante des droits de la personne et première femme
élue – non sans difficultés – à la Chambre des Communes en
1921, symbole féminin/iste et James Gladstone de son vrai nom
Akay-na-muka, membre de la tribu kainai (Gens-du-Sang) apparentée
aux Pieds-Noirs et devenu premier sénateur canadien issu des
Premières Nations, pour satisfaire la vanité autochtone. L'historicité
canadienne-anglaise se révèle impudiquement dans ce quatuor à dix.
Je
rapellerai rapidement ce que j'ai dit ailleurs - il y a 25 ans -, sur l'historicité
canadienne-anglaise
(http://jeanpaulcoupal.blogspot.ca/2010/10/jeu-de-cartes-canadiennes-wicked-game.html).
En juillet 1992, l'organisme Société Canada 125e, en vue de fêter
le cent-vingt-cinquième anniversaire du Canada, avait publié une
carte géo-historique en deux versions, l'une française pour les
résidents du Québec essentiellement, et une anglaise pour le reste
du Canada. La carte française était intitulée Ton histoire est une épopée (vers
de 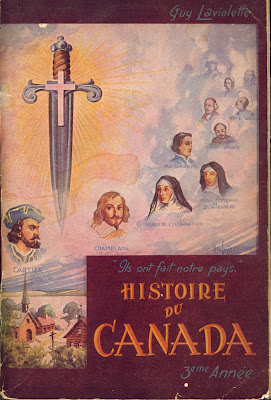 l'hymne national Ô Canada) tandis qu'en anglais le titre était The
Map of Canadian Legends. La
carte des légendes canadiennes : «Canada, Ton histoire est une
épopée :
le genre littéraire épique est associé à l’expérience vécue,
il opère une certaine déréalisation de ce vécu au nom d’une
évocation édifiante (comme si l’histoire de la Grèce ancienne
s’identifiait à la seule
Iliade ou
l’histoire romaine à L’Énéïde).
La phrase est bien sûr tirée de l’hymne national du Canada par
Basile Routhier. Elle contient une charge affective positive et
suggère l’entreprise-en-construction qu’est le Canada, toujours
à réaliser en fonction de cette épopée. Le Canada n’est pas un
pays, c’est un idéal projeté dans les temps futurs et auquel nous
sommes liés par le passé accompli en commun».
Au contraire, «The Map of Canadian Legends
: l’aspect pragmatique ressort ici du titre. Il n’est plus
question de genre littéraire épique ni d’un idéal projeté dans
l’avenir. Il ne s’agit que d’une carte. La charge affective
porte sur
l'hymne national Ô Canada) tandis qu'en anglais le titre était The
Map of Canadian Legends. La
carte des légendes canadiennes : «Canada, Ton histoire est une
épopée :
le genre littéraire épique est associé à l’expérience vécue,
il opère une certaine déréalisation de ce vécu au nom d’une
évocation édifiante (comme si l’histoire de la Grèce ancienne
s’identifiait à la seule
Iliade ou
l’histoire romaine à L’Énéïde).
La phrase est bien sûr tirée de l’hymne national du Canada par
Basile Routhier. Elle contient une charge affective positive et
suggère l’entreprise-en-construction qu’est le Canada, toujours
à réaliser en fonction de cette épopée. Le Canada n’est pas un
pays, c’est un idéal projeté dans les temps futurs et auquel nous
sommes liés par le passé accompli en commun».
Au contraire, «The Map of Canadian Legends
: l’aspect pragmatique ressort ici du titre. Il n’est plus
question de genre littéraire épique ni d’un idéal projeté dans
l’avenir. Il ne s’agit que d’une carte. La charge affective
porte sur  le mot
«Legends» qui
peut être lu comme la simple illustration de la cartographie, ou
encore comme des
«légendes» de
l’histoire canadienne. Ici aussi nous pouvons associer un aspect de
déréalisation dans la façon de présenter l’histoire canadienne
d’après une suite de «légendes»
remarquables
sans pour autant les associer à
une
entreprise épique. On peut aussi bien supposer que les «légendes»
sont des contes collectifs et héroïques du temps passé. Là où le
titre français évoquait une aspiration à la fierté collective, le
titre anglais suggère à peine un merveilleux légendaire de figures
héroïques».
Dans un cas comme dans l'autre, nous ne sommes pas placés au niveau
tant de la connaissance historique que du mythistoire.
La carte des légendes
anglophones
où revenait souvent les expressions «le premier...» ou «la
première...» revient dans la présentation du nouveau billet de $
10.00 – le premier Premier ministre; la première femme élue; le
premier autochtone sénateur -. ce narcissisme puérile appartient à
l'historicité canadienne-anglaise qui tend à déréaliser
l'Histoire pour une mythologie non pas constituée en un récit
unique, comme dans l'Antiquité, mais qui voudrait que le récit de
l'histoire canadienne corresponde à cette addition de «premiers»
en tous genres. «Car
la déréalisation du narcissisme chauvin réside bien dans cette
recherche de «héros de légendes» à notre taille mais que l’on
voudrait à la hauteur des
le mot
«Legends» qui
peut être lu comme la simple illustration de la cartographie, ou
encore comme des
«légendes» de
l’histoire canadienne. Ici aussi nous pouvons associer un aspect de
déréalisation dans la façon de présenter l’histoire canadienne
d’après une suite de «légendes»
remarquables
sans pour autant les associer à
une
entreprise épique. On peut aussi bien supposer que les «légendes»
sont des contes collectifs et héroïques du temps passé. Là où le
titre français évoquait une aspiration à la fierté collective, le
titre anglais suggère à peine un merveilleux légendaire de figures
héroïques».
Dans un cas comme dans l'autre, nous ne sommes pas placés au niveau
tant de la connaissance historique que du mythistoire.
La carte des légendes
anglophones
où revenait souvent les expressions «le premier...» ou «la
première...» revient dans la présentation du nouveau billet de $
10.00 – le premier Premier ministre; la première femme élue; le
premier autochtone sénateur -. ce narcissisme puérile appartient à
l'historicité canadienne-anglaise qui tend à déréaliser
l'Histoire pour une mythologie non pas constituée en un récit
unique, comme dans l'Antiquité, mais qui voudrait que le récit de
l'histoire canadienne corresponde à cette addition de «premiers»
en tous genres. «Car
la déréalisation du narcissisme chauvin réside bien dans cette
recherche de «héros de légendes» à notre taille mais que l’on
voudrait à la hauteur des  héros que l’on envie. Il s’agit moins
d’un délire de jalousie que d’une certaine névrose collective
où le Moi idéal rencontre, dans un combat décevant, l’Idéal du
Moi»
Cet
Idéal
du Moi, c'est
le modèle américain. Celui du narcissisme réussit, de
l'agressivité sans complexes, de la domination totale du continent. Americæ non Canada.
Son histoire aussi est une épopée, depuis les mythistoires de Pocahontas et du Convenant du Mayflower, à la
chevauchée de Paul Revere puis à la traversée de la Delaware, l'Alamo, Gettysburg, la Conquête de l'Ouest, les grandes villes qui sortent des déserts et les
richesses inépuisables gavant les fils de l'abondance. Ces figures sur les billets américains
pourraient être ressenties comme autant de camouflets à la vanité
canadienne qui n'ont qu'une maigre guerre sans vainqueur (celle de
1812) à présenter devant le Voisin hautain.
héros que l’on envie. Il s’agit moins
d’un délire de jalousie que d’une certaine névrose collective
où le Moi idéal rencontre, dans un combat décevant, l’Idéal du
Moi»
Cet
Idéal
du Moi, c'est
le modèle américain. Celui du narcissisme réussit, de
l'agressivité sans complexes, de la domination totale du continent. Americæ non Canada.
Son histoire aussi est une épopée, depuis les mythistoires de Pocahontas et du Convenant du Mayflower, à la
chevauchée de Paul Revere puis à la traversée de la Delaware, l'Alamo, Gettysburg, la Conquête de l'Ouest, les grandes villes qui sortent des déserts et les
richesses inépuisables gavant les fils de l'abondance. Ces figures sur les billets américains
pourraient être ressenties comme autant de camouflets à la vanité
canadienne qui n'ont qu'une maigre guerre sans vainqueur (celle de
1812) à présenter devant le Voisin hautain.
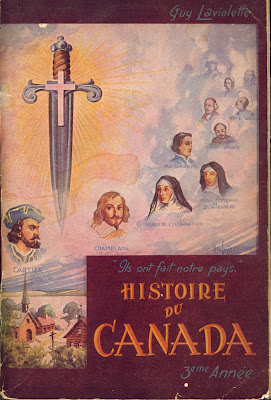 l'hymne national Ô Canada) tandis qu'en anglais le titre était The
Map of Canadian Legends. La
carte des légendes canadiennes : «Canada, Ton histoire est une
épopée :
le genre littéraire épique est associé à l’expérience vécue,
il opère une certaine déréalisation de ce vécu au nom d’une
évocation édifiante (comme si l’histoire de la Grèce ancienne
s’identifiait à la seule
Iliade ou
l’histoire romaine à L’Énéïde).
La phrase est bien sûr tirée de l’hymne national du Canada par
Basile Routhier. Elle contient une charge affective positive et
suggère l’entreprise-en-construction qu’est le Canada, toujours
à réaliser en fonction de cette épopée. Le Canada n’est pas un
pays, c’est un idéal projeté dans les temps futurs et auquel nous
sommes liés par le passé accompli en commun».
Au contraire, «The Map of Canadian Legends
: l’aspect pragmatique ressort ici du titre. Il n’est plus
question de genre littéraire épique ni d’un idéal projeté dans
l’avenir. Il ne s’agit que d’une carte. La charge affective
porte sur
l'hymne national Ô Canada) tandis qu'en anglais le titre était The
Map of Canadian Legends. La
carte des légendes canadiennes : «Canada, Ton histoire est une
épopée :
le genre littéraire épique est associé à l’expérience vécue,
il opère une certaine déréalisation de ce vécu au nom d’une
évocation édifiante (comme si l’histoire de la Grèce ancienne
s’identifiait à la seule
Iliade ou
l’histoire romaine à L’Énéïde).
La phrase est bien sûr tirée de l’hymne national du Canada par
Basile Routhier. Elle contient une charge affective positive et
suggère l’entreprise-en-construction qu’est le Canada, toujours
à réaliser en fonction de cette épopée. Le Canada n’est pas un
pays, c’est un idéal projeté dans les temps futurs et auquel nous
sommes liés par le passé accompli en commun».
Au contraire, «The Map of Canadian Legends
: l’aspect pragmatique ressort ici du titre. Il n’est plus
question de genre littéraire épique ni d’un idéal projeté dans
l’avenir. Il ne s’agit que d’une carte. La charge affective
porte sur  le mot
«Legends» qui
peut être lu comme la simple illustration de la cartographie, ou
encore comme des
«légendes» de
l’histoire canadienne. Ici aussi nous pouvons associer un aspect de
déréalisation dans la façon de présenter l’histoire canadienne
d’après une suite de «légendes»
remarquables
sans pour autant les associer à
une
entreprise épique. On peut aussi bien supposer que les «légendes»
sont des contes collectifs et héroïques du temps passé. Là où le
titre français évoquait une aspiration à la fierté collective, le
titre anglais suggère à peine un merveilleux légendaire de figures
héroïques».
Dans un cas comme dans l'autre, nous ne sommes pas placés au niveau
tant de la connaissance historique que du mythistoire.
La carte des légendes
anglophones
où revenait souvent les expressions «le premier...» ou «la
première...» revient dans la présentation du nouveau billet de $
10.00 – le premier Premier ministre; la première femme élue; le
premier autochtone sénateur -. ce narcissisme puérile appartient à
l'historicité canadienne-anglaise qui tend à déréaliser
l'Histoire pour une mythologie non pas constituée en un récit
unique, comme dans l'Antiquité, mais qui voudrait que le récit de
l'histoire canadienne corresponde à cette addition de «premiers»
en tous genres. «Car
la déréalisation du narcissisme chauvin réside bien dans cette
recherche de «héros de légendes» à notre taille mais que l’on
voudrait à la hauteur des
le mot
«Legends» qui
peut être lu comme la simple illustration de la cartographie, ou
encore comme des
«légendes» de
l’histoire canadienne. Ici aussi nous pouvons associer un aspect de
déréalisation dans la façon de présenter l’histoire canadienne
d’après une suite de «légendes»
remarquables
sans pour autant les associer à
une
entreprise épique. On peut aussi bien supposer que les «légendes»
sont des contes collectifs et héroïques du temps passé. Là où le
titre français évoquait une aspiration à la fierté collective, le
titre anglais suggère à peine un merveilleux légendaire de figures
héroïques».
Dans un cas comme dans l'autre, nous ne sommes pas placés au niveau
tant de la connaissance historique que du mythistoire.
La carte des légendes
anglophones
où revenait souvent les expressions «le premier...» ou «la
première...» revient dans la présentation du nouveau billet de $
10.00 – le premier Premier ministre; la première femme élue; le
premier autochtone sénateur -. ce narcissisme puérile appartient à
l'historicité canadienne-anglaise qui tend à déréaliser
l'Histoire pour une mythologie non pas constituée en un récit
unique, comme dans l'Antiquité, mais qui voudrait que le récit de
l'histoire canadienne corresponde à cette addition de «premiers»
en tous genres. «Car
la déréalisation du narcissisme chauvin réside bien dans cette
recherche de «héros de légendes» à notre taille mais que l’on
voudrait à la hauteur des  héros que l’on envie. Il s’agit moins
d’un délire de jalousie que d’une certaine névrose collective
où le Moi idéal rencontre, dans un combat décevant, l’Idéal du
Moi»
Cet
Idéal
du Moi, c'est
le modèle américain. Celui du narcissisme réussit, de
l'agressivité sans complexes, de la domination totale du continent. Americæ non Canada.
Son histoire aussi est une épopée, depuis les mythistoires de Pocahontas et du Convenant du Mayflower, à la
chevauchée de Paul Revere puis à la traversée de la Delaware, l'Alamo, Gettysburg, la Conquête de l'Ouest, les grandes villes qui sortent des déserts et les
richesses inépuisables gavant les fils de l'abondance. Ces figures sur les billets américains
pourraient être ressenties comme autant de camouflets à la vanité
canadienne qui n'ont qu'une maigre guerre sans vainqueur (celle de
1812) à présenter devant le Voisin hautain.
héros que l’on envie. Il s’agit moins
d’un délire de jalousie que d’une certaine névrose collective
où le Moi idéal rencontre, dans un combat décevant, l’Idéal du
Moi»
Cet
Idéal
du Moi, c'est
le modèle américain. Celui du narcissisme réussit, de
l'agressivité sans complexes, de la domination totale du continent. Americæ non Canada.
Son histoire aussi est une épopée, depuis les mythistoires de Pocahontas et du Convenant du Mayflower, à la
chevauchée de Paul Revere puis à la traversée de la Delaware, l'Alamo, Gettysburg, la Conquête de l'Ouest, les grandes villes qui sortent des déserts et les
richesses inépuisables gavant les fils de l'abondance. Ces figures sur les billets américains
pourraient être ressenties comme autant de camouflets à la vanité
canadienne qui n'ont qu'une maigre guerre sans vainqueur (celle de
1812) à présenter devant le Voisin hautain.
Par
contre, les Canadiens français, les Québécois, ont une «une
 épopée» qui s'inscrit depuis longtemps dans la continuité de
l'Histoire sainte. Une geste fondatrice (1534), une fondation
nationale (1608), une épopée mystique, puis une colonisation de peuplement, une couverture du
territoire qui englobait une grande partie des actuels États-Unis.
Même la poésie canadienne-anglaise relate les grands
faits des Jésuites :
épopée» qui s'inscrit depuis longtemps dans la continuité de
l'Histoire sainte. Une geste fondatrice (1534), une fondation
nationale (1608), une épopée mystique, puis une colonisation de peuplement, une couverture du
territoire qui englobait une grande partie des actuels États-Unis.
Même la poésie canadienne-anglaise relate les grands
faits des Jésuites :
 épopée» qui s'inscrit depuis longtemps dans la continuité de
l'Histoire sainte. Une geste fondatrice (1534), une fondation
nationale (1608), une épopée mystique, puis une colonisation de peuplement, une couverture du
territoire qui englobait une grande partie des actuels États-Unis.
Même la poésie canadienne-anglaise relate les grands
faits des Jésuites :
épopée» qui s'inscrit depuis longtemps dans la continuité de
l'Histoire sainte. Une geste fondatrice (1534), une fondation
nationale (1608), une épopée mystique, puis une colonisation de peuplement, une couverture du
territoire qui englobait une grande partie des actuels États-Unis.
Même la poésie canadienne-anglaise relate les grands
faits des Jésuites :Brébeuf had pleaded for the captive's life,
But as the night wore on, would not his heart
Colliding with his mind have wished for death?
Brébeuf and His Brethren
by
E. J. PRATT
1940
...ou les marches des coureurs des bois jusqu'en
Louisiane et aux Rocheuses. La question qu’il faut poser doit partir des
historicités mêmes : Pourquoi des «légendes» ici, pourquoi une
«épopée» là? Parce que chaque «légende» canadienne est
complète en elle-même; ce sont des déréalités légendaires qui
hantent la conscience historique canadienne-anglaise. Le Canada
serait-il alors lui-même une légende? Non, bien sûr, mais une
terre de «légendes», oui.  Mais comment faire en sorte que des
anecdotes épisodiques et dispersées puissent donner naissance à un sentiment
collectif d'unité nationale, quand on sait que le Canada, plus encore que les
États-Unis, est un pays de sections évoluant en serres chaudes? Les
Maritimes, les Provinces centrales (sœurs ennemies), les Prairies et
la Colombie Britannique sont aussi étrangères les unes aux autres
car, contrairement à l'épopée américaine, elles ne partagent pas
un sens
de l'unité qui
se trouve nécessairement à la base de tout authentique sentiment
national. À part l'Ontario, dont le Canada est une extension, on ne
connaît que très peu de provinces qui n'aient, un jour ou l'autre,
fait menace de séparation du Canada.
Mais comment faire en sorte que des
anecdotes épisodiques et dispersées puissent donner naissance à un sentiment
collectif d'unité nationale, quand on sait que le Canada, plus encore que les
États-Unis, est un pays de sections évoluant en serres chaudes? Les
Maritimes, les Provinces centrales (sœurs ennemies), les Prairies et
la Colombie Britannique sont aussi étrangères les unes aux autres
car, contrairement à l'épopée américaine, elles ne partagent pas
un sens
de l'unité qui
se trouve nécessairement à la base de tout authentique sentiment
national. À part l'Ontario, dont le Canada est une extension, on ne
connaît que très peu de provinces qui n'aient, un jour ou l'autre,
fait menace de séparation du Canada.
 Mais comment faire en sorte que des
anecdotes épisodiques et dispersées puissent donner naissance à un sentiment
collectif d'unité nationale, quand on sait que le Canada, plus encore que les
États-Unis, est un pays de sections évoluant en serres chaudes? Les
Maritimes, les Provinces centrales (sœurs ennemies), les Prairies et
la Colombie Britannique sont aussi étrangères les unes aux autres
car, contrairement à l'épopée américaine, elles ne partagent pas
un sens
de l'unité qui
se trouve nécessairement à la base de tout authentique sentiment
national. À part l'Ontario, dont le Canada est une extension, on ne
connaît que très peu de provinces qui n'aient, un jour ou l'autre,
fait menace de séparation du Canada.
Mais comment faire en sorte que des
anecdotes épisodiques et dispersées puissent donner naissance à un sentiment
collectif d'unité nationale, quand on sait que le Canada, plus encore que les
États-Unis, est un pays de sections évoluant en serres chaudes? Les
Maritimes, les Provinces centrales (sœurs ennemies), les Prairies et
la Colombie Britannique sont aussi étrangères les unes aux autres
car, contrairement à l'épopée américaine, elles ne partagent pas
un sens
de l'unité qui
se trouve nécessairement à la base de tout authentique sentiment
national. À part l'Ontario, dont le Canada est une extension, on ne
connaît que très peu de provinces qui n'aient, un jour ou l'autre,
fait menace de séparation du Canada.
Le
Canada réagit autant en matière intérieure qu'en matière
extérieure. La Confédération, dès le départ, on l'a vu, a été
une  réaction à une menace extérieure : la guerre civile
américaine. La crise de la conscription à Québec a nécessité
l'envoie d'un détachement de militaires anglophones tirer sur la
population francophone de la ville. En 1942, on a procédé à un
référendum dont les résultats étaient prévus d'avance. En
1919, le gouvernement fédéral intervint dans la grève de Winnipeg
tant il craignait une révolution bolchevique. En 1935, la marche des
travailleurs fut arrêté à Regina par les voyous envoyés par
l'État fédéral pour réduire par la
réaction à une menace extérieure : la guerre civile
américaine. La crise de la conscription à Québec a nécessité
l'envoie d'un détachement de militaires anglophones tirer sur la
population francophone de la ville. En 1942, on a procédé à un
référendum dont les résultats étaient prévus d'avance. En
1919, le gouvernement fédéral intervint dans la grève de Winnipeg
tant il craignait une révolution bolchevique. En 1935, la marche des
travailleurs fut arrêté à Regina par les voyous envoyés par
l'État fédéral pour réduire par la  violence des revendi-
violence des revendi-
 réaction à une menace extérieure : la guerre civile
américaine. La crise de la conscription à Québec a nécessité
l'envoie d'un détachement de militaires anglophones tirer sur la
population francophone de la ville. En 1942, on a procédé à un
référendum dont les résultats étaient prévus d'avance. En
1919, le gouvernement fédéral intervint dans la grève de Winnipeg
tant il craignait une révolution bolchevique. En 1935, la marche des
travailleurs fut arrêté à Regina par les voyous envoyés par
l'État fédéral pour réduire par la
réaction à une menace extérieure : la guerre civile
américaine. La crise de la conscription à Québec a nécessité
l'envoie d'un détachement de militaires anglophones tirer sur la
population francophone de la ville. En 1942, on a procédé à un
référendum dont les résultats étaient prévus d'avance. En
1919, le gouvernement fédéral intervint dans la grève de Winnipeg
tant il craignait une révolution bolchevique. En 1935, la marche des
travailleurs fut arrêté à Regina par les voyous envoyés par
l'État fédéral pour réduire par la  violence des revendi-
violence des revendi-
cations
légitimes des malheureux chômeurs en temps de Crise. À Regina, déjà en 1885, le
gouverne-
ment fédéral avait laissé pendre Louis Riel pour
satisfaire la soif de vengeance et de sang des Orangistes ontariens.
Tous ces événements n'ont été que le fruit de réactions de
l'État canadien parce qu'il se montrait incapable ou impuissant à
prévenir ou à solutionner comme il le fallait des problématiques
qui, visiblement, le débordaient. Il en fut de même lorsqu'il
envoya l'armée canadienne occuper une partie du Québec lors des
 événements d'Octobre 1970. Et la dernière en date de ces
«légendes» n’est-elle pas ce rassem-
événements d'Octobre 1970. Et la dernière en date de ces
«légendes» n’est-elle pas ce rassem-
 événements d'Octobre 1970. Et la dernière en date de ces
«légendes» n’est-elle pas ce rassem-
événements d'Octobre 1970. Et la dernière en date de ces
«légendes» n’est-elle pas ce rassem-
blement-monstre – ce
love-in
- de Canadiens de toutes les provinces venus à Montréal, quelques
jours avant la tenue du référendum souverainiste d'octobre 1995,
pour célébrer le Canada bien plutôt que de «dire aux Québécois
qu’ils les aiment et leurs demander de ne pas briser un si beau
pays»… La panique fut pour quelque chose dans ce mouvement
«spontané»… et la gratuité des billets d’avion
aussi! Pour ces lovers,
venir
à Montréal, c'était surtout faire le party. Mais, politiquement, le coup fumeux fut une réussite.
De
tout cela, nous n'avons pas encore abordé la question posée en tête
du message : du processus de «canadianisation» des Québécois
qui s'effectue présentement et met en péril ce sens de l'épopée
et de la communauté
québécoise
devant la société
canadienne.
Il s'agit de poursuivre la réflexion autour de cette différence épopée/légende en
fonction de la distinction entre communauté et société en termes
de catégories sociologiques qui opposent les deux ethnies, et le processus de l'Imaginaire qui
distingue le mécaniste anglo-saxon de l'organiste tel que
véhiculé par le romantisme allemand et transmis au Québec par la
rhétorique ultramontaine du XIXe siècle.
Le
sociologue allemand Ferdinand Tönnies (1855-1936), qui suivait les
transformations de la société allemande à la fin du XIXe siècle,
 opposait la gemeinschaft, la communauté, à la gesellschaft, la
société. Pour lui, les deux modèles de collectivités répondaient
à deux systèmes sociologiques différents. La communauté
était liée par des liens interpersonnels serrés, l'esprit de
famille, de clan ou de tribu, par les affects qui circulaient à
l'intérieur jusque dans ses institutions, ses castes, ses édiles,
etc. La société serait plus atomisée, individuelle, où aux liens
intimes on préfère des associations,
des rapports liés à un assemblage fonctionnel.
La
collectivité québécoise, qui s'était fait violemment réprimer avec
l'échec des rébellions de 1837-1838, s'était repliée sur un sol,
qui ne lui appartenait guère, entre les seigneurs et les compagnies,
et reporta son affection sur la communauté familiale, la revanche des berceaux,
la rhétorique cléricale catholique anti-moderniste des
ultramontains
opposait la gemeinschaft, la communauté, à la gesellschaft, la
société. Pour lui, les deux modèles de collectivités répondaient
à deux systèmes sociologiques différents. La communauté
était liée par des liens interpersonnels serrés, l'esprit de
famille, de clan ou de tribu, par les affects qui circulaient à
l'intérieur jusque dans ses institutions, ses castes, ses édiles,
etc. La société serait plus atomisée, individuelle, où aux liens
intimes on préfère des associations,
des rapports liés à un assemblage fonctionnel.
La
collectivité québécoise, qui s'était fait violemment réprimer avec
l'échec des rébellions de 1837-1838, s'était repliée sur un sol,
qui ne lui appartenait guère, entre les seigneurs et les compagnies,
et reporta son affection sur la communauté familiale, la revanche des berceaux,
la rhétorique cléricale catholique anti-moderniste des
ultramontains  conservateurs.
Cette communauté a commencé à s'effriter sérieuse-
conservateurs.
Cette communauté a commencé à s'effriter sérieuse-
 opposait la gemeinschaft, la communauté, à la gesellschaft, la
société. Pour lui, les deux modèles de collectivités répondaient
à deux systèmes sociologiques différents. La communauté
était liée par des liens interpersonnels serrés, l'esprit de
famille, de clan ou de tribu, par les affects qui circulaient à
l'intérieur jusque dans ses institutions, ses castes, ses édiles,
etc. La société serait plus atomisée, individuelle, où aux liens
intimes on préfère des associations,
des rapports liés à un assemblage fonctionnel.
La
collectivité québécoise, qui s'était fait violemment réprimer avec
l'échec des rébellions de 1837-1838, s'était repliée sur un sol,
qui ne lui appartenait guère, entre les seigneurs et les compagnies,
et reporta son affection sur la communauté familiale, la revanche des berceaux,
la rhétorique cléricale catholique anti-moderniste des
ultramontains
opposait la gemeinschaft, la communauté, à la gesellschaft, la
société. Pour lui, les deux modèles de collectivités répondaient
à deux systèmes sociologiques différents. La communauté
était liée par des liens interpersonnels serrés, l'esprit de
famille, de clan ou de tribu, par les affects qui circulaient à
l'intérieur jusque dans ses institutions, ses castes, ses édiles,
etc. La société serait plus atomisée, individuelle, où aux liens
intimes on préfère des associations,
des rapports liés à un assemblage fonctionnel.
La
collectivité québécoise, qui s'était fait violemment réprimer avec
l'échec des rébellions de 1837-1838, s'était repliée sur un sol,
qui ne lui appartenait guère, entre les seigneurs et les compagnies,
et reporta son affection sur la communauté familiale, la revanche des berceaux,
la rhétorique cléricale catholique anti-moderniste des
ultramontains  conservateurs.
Cette communauté a commencé à s'effriter sérieuse-
conservateurs.
Cette communauté a commencé à s'effriter sérieuse-
ment lorsque les
grandes villes comme Montréal, Trois-Rivières, Québec ou Sherbrooke sont devenues
des cités industrielles; lorsque l'exode vers les États-Unis
démantela des familles nombreuses dont la terre ne parvenait plus à
nourrir ses enfants; lorsque les soldats revinrent de la Grande
Guerre en ayant goûté aux libertés britanniques ou françaises.
Des lois fédérales (sur le divorce en particulier) dressèrent les gardiens de la
foi catholique contre l'ingérence des mœurs protestantes d'un
 gouvernement qui avait toujours fait copain/
gouvernement qui avait toujours fait copain/
 gouvernement qui avait toujours fait copain/
gouvernement qui avait toujours fait copain/
copain avec l'Église. Le
second après-guerre fut fatal. La Révolution tranquille en procéda
qui sonna le glas des communau-
tés régionales traditionnelles qui
n'ont cessé de dépérir depuis. Les boomers,
qui
appartenaient à cette dernière génération, avaient conservé un
certain esprit de communauté qu'ils transférèrent dans le discours national qui porta le Parti Québécois au pouvoir. La dissolution de
cet esprit est la cause majeure de l'ethnolyse québécoise,
c'est-à-dire de la déstructuration de l'Imaginaire national au nom
d'une ethnogénèse qui serait canadienne ou tout simplement
apatride.
Le
Canada anglais a eu ses communautés mais elles ont été beaucoup
plus rapidement dissoutes à l'intérieur de l'importation
industrielle de l'Angleterre et des États-Unis. Alors que Montréal
pouvait encore représenter la métropole du Canada, Toronto et
Vancouver étaient déjà des sociétés où les familles traditionnelles
s'étaient dissoutes, où les quartiers multiethniques s'établissaient progressivement, où les rapports de classes dominaient
les rapports  sociaux. Plus le XXe siècle avançait, et plus les
sociétés ca-nadiennes : Halifax, Toronto, Vancouver dépassaient
la moderni-sation de Montréal. La Révolution tranquille et le
renforcement de l'État québécois essaya de palier à ce retard. L'Expo 67 devait montrer que Montréal était toujours la métropole
du Canada, mais l'exposition sonna le glas plutôt que la relance de
la ville. Le fiasco des Jeux Olympiques de 1976 montra que les
anciens comportements communautaires, avec la petite pègre intégrée
dans les syndicats, l'incompétence des gestionnaires choisis par népotisme, la corruption
du personnel politique, tant à l'Hôtel de Ville de Montréal qu'au gouvernement
du Québec, ne pouvaient produire un
pays à ajouter sur la carte, car ses aspirations ne dépassaient pas les petites satisfactions.
sociaux. Plus le XXe siècle avançait, et plus les
sociétés ca-nadiennes : Halifax, Toronto, Vancouver dépassaient
la moderni-sation de Montréal. La Révolution tranquille et le
renforcement de l'État québécois essaya de palier à ce retard. L'Expo 67 devait montrer que Montréal était toujours la métropole
du Canada, mais l'exposition sonna le glas plutôt que la relance de
la ville. Le fiasco des Jeux Olympiques de 1976 montra que les
anciens comportements communautaires, avec la petite pègre intégrée
dans les syndicats, l'incompétence des gestionnaires choisis par népotisme, la corruption
du personnel politique, tant à l'Hôtel de Ville de Montréal qu'au gouvernement
du Québec, ne pouvaient produire un
pays à ajouter sur la carte, car ses aspirations ne dépassaient pas les petites satisfactions.
 sociaux. Plus le XXe siècle avançait, et plus les
sociétés ca-nadiennes : Halifax, Toronto, Vancouver dépassaient
la moderni-sation de Montréal. La Révolution tranquille et le
renforcement de l'État québécois essaya de palier à ce retard. L'Expo 67 devait montrer que Montréal était toujours la métropole
du Canada, mais l'exposition sonna le glas plutôt que la relance de
la ville. Le fiasco des Jeux Olympiques de 1976 montra que les
anciens comportements communautaires, avec la petite pègre intégrée
dans les syndicats, l'incompétence des gestionnaires choisis par népotisme, la corruption
du personnel politique, tant à l'Hôtel de Ville de Montréal qu'au gouvernement
du Québec, ne pouvaient produire un
pays à ajouter sur la carte, car ses aspirations ne dépassaient pas les petites satisfactions.
sociaux. Plus le XXe siècle avançait, et plus les
sociétés ca-nadiennes : Halifax, Toronto, Vancouver dépassaient
la moderni-sation de Montréal. La Révolution tranquille et le
renforcement de l'État québécois essaya de palier à ce retard. L'Expo 67 devait montrer que Montréal était toujours la métropole
du Canada, mais l'exposition sonna le glas plutôt que la relance de
la ville. Le fiasco des Jeux Olympiques de 1976 montra que les
anciens comportements communautaires, avec la petite pègre intégrée
dans les syndicats, l'incompétence des gestionnaires choisis par népotisme, la corruption
du personnel politique, tant à l'Hôtel de Ville de Montréal qu'au gouvernement
du Québec, ne pouvaient produire un
pays à ajouter sur la carte, car ses aspirations ne dépassaient pas les petites satisfactions.
La
société repose sur un imaginaire essentiellement mécaniste. C'est
la physique anglo-saxonne et la pensée cartésienne qui en sont les
origines. L'univers, le monde, la vie, tout est vu sur un principe  de
machine simple : des poids, des contrepoids, des tractions, des influx, des leviers,
et des boulons qui se vissent les uns aux autres. L'économie politique de Adam Smith, avec sa main
invisible du marché,
procède de la physique gravitationnelle de
Newton. La séparation des pouvoirs, issue de l'Esprit
des Lois de
Montesquieu, s'est imposée dans les régimes politiques anglais,
américain et français à la fin du XVIIIe siècle. La production
est organisée de même par des machines qui fonctionnent sur des
principes de physique. La vaccination de Jenner, qui fit fureur à la
même époque, sur la biochimie. Amherst envoyant des couvertures
infectées de varioles aux autochtones expérimente la première guerre
bactériologique avant la lettre. Il en va de
de
machine simple : des poids, des contrepoids, des tractions, des influx, des leviers,
et des boulons qui se vissent les uns aux autres. L'économie politique de Adam Smith, avec sa main
invisible du marché,
procède de la physique gravitationnelle de
Newton. La séparation des pouvoirs, issue de l'Esprit
des Lois de
Montesquieu, s'est imposée dans les régimes politiques anglais,
américain et français à la fin du XVIIIe siècle. La production
est organisée de même par des machines qui fonctionnent sur des
principes de physique. La vaccination de Jenner, qui fit fureur à la
même époque, sur la biochimie. Amherst envoyant des couvertures
infectées de varioles aux autochtones expérimente la première guerre
bactériologique avant la lettre. Il en va de  même du Principe
des populations de
Malthus. Les statistiques amènent à la sociologie la possibilité
de quantifier et de tirer des courbes démographiques comme l'équilibre des
importations et des exportations des marchés. Même les luttes de classes, pourtant
paraphées de la signature de Karl Marx, répondent à des concepts
mécanistes : mode de production, rapports de production,
capitaux et outils de production, baisse tendancielle des taux de
profits, etc. etc. C'est cette pensée qui structure l'historicité
canadienne-anglaise. Les légendes
ne
sont que des pistons, des boulons, des arcs, des poids qui
constituent un récit afin de créer une morale nationale sur les
valeurs du XVIIIe siècle anglais : le bonheur, la propriété
(c'est la même chose), la
même du Principe
des populations de
Malthus. Les statistiques amènent à la sociologie la possibilité
de quantifier et de tirer des courbes démographiques comme l'équilibre des
importations et des exportations des marchés. Même les luttes de classes, pourtant
paraphées de la signature de Karl Marx, répondent à des concepts
mécanistes : mode de production, rapports de production,
capitaux et outils de production, baisse tendancielle des taux de
profits, etc. etc. C'est cette pensée qui structure l'historicité
canadienne-anglaise. Les légendes
ne
sont que des pistons, des boulons, des arcs, des poids qui
constituent un récit afin de créer une morale nationale sur les
valeurs du XVIIIe siècle anglais : le bonheur, la propriété
(c'est la même chose), la  philanthropie, l'immigration (toujours favorable dans le contexte d'un territoire aux ressources inépuisables),
la tolérance religieuse, la liberté de conscience et d'expression. Tous ces éléments fonctionnent comme des billes qui
permettent au Canada de donner l'apparence d'une nation vivante, le reste
étant le vide politico-juridique des provinces (sauf le Québec).
Mais les poissons de l'Atlantique, le blé des Prairies (remplacé un
temps par le Pétrole merdique), le Pacifique Rim sans oublier les
centres de la finance et des industries que demeure l'Empire du Saint-Laurent
de Creighton, (nous n'avons pas encore produit le Braudel qui ferait
l'histoire économique et urbaine des Grands-Lacs)
philanthropie, l'immigration (toujours favorable dans le contexte d'un territoire aux ressources inépuisables),
la tolérance religieuse, la liberté de conscience et d'expression. Tous ces éléments fonctionnent comme des billes qui
permettent au Canada de donner l'apparence d'une nation vivante, le reste
étant le vide politico-juridique des provinces (sauf le Québec).
Mais les poissons de l'Atlantique, le blé des Prairies (remplacé un
temps par le Pétrole merdique), le Pacifique Rim sans oublier les
centres de la finance et des industries que demeure l'Empire du Saint-Laurent
de Creighton, (nous n'avons pas encore produit le Braudel qui ferait
l'histoire économique et urbaine des Grands-Lacs)  montrent l'échec
du pari économique de 1867. La politique de prélèvement des
richesses pour l'expor-tation à faibles coûts comparée aux prix
souvent exorbitants de la revente en matériels transformés, comme
avec ce stupide accord de Libre-échange, ont fait régresser
l'économie canadienne et l'indépendance économique de sa population, car s'il est
possible d'actionner des tractions pour faire avancer un véhicule,
les mêmes tractions, actionnées en sens contraire, le fera
reculer.
montrent l'échec
du pari économique de 1867. La politique de prélèvement des
richesses pour l'expor-tation à faibles coûts comparée aux prix
souvent exorbitants de la revente en matériels transformés, comme
avec ce stupide accord de Libre-échange, ont fait régresser
l'économie canadienne et l'indépendance économique de sa population, car s'il est
possible d'actionner des tractions pour faire avancer un véhicule,
les mêmes tractions, actionnées en sens contraire, le fera
reculer.
 de
machine simple : des poids, des contrepoids, des tractions, des influx, des leviers,
et des boulons qui se vissent les uns aux autres. L'économie politique de Adam Smith, avec sa main
invisible du marché,
procède de la physique gravitationnelle de
Newton. La séparation des pouvoirs, issue de l'Esprit
des Lois de
Montesquieu, s'est imposée dans les régimes politiques anglais,
américain et français à la fin du XVIIIe siècle. La production
est organisée de même par des machines qui fonctionnent sur des
principes de physique. La vaccination de Jenner, qui fit fureur à la
même époque, sur la biochimie. Amherst envoyant des couvertures
infectées de varioles aux autochtones expérimente la première guerre
bactériologique avant la lettre. Il en va de
de
machine simple : des poids, des contrepoids, des tractions, des influx, des leviers,
et des boulons qui se vissent les uns aux autres. L'économie politique de Adam Smith, avec sa main
invisible du marché,
procède de la physique gravitationnelle de
Newton. La séparation des pouvoirs, issue de l'Esprit
des Lois de
Montesquieu, s'est imposée dans les régimes politiques anglais,
américain et français à la fin du XVIIIe siècle. La production
est organisée de même par des machines qui fonctionnent sur des
principes de physique. La vaccination de Jenner, qui fit fureur à la
même époque, sur la biochimie. Amherst envoyant des couvertures
infectées de varioles aux autochtones expérimente la première guerre
bactériologique avant la lettre. Il en va de  même du Principe
des populations de
Malthus. Les statistiques amènent à la sociologie la possibilité
de quantifier et de tirer des courbes démographiques comme l'équilibre des
importations et des exportations des marchés. Même les luttes de classes, pourtant
paraphées de la signature de Karl Marx, répondent à des concepts
mécanistes : mode de production, rapports de production,
capitaux et outils de production, baisse tendancielle des taux de
profits, etc. etc. C'est cette pensée qui structure l'historicité
canadienne-anglaise. Les légendes
ne
sont que des pistons, des boulons, des arcs, des poids qui
constituent un récit afin de créer une morale nationale sur les
valeurs du XVIIIe siècle anglais : le bonheur, la propriété
(c'est la même chose), la
même du Principe
des populations de
Malthus. Les statistiques amènent à la sociologie la possibilité
de quantifier et de tirer des courbes démographiques comme l'équilibre des
importations et des exportations des marchés. Même les luttes de classes, pourtant
paraphées de la signature de Karl Marx, répondent à des concepts
mécanistes : mode de production, rapports de production,
capitaux et outils de production, baisse tendancielle des taux de
profits, etc. etc. C'est cette pensée qui structure l'historicité
canadienne-anglaise. Les légendes
ne
sont que des pistons, des boulons, des arcs, des poids qui
constituent un récit afin de créer une morale nationale sur les
valeurs du XVIIIe siècle anglais : le bonheur, la propriété
(c'est la même chose), la  philanthropie, l'immigration (toujours favorable dans le contexte d'un territoire aux ressources inépuisables),
la tolérance religieuse, la liberté de conscience et d'expression. Tous ces éléments fonctionnent comme des billes qui
permettent au Canada de donner l'apparence d'une nation vivante, le reste
étant le vide politico-juridique des provinces (sauf le Québec).
Mais les poissons de l'Atlantique, le blé des Prairies (remplacé un
temps par le Pétrole merdique), le Pacifique Rim sans oublier les
centres de la finance et des industries que demeure l'Empire du Saint-Laurent
de Creighton, (nous n'avons pas encore produit le Braudel qui ferait
l'histoire économique et urbaine des Grands-Lacs)
philanthropie, l'immigration (toujours favorable dans le contexte d'un territoire aux ressources inépuisables),
la tolérance religieuse, la liberté de conscience et d'expression. Tous ces éléments fonctionnent comme des billes qui
permettent au Canada de donner l'apparence d'une nation vivante, le reste
étant le vide politico-juridique des provinces (sauf le Québec).
Mais les poissons de l'Atlantique, le blé des Prairies (remplacé un
temps par le Pétrole merdique), le Pacifique Rim sans oublier les
centres de la finance et des industries que demeure l'Empire du Saint-Laurent
de Creighton, (nous n'avons pas encore produit le Braudel qui ferait
l'histoire économique et urbaine des Grands-Lacs)  montrent l'échec
du pari économique de 1867. La politique de prélèvement des
richesses pour l'expor-tation à faibles coûts comparée aux prix
souvent exorbitants de la revente en matériels transformés, comme
avec ce stupide accord de Libre-échange, ont fait régresser
l'économie canadienne et l'indépendance économique de sa population, car s'il est
possible d'actionner des tractions pour faire avancer un véhicule,
les mêmes tractions, actionnées en sens contraire, le fera
reculer.
montrent l'échec
du pari économique de 1867. La politique de prélèvement des
richesses pour l'expor-tation à faibles coûts comparée aux prix
souvent exorbitants de la revente en matériels transformés, comme
avec ce stupide accord de Libre-échange, ont fait régresser
l'économie canadienne et l'indépendance économique de sa population, car s'il est
possible d'actionner des tractions pour faire avancer un véhicule,
les mêmes tractions, actionnées en sens contraire, le fera
reculer.
La
vieille communauté québécoise était érigée sur une vision
différente, une vision organiste, sur le modèle des organismes
vivants où le tout est plus que la somme de ses parties. Enseigné
 comme philosophie à travers la scolastique de saint Thomas
d'Aquin dans ses collèges classiques, le romantisme issu de Herder
et repris par les historiens français apportait une nouveauté
qui s'inscrivait contre la modernité anglo-saxonne. Les
Anti-Lumières comme les appelle Zeev Sternhell. L'Église,
réactionnaire, fit avec le néo-thomisme sous Léon XIII une bonne
application de la vision organiste. Le discours nationaliste s'en
imprégna pour faire de la nation quelque chose de plus que la somme de
ses citoyens ou de ses membres. Ainsi apprit-on à penser en termes
de communautés villageoises ou de quartiers, avec ses Caisses populaires et ses activités communautaires
pour le développement des paroisses, de la langue française comme
comme philosophie à travers la scolastique de saint Thomas
d'Aquin dans ses collèges classiques, le romantisme issu de Herder
et repris par les historiens français apportait une nouveauté
qui s'inscrivait contre la modernité anglo-saxonne. Les
Anti-Lumières comme les appelle Zeev Sternhell. L'Église,
réactionnaire, fit avec le néo-thomisme sous Léon XIII une bonne
application de la vision organiste. Le discours nationaliste s'en
imprégna pour faire de la nation quelque chose de plus que la somme de
ses citoyens ou de ses membres. Ainsi apprit-on à penser en termes
de communautés villageoises ou de quartiers, avec ses Caisses populaires et ses activités communautaires
pour le développement des paroisses, de la langue française comme
 spécificité linguistique homogène. Le refus de la modernité face à
l'avenir renvoyait au refus du métissage par le passé, Lionel
Groulx y ayant fait régner les thèmes barrésiens de la race et du
déracinement. Le séparatisme des ultramontains était davantage
culturel que politique. C'est par une revanche démographique qu'on
croyait naïvement, vers 1920, que l'Amérique du Nord serait peuplée
de manière dominante de francophones catholiques jusqu'à Los
Angeles dans les années 70! De tels fantasmes étaient impensables
dans la société canadienne-anglaise. Elle avait plus de territoires qu'elle en avait besoin.
spécificité linguistique homogène. Le refus de la modernité face à
l'avenir renvoyait au refus du métissage par le passé, Lionel
Groulx y ayant fait régner les thèmes barrésiens de la race et du
déracinement. Le séparatisme des ultramontains était davantage
culturel que politique. C'est par une revanche démographique qu'on
croyait naïvement, vers 1920, que l'Amérique du Nord serait peuplée
de manière dominante de francophones catholiques jusqu'à Los
Angeles dans les années 70! De tels fantasmes étaient impensables
dans la société canadienne-anglaise. Elle avait plus de territoires qu'elle en avait besoin.
 comme philosophie à travers la scolastique de saint Thomas
d'Aquin dans ses collèges classiques, le romantisme issu de Herder
et repris par les historiens français apportait une nouveauté
qui s'inscrivait contre la modernité anglo-saxonne. Les
Anti-Lumières comme les appelle Zeev Sternhell. L'Église,
réactionnaire, fit avec le néo-thomisme sous Léon XIII une bonne
application de la vision organiste. Le discours nationaliste s'en
imprégna pour faire de la nation quelque chose de plus que la somme de
ses citoyens ou de ses membres. Ainsi apprit-on à penser en termes
de communautés villageoises ou de quartiers, avec ses Caisses populaires et ses activités communautaires
pour le développement des paroisses, de la langue française comme
comme philosophie à travers la scolastique de saint Thomas
d'Aquin dans ses collèges classiques, le romantisme issu de Herder
et repris par les historiens français apportait une nouveauté
qui s'inscrivait contre la modernité anglo-saxonne. Les
Anti-Lumières comme les appelle Zeev Sternhell. L'Église,
réactionnaire, fit avec le néo-thomisme sous Léon XIII une bonne
application de la vision organiste. Le discours nationaliste s'en
imprégna pour faire de la nation quelque chose de plus que la somme de
ses citoyens ou de ses membres. Ainsi apprit-on à penser en termes
de communautés villageoises ou de quartiers, avec ses Caisses populaires et ses activités communautaires
pour le développement des paroisses, de la langue française comme
 spécificité linguistique homogène. Le refus de la modernité face à
l'avenir renvoyait au refus du métissage par le passé, Lionel
Groulx y ayant fait régner les thèmes barrésiens de la race et du
déracinement. Le séparatisme des ultramontains était davantage
culturel que politique. C'est par une revanche démographique qu'on
croyait naïvement, vers 1920, que l'Amérique du Nord serait peuplée
de manière dominante de francophones catholiques jusqu'à Los
Angeles dans les années 70! De tels fantasmes étaient impensables
dans la société canadienne-anglaise. Elle avait plus de territoires qu'elle en avait besoin.
spécificité linguistique homogène. Le refus de la modernité face à
l'avenir renvoyait au refus du métissage par le passé, Lionel
Groulx y ayant fait régner les thèmes barrésiens de la race et du
déracinement. Le séparatisme des ultramontains était davantage
culturel que politique. C'est par une revanche démographique qu'on
croyait naïvement, vers 1920, que l'Amérique du Nord serait peuplée
de manière dominante de francophones catholiques jusqu'à Los
Angeles dans les années 70! De tels fantasmes étaient impensables
dans la société canadienne-anglaise. Elle avait plus de territoires qu'elle en avait besoin.
La
rencontre qui, à courte vue, donnait le Québec gagnant à être maître
chez lui avant d'être Indépendant entre 1960 et 1980, apparaît tout autrement au fur et à mesure que nous
nous éloignons de cette période. À la veille de pénétrer dans la
troisième décennie  du XXIe siècle, il apparaît que les outils politiques que la génération des boomers s'est dotée sont devenus désuets et
plus nuisibles qu'utiles. La politique nationaliste ne
parvient pas à consolider la volonté nationale car elle s'adosse
elle-même sur un système mécaniste : la démocratie. La société québécoise
abolit la communauté traditionnelle. Ses régions sont désertées
par une
du XXIe siècle, il apparaît que les outils politiques que la génération des boomers s'est dotée sont devenus désuets et
plus nuisibles qu'utiles. La politique nationaliste ne
parvient pas à consolider la volonté nationale car elle s'adosse
elle-même sur un système mécaniste : la démocratie. La société québécoise
abolit la communauté traditionnelle. Ses régions sont désertées
par une  jeunesse qui, tout en méprisant l'aspect con-sumériste ou
capitaliste de la ville, s'aperçoit qu'elle ne peut vivre sans lui.
Ils sont des rouages d'un système mondialisé mécaniste, les boulons d'une vaste machinerie qui dépasse leurs horizons. Xavier Dolan ou
François Arnaud peuvent bien s'agiter pour l'Indépendance du
Québec, mais c'est dans la machine hollywoodienne qu'ils entendent
percer. Ils n'appartiennent à aucune communauté de type traditionnel mais à des réseaux de contacts professionnels, artistiques ou d'amitiés.
jeunesse qui, tout en méprisant l'aspect con-sumériste ou
capitaliste de la ville, s'aperçoit qu'elle ne peut vivre sans lui.
Ils sont des rouages d'un système mondialisé mécaniste, les boulons d'une vaste machinerie qui dépasse leurs horizons. Xavier Dolan ou
François Arnaud peuvent bien s'agiter pour l'Indépendance du
Québec, mais c'est dans la machine hollywoodienne qu'ils entendent
percer. Ils n'appartiennent à aucune communauté de type traditionnel mais à des réseaux de contacts professionnels, artistiques ou d'amitiés.
 du XXIe siècle, il apparaît que les outils politiques que la génération des boomers s'est dotée sont devenus désuets et
plus nuisibles qu'utiles. La politique nationaliste ne
parvient pas à consolider la volonté nationale car elle s'adosse
elle-même sur un système mécaniste : la démocratie. La société québécoise
abolit la communauté traditionnelle. Ses régions sont désertées
par une
du XXIe siècle, il apparaît que les outils politiques que la génération des boomers s'est dotée sont devenus désuets et
plus nuisibles qu'utiles. La politique nationaliste ne
parvient pas à consolider la volonté nationale car elle s'adosse
elle-même sur un système mécaniste : la démocratie. La société québécoise
abolit la communauté traditionnelle. Ses régions sont désertées
par une  jeunesse qui, tout en méprisant l'aspect con-sumériste ou
capitaliste de la ville, s'aperçoit qu'elle ne peut vivre sans lui.
Ils sont des rouages d'un système mondialisé mécaniste, les boulons d'une vaste machinerie qui dépasse leurs horizons. Xavier Dolan ou
François Arnaud peuvent bien s'agiter pour l'Indépendance du
Québec, mais c'est dans la machine hollywoodienne qu'ils entendent
percer. Ils n'appartiennent à aucune communauté de type traditionnel mais à des réseaux de contacts professionnels, artistiques ou d'amitiés.
jeunesse qui, tout en méprisant l'aspect con-sumériste ou
capitaliste de la ville, s'aperçoit qu'elle ne peut vivre sans lui.
Ils sont des rouages d'un système mondialisé mécaniste, les boulons d'une vaste machinerie qui dépasse leurs horizons. Xavier Dolan ou
François Arnaud peuvent bien s'agiter pour l'Indépendance du
Québec, mais c'est dans la machine hollywoodienne qu'ils entendent
percer. Ils n'appartiennent à aucune communauté de type traditionnel mais à des réseaux de contacts professionnels, artistiques ou d'amitiés.
L'ethnolyse
de la communauté québécoise se restructure en ethnogénèse
canadienne. Ce n'est pas le déclin de la langue  française, pas plus
que la désertion des églises dans les années soixante-dix du XXe
siècle, qui est la cause de la perte de l'épopée québécoise, de l'esprit national qui se
sclérose dans le Parti Québécois ou l'insignifiant Bloc Québécois.
Le discours indépendantiste de Québec Solidaire apparaît aussi
ridicule puisqu'il ne
française, pas plus
que la désertion des églises dans les années soixante-dix du XXe
siècle, qui est la cause de la perte de l'épopée québécoise, de l'esprit national qui se
sclérose dans le Parti Québécois ou l'insignifiant Bloc Québécois.
Le discours indépendantiste de Québec Solidaire apparaît aussi
ridicule puisqu'il ne  demande qu'à faire fonctionner un Québec
selon les principes mécanistes d'une social-démocratie atavique
depuis ses origines. Cette macédoine de vieux commu-
demande qu'à faire fonctionner un Québec
selon les principes mécanistes d'une social-démocratie atavique
depuis ses origines. Cette macédoine de vieux commu-
 française, pas plus
que la désertion des églises dans les années soixante-dix du XXe
siècle, qui est la cause de la perte de l'épopée québécoise, de l'esprit national qui se
sclérose dans le Parti Québécois ou l'insignifiant Bloc Québécois.
Le discours indépendantiste de Québec Solidaire apparaît aussi
ridicule puisqu'il ne
française, pas plus
que la désertion des églises dans les années soixante-dix du XXe
siècle, qui est la cause de la perte de l'épopée québécoise, de l'esprit national qui se
sclérose dans le Parti Québécois ou l'insignifiant Bloc Québécois.
Le discours indépendantiste de Québec Solidaire apparaît aussi
ridicule puisqu'il ne  demande qu'à faire fonctionner un Québec
selon les principes mécanistes d'une social-démocratie atavique
depuis ses origines. Cette macédoine de vieux commu-
demande qu'à faire fonctionner un Québec
selon les principes mécanistes d'une social-démocratie atavique
depuis ses origines. Cette macédoine de vieux commu-
nistes toujours-déjà décérébrés,
de féministes hystériques, de multicul déjantés et d'anciens
péquistes frustrés, ne donnent pas un meilleur bilan de santé que les
vieilles corruptions du Parti Libéral du Québec. C'est un parti de boulons Ikea sans plan d'ensemble, sans Tout transcendant. Dans la société
canadienne-anglaise, les choses ne  vont guère mieux : le règne
de Stephen Harper a conduit à une régression coloniale du Canada
qui l'a ramené presque au début du XIXe siècle tandis que l'inepte
Justin Trudeau n'a aucun sens ni du politique ni de l'État. Durant
les conférences internationales, il apparaît pathétiquement hors jeu. Si l'on fait la somme de l'opération, l'ethnogénèse ne vaut
pas l'ethnolyse. C'est-
vont guère mieux : le règne
de Stephen Harper a conduit à une régression coloniale du Canada
qui l'a ramené presque au début du XIXe siècle tandis que l'inepte
Justin Trudeau n'a aucun sens ni du politique ni de l'État. Durant
les conférences internationales, il apparaît pathétiquement hors jeu. Si l'on fait la somme de l'opération, l'ethnogénèse ne vaut
pas l'ethnolyse. C'est- à-dire ce que nous construisons présente-ment
sur de l'argile. Le Canada n'est toujours pas un pays doté
d'un véritable État. Il en a les structures administratives sans
doute : la perception des impôts, les dépenses ostentatoires,
son incapacité à prendre les problèmes sociaux au sérieux afin de laisser la libre-entreprise néo-libérale faire la loi, tout cela, le Canada l'a. Mais il n'est pas un État ontologique qui
donnerait à sa collectivité un statut d'Être. Il préfère survivre en entretenant la barrière des deux solitudes qui lui permet de jouer l'une contre l'autre dans les cas conflictuels et de maintenir le statu quo le plus longtemps possible. Il y a un État
français, un État allemand, un État américain, mais pas d'État
canadien.
à-dire ce que nous construisons présente-ment
sur de l'argile. Le Canada n'est toujours pas un pays doté
d'un véritable État. Il en a les structures administratives sans
doute : la perception des impôts, les dépenses ostentatoires,
son incapacité à prendre les problèmes sociaux au sérieux afin de laisser la libre-entreprise néo-libérale faire la loi, tout cela, le Canada l'a. Mais il n'est pas un État ontologique qui
donnerait à sa collectivité un statut d'Être. Il préfère survivre en entretenant la barrière des deux solitudes qui lui permet de jouer l'une contre l'autre dans les cas conflictuels et de maintenir le statu quo le plus longtemps possible. Il y a un État
français, un État allemand, un État américain, mais pas d'État
canadien.
 vont guère mieux : le règne
de Stephen Harper a conduit à une régression coloniale du Canada
qui l'a ramené presque au début du XIXe siècle tandis que l'inepte
Justin Trudeau n'a aucun sens ni du politique ni de l'État. Durant
les conférences internationales, il apparaît pathétiquement hors jeu. Si l'on fait la somme de l'opération, l'ethnogénèse ne vaut
pas l'ethnolyse. C'est-
vont guère mieux : le règne
de Stephen Harper a conduit à une régression coloniale du Canada
qui l'a ramené presque au début du XIXe siècle tandis que l'inepte
Justin Trudeau n'a aucun sens ni du politique ni de l'État. Durant
les conférences internationales, il apparaît pathétiquement hors jeu. Si l'on fait la somme de l'opération, l'ethnogénèse ne vaut
pas l'ethnolyse. C'est- à-dire ce que nous construisons présente-ment
sur de l'argile. Le Canada n'est toujours pas un pays doté
d'un véritable État. Il en a les structures administratives sans
doute : la perception des impôts, les dépenses ostentatoires,
son incapacité à prendre les problèmes sociaux au sérieux afin de laisser la libre-entreprise néo-libérale faire la loi, tout cela, le Canada l'a. Mais il n'est pas un État ontologique qui
donnerait à sa collectivité un statut d'Être. Il préfère survivre en entretenant la barrière des deux solitudes qui lui permet de jouer l'une contre l'autre dans les cas conflictuels et de maintenir le statu quo le plus longtemps possible. Il y a un État
français, un État allemand, un État américain, mais pas d'État
canadien.
à-dire ce que nous construisons présente-ment
sur de l'argile. Le Canada n'est toujours pas un pays doté
d'un véritable État. Il en a les structures administratives sans
doute : la perception des impôts, les dépenses ostentatoires,
son incapacité à prendre les problèmes sociaux au sérieux afin de laisser la libre-entreprise néo-libérale faire la loi, tout cela, le Canada l'a. Mais il n'est pas un État ontologique qui
donnerait à sa collectivité un statut d'Être. Il préfère survivre en entretenant la barrière des deux solitudes qui lui permet de jouer l'une contre l'autre dans les cas conflictuels et de maintenir le statu quo le plus longtemps possible. Il y a un État
français, un État allemand, un État américain, mais pas d'État
canadien.
Il s'est parfois produit, mais pour un bref laps de temps toutefois, des possibilités pour le Québec d'accéder à ce statut ontologique d'État. Lors du premier mandat du Parti Québécois (1976-1981), avec la loi 101 sur la
primauté linguistique du français et la  persistance de l'État-providence; il y a eu l'échec de l'entente du Lac Meech, le 22 juin 1990, à la veille de la Fête nationale des Canadiens français, lorsque le Premier ministre Bourassa (libéral), s'il avait été ce Prince dont parlait Machiavel, aurait pu pousser l'épaule à la roue. En lieu et place, nous avons eu droit à un beau mot historique : «Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu'on
dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours,
une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son
développement», qui passa comme une petite vesse parfumée de lavande. Enfin, le moment le plus important du mandat de Jacques Parizeau, élu Premier ministre (Parti Québécois) lors de la formation de son cabinet, le 26 septembre 1994, lorsqu'il présenta
persistance de l'État-providence; il y a eu l'échec de l'entente du Lac Meech, le 22 juin 1990, à la veille de la Fête nationale des Canadiens français, lorsque le Premier ministre Bourassa (libéral), s'il avait été ce Prince dont parlait Machiavel, aurait pu pousser l'épaule à la roue. En lieu et place, nous avons eu droit à un beau mot historique : «Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu'on
dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours,
une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son
développement», qui passa comme une petite vesse parfumée de lavande. Enfin, le moment le plus important du mandat de Jacques Parizeau, élu Premier ministre (Parti Québécois) lors de la formation de son cabinet, le 26 septembre 1994, lorsqu'il présenta  l'embryon d'un futur État libre du Québec, un parlement bicaméral où, à côté de la Chambre d'Assem-blée, siégeait un Sénat représentant des régions, à l'exemple du Sénat américain et non de cette fantaisiste Chambre des Lords à Ottawa. Ce fut le dernier moment où la perspective offerte au Québec d'apparaître comme un véritable État national transcendant s'est présentée. Après l'inutile référendum sur la Souveraineté-partenariat, avant même que le gouvernement
néo-libéral des Charest et Couillard ne soit au pouvoir, le
régime du Parti Québécois, avec l'inénarrable
Lucien Bouchard et son patriote-nain, Bernard Landry, avaient brisé la
communauté pour en faire une machine compatible avec les rouages de
l'État fédéral.
l'embryon d'un futur État libre du Québec, un parlement bicaméral où, à côté de la Chambre d'Assem-blée, siégeait un Sénat représentant des régions, à l'exemple du Sénat américain et non de cette fantaisiste Chambre des Lords à Ottawa. Ce fut le dernier moment où la perspective offerte au Québec d'apparaître comme un véritable État national transcendant s'est présentée. Après l'inutile référendum sur la Souveraineté-partenariat, avant même que le gouvernement
néo-libéral des Charest et Couillard ne soit au pouvoir, le
régime du Parti Québécois, avec l'inénarrable
Lucien Bouchard et son patriote-nain, Bernard Landry, avaient brisé la
communauté pour en faire une machine compatible avec les rouages de
l'État fédéral.
 persistance de l'État-providence; il y a eu l'échec de l'entente du Lac Meech, le 22 juin 1990, à la veille de la Fête nationale des Canadiens français, lorsque le Premier ministre Bourassa (libéral), s'il avait été ce Prince dont parlait Machiavel, aurait pu pousser l'épaule à la roue. En lieu et place, nous avons eu droit à un beau mot historique : «Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu'on
dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours,
une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son
développement», qui passa comme une petite vesse parfumée de lavande. Enfin, le moment le plus important du mandat de Jacques Parizeau, élu Premier ministre (Parti Québécois) lors de la formation de son cabinet, le 26 septembre 1994, lorsqu'il présenta
persistance de l'État-providence; il y a eu l'échec de l'entente du Lac Meech, le 22 juin 1990, à la veille de la Fête nationale des Canadiens français, lorsque le Premier ministre Bourassa (libéral), s'il avait été ce Prince dont parlait Machiavel, aurait pu pousser l'épaule à la roue. En lieu et place, nous avons eu droit à un beau mot historique : «Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que, quoi qu'on
dise et quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours,
une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son
développement», qui passa comme une petite vesse parfumée de lavande. Enfin, le moment le plus important du mandat de Jacques Parizeau, élu Premier ministre (Parti Québécois) lors de la formation de son cabinet, le 26 septembre 1994, lorsqu'il présenta  l'embryon d'un futur État libre du Québec, un parlement bicaméral où, à côté de la Chambre d'Assem-blée, siégeait un Sénat représentant des régions, à l'exemple du Sénat américain et non de cette fantaisiste Chambre des Lords à Ottawa. Ce fut le dernier moment où la perspective offerte au Québec d'apparaître comme un véritable État national transcendant s'est présentée. Après l'inutile référendum sur la Souveraineté-partenariat, avant même que le gouvernement
néo-libéral des Charest et Couillard ne soit au pouvoir, le
régime du Parti Québécois, avec l'inénarrable
Lucien Bouchard et son patriote-nain, Bernard Landry, avaient brisé la
communauté pour en faire une machine compatible avec les rouages de
l'État fédéral.
l'embryon d'un futur État libre du Québec, un parlement bicaméral où, à côté de la Chambre d'Assem-blée, siégeait un Sénat représentant des régions, à l'exemple du Sénat américain et non de cette fantaisiste Chambre des Lords à Ottawa. Ce fut le dernier moment où la perspective offerte au Québec d'apparaître comme un véritable État national transcendant s'est présentée. Après l'inutile référendum sur la Souveraineté-partenariat, avant même que le gouvernement
néo-libéral des Charest et Couillard ne soit au pouvoir, le
régime du Parti Québécois, avec l'inénarrable
Lucien Bouchard et son patriote-nain, Bernard Landry, avaient brisé la
communauté pour en faire une machine compatible avec les rouages de
l'État fédéral.
Bref,
cent-cinquante ans après la Confédération de 1867, nous  n'avons
toujours pas de vrai
pays.
L'un est un avorton et l'autre une légende anhistorique suspendue à la
prothèse de Terry Fox. Donc ni 24 juin, ni 1er juillet. Attendons le
4 pour aller célébrer avec les Américains leur fête nationale à
Ogunquit ou à Old
Orchard Beach au
Maine⌛
n'avons
toujours pas de vrai
pays.
L'un est un avorton et l'autre une légende anhistorique suspendue à la
prothèse de Terry Fox. Donc ni 24 juin, ni 1er juillet. Attendons le
4 pour aller célébrer avec les Américains leur fête nationale à
Ogunquit ou à Old
Orchard Beach au
Maine⌛
 n'avons
toujours pas de vrai
pays.
L'un est un avorton et l'autre une légende anhistorique suspendue à la
prothèse de Terry Fox. Donc ni 24 juin, ni 1er juillet. Attendons le
4 pour aller célébrer avec les Américains leur fête nationale à
Ogunquit ou à Old
Orchard Beach au
Maine⌛
n'avons
toujours pas de vrai
pays.
L'un est un avorton et l'autre une légende anhistorique suspendue à la
prothèse de Terry Fox. Donc ni 24 juin, ni 1er juillet. Attendons le
4 pour aller célébrer avec les Américains leur fête nationale à
Ogunquit ou à Old
Orchard Beach au
Maine⌛
Montréal,
1er
juillet 2017

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire