Je n’admire pas la jeunesse
pour la brutalité de ses certitudes
mais pour la sincérité de ses angoisses.
pour la brutalité de ses certitudes
mais pour la sincérité de ses angoisses.
Philippe Bouvard
Ce dimanche soir, 29 janvier 2012, c’est l’heure de mettre mon cerveau au neutre, c’est la reprise de Tout le mode en parle. Parmi les invités, Éric Duhaime adéquiste forcené qui a suivi son idole, Mario Dumont, au canal-télé V (pour Vidanges, ce que ramassaient à
 l’origine les propriétaires du réseau, les frères Rémillard); canal-télé reconnu pour sa démagogie de droite, ses insolences poubellistes et son recyclage d’émissions américaines. Ce jeune issu de Science Po. de l’U de M et des sciences administratives aurait fait un parfait jeune cadre dans une entreprise de verres en stearofoam, intoxiqué par les discours de la réussite sociale et de la promotion au mérite. Présenté comme un anarchiste de droite parce qu’on ne sait pas trop où le classer dans l’éventail des options politiques, il vient de publier un essai dans lequel il expose ses «angoisses» sur l’avenir de la jeunesse québécoise, dont il se voudrait un prophète authentique et exclusif, bien qu’il raisonne avec les sophismes de Jean Charest et son «fonds des générations», visant à éponger l’«écrasante» dette des Québécois afin de ne pas la transmettre à nos héritiers.
l’origine les propriétaires du réseau, les frères Rémillard); canal-télé reconnu pour sa démagogie de droite, ses insolences poubellistes et son recyclage d’émissions américaines. Ce jeune issu de Science Po. de l’U de M et des sciences administratives aurait fait un parfait jeune cadre dans une entreprise de verres en stearofoam, intoxiqué par les discours de la réussite sociale et de la promotion au mérite. Présenté comme un anarchiste de droite parce qu’on ne sait pas trop où le classer dans l’éventail des options politiques, il vient de publier un essai dans lequel il expose ses «angoisses» sur l’avenir de la jeunesse québécoise, dont il se voudrait un prophète authentique et exclusif, bien qu’il raisonne avec les sophismes de Jean Charest et son «fonds des générations», visant à éponger l’«écrasante» dette des Québécois afin de ne pas la transmettre à nos héritiers.Face à lui, on avait sorti ce vieux baby-boomer idéologue du P.Q., Jean-François Lisée, bon journaliste, bon debater, mais qui à force de cibler le noir finit par tuer le blanc. En fait, c’était une
 virée promotionnelle des deux journalistes qui, chacun de son côté, viennent de publier un bouquin: Comment mettre la droite K.O en 15 arguments pour Lisée (pourquoi pas 14 ou 16?), et L’État contre les jeunes de Duhaime. Bref, dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait de ploguer leurs camelotes qui, à l'exemple des mouches à feu de Jean Narrache, ont la lumière collée au péteux qui ne fait qu'éclairer les suiveux. Comme toujours dans cette émission, on passe de Caïphe à Pilate, ou de Charybde en Scylla au choix… Qui aime mieux le Québec, de la droite ou de la gauche? Pas d’affaire là! Les régimes de retraite et les fonds de pension? La Caisse de dépôts et de placements de Lisée ou le REER de Duhaime, lequel serait suffisant afin de leur procurer une vieillesse dorée dans une Résidence Soleil? Tant mieux, mais ce n’est pas le cas de la grande majorité des Québécois, baby-boomers ou pas, qui dispose de suffisamment de revenus par rapport au coût de la vie pour thésauriser dans un fonds de pension qui risque de se faire banditer par un Earl Jones ou un Vincent Lacroix. «Le discours de la gauche est encore statique et il n’a pas changé depuis des années», rétorque Duhaime au coup de gauche porté par Lisée. Pourtant,
virée promotionnelle des deux journalistes qui, chacun de son côté, viennent de publier un bouquin: Comment mettre la droite K.O en 15 arguments pour Lisée (pourquoi pas 14 ou 16?), et L’État contre les jeunes de Duhaime. Bref, dans un cas comme dans l’autre, il s’agissait de ploguer leurs camelotes qui, à l'exemple des mouches à feu de Jean Narrache, ont la lumière collée au péteux qui ne fait qu'éclairer les suiveux. Comme toujours dans cette émission, on passe de Caïphe à Pilate, ou de Charybde en Scylla au choix… Qui aime mieux le Québec, de la droite ou de la gauche? Pas d’affaire là! Les régimes de retraite et les fonds de pension? La Caisse de dépôts et de placements de Lisée ou le REER de Duhaime, lequel serait suffisant afin de leur procurer une vieillesse dorée dans une Résidence Soleil? Tant mieux, mais ce n’est pas le cas de la grande majorité des Québécois, baby-boomers ou pas, qui dispose de suffisamment de revenus par rapport au coût de la vie pour thésauriser dans un fonds de pension qui risque de se faire banditer par un Earl Jones ou un Vincent Lacroix. «Le discours de la gauche est encore statique et il n’a pas changé depuis des années», rétorque Duhaime au coup de gauche porté par Lisée. Pourtant,  les démêlés de Duhaime avec Amir Khadir ont montré à quel point ce diplômé de Science Po avait reçu sa diplômation dans une boîte de Cracker Jack. L’argument massue de Duhaime: «les “élites politiques” ont trahi les jeunes générations. “Toutes les générations ont vécu plus riches que leurs parents. Pas là. […] On a un système politique qui a refilé la facture à la génération qui n’avait pas le droit de vote”». Là, je m’interroge en tant qu’historien. Jusqu’où faut-il remonter dans le passé pour voir une génération vivre plus riche que la précédente? Dans la bourgeoisie, le fait est vrai, surtout depuis la Révolution industrielle dont elle avait le contrôle quasi exclusif, le libéralisme sauvage tenant l’État à l’écart, ce qui permit d’accentuer le gouffre qui séparait les enfants des bourgeois des enfants des prolétaires auxquels ils ne devaient surtout pas ressembler. Au Québec, le phénomène ne devient vrai qu’avec la génération des baby-boomers. Pourquoi? Parce qu’ils ont précisément cessé de faire des enfants. Par le fait même, le fardeau de la dette s'est réparti sur les épaules de moins de citoyens. Au lieu de calculer le rapport de citoyens actifs et de citoyens passifs (7/10, 5/10) afin de donner un aspect scientifique et surtout apocalyptique à son réquisitoire contre l’État, il aurait mieux fait de calculer la base démographique sur le long terme et l’évolution de la dette québécoise. Il est vrai que du temps où nous avions beaucoup d’enfants, il n’y avait pas de dette nationale au Québec. La bonne vieille corruption de Duplessis n’avait pas servi à lui remplir les poches, contrairement aux Libéraux actuels, mais surtout les coffres de son parti et la caisse de la Province. Tout le reste fonctionnait au privé avec les iniquités qu’on devine. Un revenu de poubelliste dans les années 50 ne suffirait pas, ajusté à la valeur actuelle de l’argent, à payer le style de vie dont bénéficie M. Duhaime. D’autre part, son obsession viscérale vis-à-vis de l’État-providence tient là encore au fait de son ignorance crasse. Ce n’est pas l’État-providence qui a amassé l'argent afin de payer les polyvalentes
les démêlés de Duhaime avec Amir Khadir ont montré à quel point ce diplômé de Science Po avait reçu sa diplômation dans une boîte de Cracker Jack. L’argument massue de Duhaime: «les “élites politiques” ont trahi les jeunes générations. “Toutes les générations ont vécu plus riches que leurs parents. Pas là. […] On a un système politique qui a refilé la facture à la génération qui n’avait pas le droit de vote”». Là, je m’interroge en tant qu’historien. Jusqu’où faut-il remonter dans le passé pour voir une génération vivre plus riche que la précédente? Dans la bourgeoisie, le fait est vrai, surtout depuis la Révolution industrielle dont elle avait le contrôle quasi exclusif, le libéralisme sauvage tenant l’État à l’écart, ce qui permit d’accentuer le gouffre qui séparait les enfants des bourgeois des enfants des prolétaires auxquels ils ne devaient surtout pas ressembler. Au Québec, le phénomène ne devient vrai qu’avec la génération des baby-boomers. Pourquoi? Parce qu’ils ont précisément cessé de faire des enfants. Par le fait même, le fardeau de la dette s'est réparti sur les épaules de moins de citoyens. Au lieu de calculer le rapport de citoyens actifs et de citoyens passifs (7/10, 5/10) afin de donner un aspect scientifique et surtout apocalyptique à son réquisitoire contre l’État, il aurait mieux fait de calculer la base démographique sur le long terme et l’évolution de la dette québécoise. Il est vrai que du temps où nous avions beaucoup d’enfants, il n’y avait pas de dette nationale au Québec. La bonne vieille corruption de Duplessis n’avait pas servi à lui remplir les poches, contrairement aux Libéraux actuels, mais surtout les coffres de son parti et la caisse de la Province. Tout le reste fonctionnait au privé avec les iniquités qu’on devine. Un revenu de poubelliste dans les années 50 ne suffirait pas, ajusté à la valeur actuelle de l’argent, à payer le style de vie dont bénéficie M. Duhaime. D’autre part, son obsession viscérale vis-à-vis de l’État-providence tient là encore au fait de son ignorance crasse. Ce n’est pas l’État-providence qui a amassé l'argent afin de payer les polyvalentes  des années 60, les nouveaux hôpitaux qui aujourd’hui sont dévorés de moisissures, les routes et les ponts qui donnèrent un réseau de transport moderne aux grandes villes du Québec et qui aujourd'hui s'effondrent : c’est l’État de Duplessis, la corruption tirée des ventes de permis (permis de tenir un débit de boisson, de cigarettes, permis de conduire, permis de chasse et pêche, permis de tombola, permis…). Toutes les ristournes qui échappaient à la caisse de l’Union Nationale se retrouvaient dans les coffres de la Province, moyen pour Duplessis de vampiriser les gros bénéfices de la bourgeoisie québécoise et étrangère. L’État duplessiste était un État libéral, mais il en profitait pour se servir et, selon les paroles de l’Évangile, laisser tomber de la table quelques miettes pour les petits chiens le jour du banquet de noces. Mais monsieur Duhaime ne regarde le passé que pour le mépriser ou s’en servir pour sa démagogie. Lui, il n’y a d’yeux que pour l’avenir et les jeunes.
des années 60, les nouveaux hôpitaux qui aujourd’hui sont dévorés de moisissures, les routes et les ponts qui donnèrent un réseau de transport moderne aux grandes villes du Québec et qui aujourd'hui s'effondrent : c’est l’État de Duplessis, la corruption tirée des ventes de permis (permis de tenir un débit de boisson, de cigarettes, permis de conduire, permis de chasse et pêche, permis de tombola, permis…). Toutes les ristournes qui échappaient à la caisse de l’Union Nationale se retrouvaient dans les coffres de la Province, moyen pour Duplessis de vampiriser les gros bénéfices de la bourgeoisie québécoise et étrangère. L’État duplessiste était un État libéral, mais il en profitait pour se servir et, selon les paroles de l’Évangile, laisser tomber de la table quelques miettes pour les petits chiens le jour du banquet de noces. Mais monsieur Duhaime ne regarde le passé que pour le mépriser ou s’en servir pour sa démagogie. Lui, il n’y a d’yeux que pour l’avenir et les jeunes.Voilà pourquoi son angoisse, il la transpose sur eux, comme si la jeunesse était particulièrement angoissée par le fardeau de la dette. J’en doute. La dette, comme le marché de l’emploi et autres superstitions néo-libérales, c’est comme le tabernacle de mon enfance. On nous disait que Dieu y résidait dans le corps du Christ, une hostie dans lequel le
 Saint-Sacrement se transubstantiait lors de l’élévation, à un moment particulier de la messe où il fallait baisser les yeux afin ne pas être «ébloui» par la lumière divine. J’ai crû à cette sottise, comme tout un peuple. Puis, un jour, dans les années 60, on a profité que le curé avait le dos tourné pour finir un fond de carafe de vin de messe pour y aller voir, et on s’est aperçu que le tabernacle était …vide. La dette, c’est un peu ça. Aucune transaction de prêts effectuée par le gouvernement du Québec ne se fait sur la seule base du remboursement avec les intérêts. Il y a toujours, directement ou tacitement associées, des «ristournes» qui vont au prêteur lui-même, ou aux clients importants de la corporation qui consent le prêt. De plus, le rapport est inégalitaire. Lorsque le gouvernement emprunte aux capitalistes, il le fait aux taux les plus élevés - d’où cette humiliation que chaque Premier Ministre élu du Québec est obligé de se résoudre à aller subir auprès des marchés de Wall Street. Même René Lévesque y a été faire sa
Saint-Sacrement se transubstantiait lors de l’élévation, à un moment particulier de la messe où il fallait baisser les yeux afin ne pas être «ébloui» par la lumière divine. J’ai crû à cette sottise, comme tout un peuple. Puis, un jour, dans les années 60, on a profité que le curé avait le dos tourné pour finir un fond de carafe de vin de messe pour y aller voir, et on s’est aperçu que le tabernacle était …vide. La dette, c’est un peu ça. Aucune transaction de prêts effectuée par le gouvernement du Québec ne se fait sur la seule base du remboursement avec les intérêts. Il y a toujours, directement ou tacitement associées, des «ristournes» qui vont au prêteur lui-même, ou aux clients importants de la corporation qui consent le prêt. De plus, le rapport est inégalitaire. Lorsque le gouvernement emprunte aux capitalistes, il le fait aux taux les plus élevés - d’où cette humiliation que chaque Premier Ministre élu du Québec est obligé de se résoudre à aller subir auprès des marchés de Wall Street. Même René Lévesque y a été faire sa  soumission, qui ressemble à cette cérémonie de l’adoubement du vassal par son suzerain au Moyen Âge. Par contre, lorsque les financiers empruntent à l’État du Québec, c’est toujours avec des intérêts particulièrement bas, parfois associés à des aménagements du territoire aux frais de l’État ou des frais d’électricité à moindre coût, la balance étant refilé en augmentation de tarifs au commun des citoyens. Or l’État-providence, mais pour qui? Pour l’éducation de base gratuite, qui n’est plus gratuite depuis longtemps? Pour les soins de santé, que le «reconnaissant» Lucien Bouchard a contribué à mutiler jusqu’à fermer les postes de recrutements d’infirmières pour combler son déficit zéro? C’était au temps où son ministre de la santé Jean Rochon (Rochon-Gnochon) disait, avec un manque total de sérieux, qu’il fallait toujours faire plus avec moins! Bouchard, cet autre intoxiqué de la dette, pensait ce jour-là aux capitalistes plus qu’aux citoyens québécois, jeunes ou baby-boomers. Bref, l’État providence a sauvé le libéralisme économique contre sa rapacité en l’empêchant de scier la branche sur laquelle il était assis.
soumission, qui ressemble à cette cérémonie de l’adoubement du vassal par son suzerain au Moyen Âge. Par contre, lorsque les financiers empruntent à l’État du Québec, c’est toujours avec des intérêts particulièrement bas, parfois associés à des aménagements du territoire aux frais de l’État ou des frais d’électricité à moindre coût, la balance étant refilé en augmentation de tarifs au commun des citoyens. Or l’État-providence, mais pour qui? Pour l’éducation de base gratuite, qui n’est plus gratuite depuis longtemps? Pour les soins de santé, que le «reconnaissant» Lucien Bouchard a contribué à mutiler jusqu’à fermer les postes de recrutements d’infirmières pour combler son déficit zéro? C’était au temps où son ministre de la santé Jean Rochon (Rochon-Gnochon) disait, avec un manque total de sérieux, qu’il fallait toujours faire plus avec moins! Bouchard, cet autre intoxiqué de la dette, pensait ce jour-là aux capitalistes plus qu’aux citoyens québécois, jeunes ou baby-boomers. Bref, l’État providence a sauvé le libéralisme économique contre sa rapacité en l’empêchant de scier la branche sur laquelle il était assis. Il a suivi les leçons de Keynes (autre gay qui aurait pu entretenir des relations érotico-financières avec M. Duhaime) : Si tu veux maintenir la «paix sociale» (angoisse du «jeune» Robert Bourassa traumatisé par la crise d’Octobre et la mort de Pierre Laporte, un ministre gênant), impose une redistribution minimum de la richesse jusqu’à contenté le plus grand nombre de gens possibles avec le moins de dépenses. Stratégie clairvoyante d’une autre époque mais que ne peut comprendre le «générationnisme» de M. Duhaime.
Il a suivi les leçons de Keynes (autre gay qui aurait pu entretenir des relations érotico-financières avec M. Duhaime) : Si tu veux maintenir la «paix sociale» (angoisse du «jeune» Robert Bourassa traumatisé par la crise d’Octobre et la mort de Pierre Laporte, un ministre gênant), impose une redistribution minimum de la richesse jusqu’à contenté le plus grand nombre de gens possibles avec le moins de dépenses. Stratégie clairvoyante d’une autre époque mais que ne peut comprendre le «générationnisme» de M. Duhaime.Ne pas tenir compte de la dette! Présenter la dette comme une pure vision de l’esprit, un mythe, un fantasme imaginaire! Je vois déjà l’honnêteté hypocrite des Québécois se soulever de révulsion. Ces balzaciens d’un autre âge prétendent considérer encore la dette comme un engagement d’honneur. Si cette attitude est sincère, elle est totalement anachronique. La dette, c’est une affaire d’argent, ce que le sage Solon, en son temps, traitait de chaînes de papiers. On nous fait payer, à l'ensemble de la population les bénéfices qui ont rapporté surtout à quelques uns, corporations ou individus. Là encore, le «ni État ni corporation» de M. Duhaime, ressemble au «ni gauche ni droite» des intellectuels français de l’Entre-deux-Guerres qui finirent par se compromettre avec le fascisme. Pour le moment,
 vieux ou jeune, on ne tient pas à la différence dans la réalité, la minorité dominante nous force à jouer au César Birotteau et à en mourir heureux s'il le faut, pourvu que notre dette soit remboursée à la dernière cents des intérêts. Cette mentalité que nous avions dans le passé, et qui disait que «ne pas avoir de dettes, c’était s’enrichir», avait été contredite par l’histoire de l’Angleterre elle-même, qui, par l’emprunt sur les marchés, avait lancé sa révolution industrielle. Avoir des dettes l’avait enrichie. Il est vrai qu’elle avait emprunté non pour la consommation (ce que faisait la vieille noblesse qui disparut suite à sa ruine personnelle) mais pour la production de biens industriels, le financement des infrastructures de communication, l’ouverture des marchés par les guerres de conquêtes impérialistes. Ce qu’elle empruntait, elle l’empruntait à des corporations financières anglaises et même à la succursale de la banque internationale des Rothschild, par l'entremise de Nathan Mayer Rotschild, le membre de la famille établit en Angleterre. Deux siècles plus tard, l’Angleterre est un pays en crise qui, à l’exemple de la Grèce, s’apprête à recevoir les Jeux Olympiques, luxe et prestige que les peuples ne peuvent plus se payer. S’il y a une jeunesse aujourd’hui qui angoisse, c’est bien la jeunesse anglaise qui ne trouve plus de débouchés sur le sacrosaint marché du travail, même si la construction du parc olympique et de toutes les bébelles afférentes a créé, pour un bref laps de temps, un mini-boom dans la construction. Et comme les Anglais ne sont pas différents de nous, bien des enveloppes brunes ont dû circuler de Westminster à l’Hôtel de Ville, puis dans les mains des contracteurs pour que les miettes qui en restaient se redistribuent en salaires. «N’ayez pas peur, l’île est pleine de bruit», sera-t-il inscrit sur la cloche géante qui sonnera le coup d’envoi des Olympiques. Cette phrase tirée de La Tempête de Shakespeare, risque de signifier bien plus que les acclamations qui accueilleront William et de Kate, les petits princes mascottes de l’événement.
vieux ou jeune, on ne tient pas à la différence dans la réalité, la minorité dominante nous force à jouer au César Birotteau et à en mourir heureux s'il le faut, pourvu que notre dette soit remboursée à la dernière cents des intérêts. Cette mentalité que nous avions dans le passé, et qui disait que «ne pas avoir de dettes, c’était s’enrichir», avait été contredite par l’histoire de l’Angleterre elle-même, qui, par l’emprunt sur les marchés, avait lancé sa révolution industrielle. Avoir des dettes l’avait enrichie. Il est vrai qu’elle avait emprunté non pour la consommation (ce que faisait la vieille noblesse qui disparut suite à sa ruine personnelle) mais pour la production de biens industriels, le financement des infrastructures de communication, l’ouverture des marchés par les guerres de conquêtes impérialistes. Ce qu’elle empruntait, elle l’empruntait à des corporations financières anglaises et même à la succursale de la banque internationale des Rothschild, par l'entremise de Nathan Mayer Rotschild, le membre de la famille établit en Angleterre. Deux siècles plus tard, l’Angleterre est un pays en crise qui, à l’exemple de la Grèce, s’apprête à recevoir les Jeux Olympiques, luxe et prestige que les peuples ne peuvent plus se payer. S’il y a une jeunesse aujourd’hui qui angoisse, c’est bien la jeunesse anglaise qui ne trouve plus de débouchés sur le sacrosaint marché du travail, même si la construction du parc olympique et de toutes les bébelles afférentes a créé, pour un bref laps de temps, un mini-boom dans la construction. Et comme les Anglais ne sont pas différents de nous, bien des enveloppes brunes ont dû circuler de Westminster à l’Hôtel de Ville, puis dans les mains des contracteurs pour que les miettes qui en restaient se redistribuent en salaires. «N’ayez pas peur, l’île est pleine de bruit», sera-t-il inscrit sur la cloche géante qui sonnera le coup d’envoi des Olympiques. Cette phrase tirée de La Tempête de Shakespeare, risque de signifier bien plus que les acclamations qui accueilleront William et de Kate, les petits princes mascottes de l’événement.Et la dette grecque? Ne voit-on pas à quel point tout cela n’est que supercherie? Comment Sarkozy et la grosse Angela peuvent-ils abolir du coup la moitié de la dette du pays avec l’espoir qu’Athènes parviendra à rembourser l’autre moitié? Ce n’est pas tant la Grèce qui préoccupe la France et l’Allemagne que l’intégrité même de l’Europe et de sa monnaie. La Grèce n’est que l’extrémité du cordon qui unit les pays méridionaux (le Portugal,
 l’Espagne, l’Italie) en tant que colonies des pays septentrionaux (la France, l’Allemagne et l’Angleterre). Au moment où se livre le conflit des archipels économiques, l’Europe ne ferait pas le poids entre les États-Unis, la Chine et l’Inde si elle devait revenir à cette mosaïque d’États compétitifs du début du XXe siècle. La dette grecque est un épouvantail pour les marchés mondiaux, et le peuple grec doit payer, comme l’âne de la fable, pour toutes les spéculateurs européens (dont une partie d’entre eux ont spéculé sur les intérêts et bénéfices des Jeux Olympiques d’Athènes). Ce sont ces braves «investisseurs» qui se sont trouvés emportés par la crise insensée de 2008. M. Duhaime, angoissé par son propre avenir de p’tit vieux, ne pourrait supporter l’effondrement du système capitaliste tant il croit qu’il existe pour l’amélioration de la condition humaine en laissant jouer les libertés individuelles et les forces du marché. Jeune, c’est déjà un vieillard doté de la vision du monde du XVIIIe siècle. Au moins, la gauche s’est délestée de Karl Marx!
l’Espagne, l’Italie) en tant que colonies des pays septentrionaux (la France, l’Allemagne et l’Angleterre). Au moment où se livre le conflit des archipels économiques, l’Europe ne ferait pas le poids entre les États-Unis, la Chine et l’Inde si elle devait revenir à cette mosaïque d’États compétitifs du début du XXe siècle. La dette grecque est un épouvantail pour les marchés mondiaux, et le peuple grec doit payer, comme l’âne de la fable, pour toutes les spéculateurs européens (dont une partie d’entre eux ont spéculé sur les intérêts et bénéfices des Jeux Olympiques d’Athènes). Ce sont ces braves «investisseurs» qui se sont trouvés emportés par la crise insensée de 2008. M. Duhaime, angoissé par son propre avenir de p’tit vieux, ne pourrait supporter l’effondrement du système capitaliste tant il croit qu’il existe pour l’amélioration de la condition humaine en laissant jouer les libertés individuelles et les forces du marché. Jeune, c’est déjà un vieillard doté de la vision du monde du XVIIIe siècle. Au moins, la gauche s’est délestée de Karl Marx!La solution solonienne, à laquelle les Américains ont recouru à plusieurs reprises par le passé - et on ne peut accuser les États-Unis d’être «socialistes» ou «communistes» - est ouvertement défendue devant le président Obama, car au montant où elle se chiffre, la dette américaine est tout simplement irremboursable! Ainsi, les jeunes seraient libérés de l’asservissement que suppose toutes dettes non
 payées sans que le pays ne tombe en récession. Au contraire, sortant du marasme où les Républicains l’ont enfermée depuis Nixon, Reagan et les deux Bush, l’économie américaine reprendrait de sa vigueur devant la compétition chinoise. Car il faut savoir ce que signifie vraiment cette «servitude» liée à la dette. Jadis, un individu incapable de rembourser sa dette se voyait réduit en esclavage, c’est-à-dire qu’il fournissait directement un travail plutôt que de l’argent ou ses biens. C’était le cas des indentured servant des colonies anglaises (engagés sous contrat) ou des «engagés» de la période de la Nouvelle-France qui a connu un régime semblable. La servitude systématisée restait une infâmie raciale. Encore aujourd’hui, dans de nombreux pays, ce système de servitude pour dettes existe toujours, bien que dénoncé par les conventions internationales. Dans le processus de régression dans lequel le monde occidental s’est engagé depuis deux siècles, et au Québec avec une rapidité froudroyante grâce à ses bons gouvernements libéraux et péquistes, la servitude, si elle ne se traduit pas par l’argent (comme les travaux communautaires, qui sont une forme de servitude), devient une menace de rejouer le vieux scénario où le débiteur fait travailler sa famille et ses enfants, et même ses descendants sur plusieurs générations, pour rembourser une dette dont les intérêts accumulés ne cesseront de s’amplifier malgré les efforts de remboursement. Les dettes sont ainsi contractées pour ne jamais être remboursées et peser de tous leur poids sur la société. En ce sens, le Fonds des générations de Charest est un miroir aux alouettes et s’y briser le bec, c’est précisément entraîner nos descendants dans la servitude financière, puisque son but dernier n’est pas d’éliminer la dette mais d’obtenir de meilleurs taux d’intérêts sur les prochains emprunts.
payées sans que le pays ne tombe en récession. Au contraire, sortant du marasme où les Républicains l’ont enfermée depuis Nixon, Reagan et les deux Bush, l’économie américaine reprendrait de sa vigueur devant la compétition chinoise. Car il faut savoir ce que signifie vraiment cette «servitude» liée à la dette. Jadis, un individu incapable de rembourser sa dette se voyait réduit en esclavage, c’est-à-dire qu’il fournissait directement un travail plutôt que de l’argent ou ses biens. C’était le cas des indentured servant des colonies anglaises (engagés sous contrat) ou des «engagés» de la période de la Nouvelle-France qui a connu un régime semblable. La servitude systématisée restait une infâmie raciale. Encore aujourd’hui, dans de nombreux pays, ce système de servitude pour dettes existe toujours, bien que dénoncé par les conventions internationales. Dans le processus de régression dans lequel le monde occidental s’est engagé depuis deux siècles, et au Québec avec une rapidité froudroyante grâce à ses bons gouvernements libéraux et péquistes, la servitude, si elle ne se traduit pas par l’argent (comme les travaux communautaires, qui sont une forme de servitude), devient une menace de rejouer le vieux scénario où le débiteur fait travailler sa famille et ses enfants, et même ses descendants sur plusieurs générations, pour rembourser une dette dont les intérêts accumulés ne cesseront de s’amplifier malgré les efforts de remboursement. Les dettes sont ainsi contractées pour ne jamais être remboursées et peser de tous leur poids sur la société. En ce sens, le Fonds des générations de Charest est un miroir aux alouettes et s’y briser le bec, c’est précisément entraîner nos descendants dans la servitude financière, puisque son but dernier n’est pas d’éliminer la dette mais d’obtenir de meilleurs taux d’intérêts sur les prochains emprunts.Le problème n’est donc pas nouveau et reste lié, nous l’avons dit, au capitalisme et surtout aux échanges marchands. Solon n’a pas été reconnu comme l’un des Sept Sages de l’Antiquité sans raison. M. Duhaime ne sera jamais Solon. Voici pourquoi. Afin de ne pas teinter ce texte d’une partisannerie de gauche qui le discréditerait aux yeux de ceux qui sont allergiques au bourrage de crâne, j’aurai recours ici à des historiens de la Grèce ancienne de différentes époques et de différentes tendances idéologiques pour nous raconter le grand courage qu’eut Solon contre les créditeurs athéniens de son temps. Commençons par le vieux Gustave Glotz (1862-1935), un élève de l’École Normale supérieure de la rue d’Ulm. Ce dernier écrivait dans La Cité grecque (1928, rééd. 1968) : «Athènes trouva encore une fois l’homme capable de résoudre le problème qui
 l’angoissait, Solon, se dressant entre les adversaires “ainsi qu’une borne”, insensible aux attaques venant des deux parts, fit ce qu’on pourrait appeler une révolution mitigée. D’un coup, il supprima les barrières qui tenaient les Eupatrides à l’écart des autres classes et abritaient les prérogatives traditionnelles des génè. Pour affranchir la terre, il prit une mesure générale et immédiate, l’“exonération” des hectémores (seîsachtheia), en même temps qu’il supprimait tous les restes de la propriété collective et mobilisait le sol par une série de lois sur la constitution de dot, le droit de succession et la liberté de tester. Pour affranchir l’individu, il limita la puissance paternelle, mais surtout en interdit la servitude pour dettes sous toutes les formes, y compris la servitude pénale, et proclama ainsi l’habeas corpus du citoyen athénien. Comprenant bien que l’agriculture ne suffisait pas à nourrir une population nombreuse dans un pays naturellement pauvre, il s’efforça de donner une vigoureuse impulsion au commerce et à l’industrie en attirant du dehors les gens de métier, en protégeant les métèques, en faisant une réforme monétaire qui ouvrait des voies nouvelles à la marine marchande» (G. Glotz. La cité grecque, Paris, Albin Michel, Col. L’Évolution de l’humanité, #1, 1968, p. 132) Le professeur Glotz nous apparaît bien comme un intellectuel libéral seulement par sa présentation de Solon-le-libérateur.
l’angoissait, Solon, se dressant entre les adversaires “ainsi qu’une borne”, insensible aux attaques venant des deux parts, fit ce qu’on pourrait appeler une révolution mitigée. D’un coup, il supprima les barrières qui tenaient les Eupatrides à l’écart des autres classes et abritaient les prérogatives traditionnelles des génè. Pour affranchir la terre, il prit une mesure générale et immédiate, l’“exonération” des hectémores (seîsachtheia), en même temps qu’il supprimait tous les restes de la propriété collective et mobilisait le sol par une série de lois sur la constitution de dot, le droit de succession et la liberté de tester. Pour affranchir l’individu, il limita la puissance paternelle, mais surtout en interdit la servitude pour dettes sous toutes les formes, y compris la servitude pénale, et proclama ainsi l’habeas corpus du citoyen athénien. Comprenant bien que l’agriculture ne suffisait pas à nourrir une population nombreuse dans un pays naturellement pauvre, il s’efforça de donner une vigoureuse impulsion au commerce et à l’industrie en attirant du dehors les gens de métier, en protégeant les métèques, en faisant une réforme monétaire qui ouvrait des voies nouvelles à la marine marchande» (G. Glotz. La cité grecque, Paris, Albin Michel, Col. L’Évolution de l’humanité, #1, 1968, p. 132) Le professeur Glotz nous apparaît bien comme un intellectuel libéral seulement par sa présentation de Solon-le-libérateur.L’historien Pierre Lévêque (1921-2004), de tendance marxiste mais proche de Fernand Braudel, nous rappelle plutôt la tension qui existait dans la société athénienne entre les débiteurs et les créditeurs à la veille de la réforme de Solon: «Mais ce qui provoque fondamentalement la tension sociale c’est l’inégalité dans la répartition de la propriété foncière. Seul Solon, chargé d’un accord unanime, de remettre l’ordre dans la cité (594/593?), ose s’attaquer de front à ce problème. Par la seisachtheia
 (remise du fardeau), mesure révolutionnaire dont le détail est fort mal connu, il supprime la contrainte par corps pour dettes dont avaient été victimes tant de petites gens, réduits en esclavage par les nantis; il libère les asservis et la “grasse terre de la patrie” dont il arrache les bornes hypothécaires. C’est la première fois dans le monde grec qu’est prise une mesure aussi hardie, faisant si délibérément passer les intérêts de l’État avant ceux des particuliers, des grands propriétaires en l’occurrence, dépouillés de leurs iniques acquisitions des dernières décennies. Les hectémores disparaissent, sans doute remis en possession de leurs terres». (P. Lévêque. L’aventure grecque, Paris, Armand Colin, Col. Destins du monde, 1964, p. 187). On le voit, le Sage Solon n’arrive même pas à la cheville d’Amir Khadir, qui serait sans doute pour l’abolition de la dette pour les pays du Tiers-Monde mais hésiterait à l’abolition de la dette au Québec.
(remise du fardeau), mesure révolutionnaire dont le détail est fort mal connu, il supprime la contrainte par corps pour dettes dont avaient été victimes tant de petites gens, réduits en esclavage par les nantis; il libère les asservis et la “grasse terre de la patrie” dont il arrache les bornes hypothécaires. C’est la première fois dans le monde grec qu’est prise une mesure aussi hardie, faisant si délibérément passer les intérêts de l’État avant ceux des particuliers, des grands propriétaires en l’occurrence, dépouillés de leurs iniques acquisitions des dernières décennies. Les hectémores disparaissent, sans doute remis en possession de leurs terres». (P. Lévêque. L’aventure grecque, Paris, Armand Colin, Col. Destins du monde, 1964, p. 187). On le voit, le Sage Solon n’arrive même pas à la cheville d’Amir Khadir, qui serait sans doute pour l’abolition de la dette pour les pays du Tiers-Monde mais hésiterait à l’abolition de la dette au Québec.Une autre helléniste, Claude Mossé (née en 1925), nourrit notre connaissance de l’amplitude du geste de Solon. «La crise allait cependant éclater peu après, à laquelle demeure attaché le nom de Solon. Sur cette crise, à l’exception des poèmes politiques de Solon [comme Mao, Solon avait des velléités de poète] dont l’interprétation n’est pas toujours facile [celle de Mao non plus], nous ne possédons que des témoignages tardifs qui ont pu fausser le sens réel des événements. Deux faits semblent en rendre compte : d’une part la situation de dépendants, d’hectémores (c’est-à-dire astreints au paiement du sixième), dans laquelle se trouvaient placés la plus grande partie des paysans athéniens; d’autre part l’endettement grandissant de la masse paysanne et la menace de
 réduction en esclavage qui pesait sur elle. Les deux faits sont évidemment liés, mais il n’est pas toujours aisé de reconstituer le processus qui va de l’un à l’autre. Devient-on hectémore par endettement, ou bien la dette résulte-t-elle de l’impossibilité à s’acquitter [ce qui serait le cas des États-Unis actuellement] du fermage du sixième? Problème presque insoluble, mais qui en tout cas débouche sur une situation de crise qui atteint son paroxysme dans les premières années du VIe siècle. Solon, élu archonte en 594, allait entreprendre de la résoudre. Lui-même appartenait à l’aristocratie, mais, soit par tempérament, soit par nécessité, il avait été amené à “voyager”, ce qui le plaçait un peu en marge de l’aristocratie traditionnelle. Conscient des menaces que représentait une certaine agitation paysanne qui aurait pu déboucher sur la tyrannie, refusant quant à lui de devenir tyran, il proclame la siesachtetia, c’est-à-dire la “levée du fardeau”, arrachant des champs les bornes qui concrétisaient l’état de dépendance de leurs propriétaires, supprimant du même coup les dettes et interdisant pour l’avenir la contrainte par corps, s’attachant pour le présent à faire revenir en Attique tous ceux qui, réduits en esclavage, avaient été vendus au dehors. […] Un fait demeure certain : si Solon, en proclamant la seisachteia, libérait les paysans athéniens d’un état de dépendance dont il ne sera plus jamais question par la suite dans l’histoire d’Athènes, il se refusait à accomplir l’acte que le plus grand nombre d’entre eux réclamaient : le partage du sol de la patrie. On est ici tenté de s’interroger : qu’une telle revendication ait existé, on n’en peut douter, le témoignage de Solon en fait foi. Mais comment avait-elle pu devenir la revendication fondamentale de la masse du démos athénien, quel “modèle” avait pu l’inspirer?» (C. Mossé. Histoire d’une démocratie : Athènes, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, #H1, 1971, pp. 16-17) Qu’est-ce à dire? L’abolition unilatérale par l’État des dettes ne signifie pas pour autant le partage équitable des richesses. Si les termes de «libéraux» et de «communistes» seraient anachroniques utilisés dans le contexte de la Grèce antique, il est clair que le «moment Solon» signifie une prise en charge de l’État, mais que cette mesure vise précisément à empêcher la crise de dégénérer en guerre civile.
réduction en esclavage qui pesait sur elle. Les deux faits sont évidemment liés, mais il n’est pas toujours aisé de reconstituer le processus qui va de l’un à l’autre. Devient-on hectémore par endettement, ou bien la dette résulte-t-elle de l’impossibilité à s’acquitter [ce qui serait le cas des États-Unis actuellement] du fermage du sixième? Problème presque insoluble, mais qui en tout cas débouche sur une situation de crise qui atteint son paroxysme dans les premières années du VIe siècle. Solon, élu archonte en 594, allait entreprendre de la résoudre. Lui-même appartenait à l’aristocratie, mais, soit par tempérament, soit par nécessité, il avait été amené à “voyager”, ce qui le plaçait un peu en marge de l’aristocratie traditionnelle. Conscient des menaces que représentait une certaine agitation paysanne qui aurait pu déboucher sur la tyrannie, refusant quant à lui de devenir tyran, il proclame la siesachtetia, c’est-à-dire la “levée du fardeau”, arrachant des champs les bornes qui concrétisaient l’état de dépendance de leurs propriétaires, supprimant du même coup les dettes et interdisant pour l’avenir la contrainte par corps, s’attachant pour le présent à faire revenir en Attique tous ceux qui, réduits en esclavage, avaient été vendus au dehors. […] Un fait demeure certain : si Solon, en proclamant la seisachteia, libérait les paysans athéniens d’un état de dépendance dont il ne sera plus jamais question par la suite dans l’histoire d’Athènes, il se refusait à accomplir l’acte que le plus grand nombre d’entre eux réclamaient : le partage du sol de la patrie. On est ici tenté de s’interroger : qu’une telle revendication ait existé, on n’en peut douter, le témoignage de Solon en fait foi. Mais comment avait-elle pu devenir la revendication fondamentale de la masse du démos athénien, quel “modèle” avait pu l’inspirer?» (C. Mossé. Histoire d’une démocratie : Athènes, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, #H1, 1971, pp. 16-17) Qu’est-ce à dire? L’abolition unilatérale par l’État des dettes ne signifie pas pour autant le partage équitable des richesses. Si les termes de «libéraux» et de «communistes» seraient anachroniques utilisés dans le contexte de la Grèce antique, il est clair que le «moment Solon» signifie une prise en charge de l’État, mais que cette mesure vise précisément à empêcher la crise de dégénérer en guerre civile.Claude Mossé est revenue, quelques années plus tard, sur le «moment Solon». Elle écrit ainsi: «Le cas des hectémores athéniens pose cependant un problème qu’on saurait d’autant moins esquiver que nous disposons d’une source contemporaine, les poèmes de Solon, l’homme qui allait à Athènes résoudre la
 crise, en particulier en supprimant la condition d’hectémore. Le législateur, en effet, […] se vante d’avoir libéré la terre “esclave”, en arrachant les bornes qui marquaient la dépendance de ceux qui la cultivaient, et d’avoir rendu “libres” ceux qui “subissaient ici même [à Athènes] une servitude indigne et tremblaient devant l’humeur de leurs maîtres” (Constitution d’Athènes, XV, 4). Or, il dit qu’Athènes était leur “patrie”. Il s’agissait donc bien de membres de la communauté athénienne, de membres du démos athénien que la misère seule avait réduits à la condition de dépendants. En les libérant, Solon les réintégrait dans la communauté, comme il réintégrait ceux qui, ne pouvant s’acquitter de leurs fermages, avaient été “vendus” à l’extérieur ou avaient délibérément choisi l’exil. La manière dont cette mesure fut concrètement appliquée reste un problème quasi insoluble. On a du mal, en effet, à imaginer comment Solon put faire revenir - et racheter - les gens vendus à l’extérieur. Et plus encore ce que fut le sort de ceux qui, libérés de la servitude qu’ils subissaient en Attique même, se retrouvaient néanmoins dans la même situation misérable, puisque Solon se refusa à opérer le partage égalitaire du sol que certains réclamaient. Faut-il admettre que les anciens hectémores demeurèrent en possession du cléros qu’ils cultivaient, mais sans avoir à subir la contrainte du sixième? Cette solution n’aurait pas été contradictoire avec le refus du partage égalitaire…» (C. Mossé. La Grèce archaïque d’Homère à Eschyle, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, #H74, 1984, p. 109).
crise, en particulier en supprimant la condition d’hectémore. Le législateur, en effet, […] se vante d’avoir libéré la terre “esclave”, en arrachant les bornes qui marquaient la dépendance de ceux qui la cultivaient, et d’avoir rendu “libres” ceux qui “subissaient ici même [à Athènes] une servitude indigne et tremblaient devant l’humeur de leurs maîtres” (Constitution d’Athènes, XV, 4). Or, il dit qu’Athènes était leur “patrie”. Il s’agissait donc bien de membres de la communauté athénienne, de membres du démos athénien que la misère seule avait réduits à la condition de dépendants. En les libérant, Solon les réintégrait dans la communauté, comme il réintégrait ceux qui, ne pouvant s’acquitter de leurs fermages, avaient été “vendus” à l’extérieur ou avaient délibérément choisi l’exil. La manière dont cette mesure fut concrètement appliquée reste un problème quasi insoluble. On a du mal, en effet, à imaginer comment Solon put faire revenir - et racheter - les gens vendus à l’extérieur. Et plus encore ce que fut le sort de ceux qui, libérés de la servitude qu’ils subissaient en Attique même, se retrouvaient néanmoins dans la même situation misérable, puisque Solon se refusa à opérer le partage égalitaire du sol que certains réclamaient. Faut-il admettre que les anciens hectémores demeurèrent en possession du cléros qu’ils cultivaient, mais sans avoir à subir la contrainte du sixième? Cette solution n’aurait pas été contradictoire avec le refus du partage égalitaire…» (C. Mossé. La Grèce archaïque d’Homère à Eschyle, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, #H74, 1984, p. 109).Ce nouveau pas nous oblige donc à tenir compte d’une chose - chose qui ne fut pas tenue compte ni lors de l’abolition du servage en Russie en 1860 par le Tsar Alexandre II, ni, simultanément, par le Président Lincoln avec son XIIIe Amendement, sur lequel
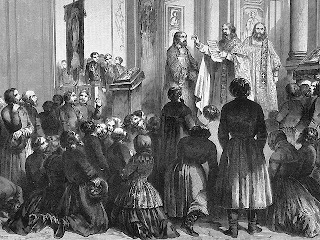 nous reviendrons, qui proclamait l’abolition de l’esclavage : après un contexte de centralisation des propriétés entre les mains de minorités dominantes, la libération, si elle dégage de la servitude des maîtres, ne dégage pas de la servitude de la nécessité. Alexandre et Lincoln furent tous deux assassinés, pour des raisons différentes, mais ces «réflexes politiques» ne font que confirmer la phrase célèbre de Tocqueville: «Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il commence à se réformer» (A. de Tocqueville. La fin de l’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, #5, 1967 p. 277). Les Américains comprirent, et centralisèrent le gouvernement de l’Union après la guerre civile, mais le régime tsariste prit la position réactionnaire et fut finalement débouté par la Révolution de Février 1917, une révolution «libérale» et tout ce qu'il y avait de plus bourgeois.
nous reviendrons, qui proclamait l’abolition de l’esclavage : après un contexte de centralisation des propriétés entre les mains de minorités dominantes, la libération, si elle dégage de la servitude des maîtres, ne dégage pas de la servitude de la nécessité. Alexandre et Lincoln furent tous deux assassinés, pour des raisons différentes, mais ces «réflexes politiques» ne font que confirmer la phrase célèbre de Tocqueville: «Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d'ordinaire celui où il commence à se réformer» (A. de Tocqueville. La fin de l’Ancien Régime et la Révolution, Paris, Gallimard, Col. Folio-Histoire, #5, 1967 p. 277). Les Américains comprirent, et centralisèrent le gouvernement de l’Union après la guerre civile, mais le régime tsariste prit la position réactionnaire et fut finalement débouté par la Révolution de Février 1917, une révolution «libérale» et tout ce qu'il y avait de plus bourgeois.Pourtant, c’est avec le XIIIe Amendement voté au Congrès sous la pression du Président Lincoln, que les États-Unis réagirent dans un esprit solonien. Voté bien après l’assassinat du Président, le 18 décembre 1865, la Section I de l’Amendement prescrit: «Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce
 n’est en punition de crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction». (Cité in A. Kaspi. Les Américains, t. 2 : Les États-Unis de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, #H90, p. 634). Comme les États occidentaux suivent le même principe, nous y retrouvons le châtiment des travaux communautaires (si ce n’est en punition de crime) et renvoie la dette à la servitude volontaire. Or, la question qui se pose est la suivante: jusqu’à quel point une population, même en régime démocratique, est-elle débitrice des engagements de son gouvernement avec des corporations internes ou externes? L’État est-il plus que la somme de ses citoyens, ou n’est-il que le représentant désigné par un processus électoral (démocratie) qui établit une distance entre le démos et ses engagements en tant qu'État? Auquel cas, la servitude «volontaire» passerait facilement à l’état de servitude «involontaire» et par le fait même à une réduction à l’esclavage, sentiment angoissant qui torpille l’intérieur des tripes de M. Duhaime.
n’est en punition de crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction». (Cité in A. Kaspi. Les Américains, t. 2 : Les États-Unis de 1945 à nos jours, Paris, Seuil, Col. Points-Histoire, #H90, p. 634). Comme les États occidentaux suivent le même principe, nous y retrouvons le châtiment des travaux communautaires (si ce n’est en punition de crime) et renvoie la dette à la servitude volontaire. Or, la question qui se pose est la suivante: jusqu’à quel point une population, même en régime démocratique, est-elle débitrice des engagements de son gouvernement avec des corporations internes ou externes? L’État est-il plus que la somme de ses citoyens, ou n’est-il que le représentant désigné par un processus électoral (démocratie) qui établit une distance entre le démos et ses engagements en tant qu'État? Auquel cas, la servitude «volontaire» passerait facilement à l’état de servitude «involontaire» et par le fait même à une réduction à l’esclavage, sentiment angoissant qui torpille l’intérieur des tripes de M. Duhaime.La dette nationale est une réduction de la société et de son État en état de servitude et on ne le constate jamais aussi bien que dans les relations des corporations financières mondiales et les pays dits du Tiers-Monde, endettés et insolvables. On connaît les conditions de prédation qui souvent accompagnent ces prêts du F.M.I. et de la Banque mondiale.
 Au XIXe siècle, l’Angleterre, la France et l’Espagne jouèrent un jeu identique avec des pays d’Amérique latine, en particulier le Mexique. L’endettement extérieur était utilisé comme instrument de domination des peuples de l’Amérique latine et des Caraïbes, de l’Asie et de l’Afrique et certains de ces pays de la Périphérie refusèrent de rembourser une dette injuste. Le Mexique, par exemple, en 1861, sous le premier président indigène de l’Amérique latine, l’Indien Benito Juárez, refusa de payer les dettes étrangères. La France impérialiste de Napoléon III envoya son armée dirigée par Bazaine mettre un pion à la tête de l'État
Au XIXe siècle, l’Angleterre, la France et l’Espagne jouèrent un jeu identique avec des pays d’Amérique latine, en particulier le Mexique. L’endettement extérieur était utilisé comme instrument de domination des peuples de l’Amérique latine et des Caraïbes, de l’Asie et de l’Afrique et certains de ces pays de la Périphérie refusèrent de rembourser une dette injuste. Le Mexique, par exemple, en 1861, sous le premier président indigène de l’Amérique latine, l’Indien Benito Juárez, refusa de payer les dettes étrangères. La France impérialiste de Napoléon III envoya son armée dirigée par Bazaine mettre un pion à la tête de l'État  mexicain, l’archiduc Maximilien de Habsbourg, frère puîné de l’Empereur d’Autriche. Juarez mena une guerre de résistance. Sortis de leur guerre civile, les Américains envoyèrent une note diplomatique à Napoléon III qui s'empressa de retirer ses troupes, abandonnant le pauvre Maximilien au peloton d’exécution. Au cours des années 1930, ce ne sont pas moins de quatorze gouvernements d’Amérique latine qui décidèrent les uns après les autres, sans concertation, d’arrêter de payer la dette extérieure due principalement à des Européens et à des Nord-Américains. Ces pays savaient très bien que les compagnies et les gouvernements continueraient à venir y faire de la prédation de matières premières et à s’établir en vue de faire des profits. Que valait donc le poids de la dette, en plein krash boursier de 1929, pour que les puissances occidentales se laissent ainsi déposséder de leurs précieuses dettes?
mexicain, l’archiduc Maximilien de Habsbourg, frère puîné de l’Empereur d’Autriche. Juarez mena une guerre de résistance. Sortis de leur guerre civile, les Américains envoyèrent une note diplomatique à Napoléon III qui s'empressa de retirer ses troupes, abandonnant le pauvre Maximilien au peloton d’exécution. Au cours des années 1930, ce ne sont pas moins de quatorze gouvernements d’Amérique latine qui décidèrent les uns après les autres, sans concertation, d’arrêter de payer la dette extérieure due principalement à des Européens et à des Nord-Américains. Ces pays savaient très bien que les compagnies et les gouvernements continueraient à venir y faire de la prédation de matières premières et à s’établir en vue de faire des profits. Que valait donc le poids de la dette, en plein krash boursier de 1929, pour que les puissances occidentales se laissent ainsi déposséder de leurs précieuses dettes?Alors, pourquoi tant de flon-flon avec la question de la dette? C’est que la dette est un élément important du mythe capitaliste. Cesser de croire à la dette, c’est rompre le lien de servitude qui nous tient rivé au système économique. C’est cesser de croire qu’il assure notre sécurité et notre existence. Nous ayant aliénés par la consommation de produits de luxe aux nécessités superficielles, les ayant transformés en objets transitionnels pour adultes dans une phase de régression sadique-orale, nous devrions nous sentir lier au capitalisme comme un enfant à sa mère, donc dans un état de dépendance affective par nos angoisses d’abandon et de manque de sevrage, bref menacés par la mort par inanition. Telle est la nature de l’angoisse de la jeunesse, incertaine entre l’adolescence et la maturité; telle est la nature de l’angoisse particulière de M. Duhaime, qui veut plus de liberté pour plus de consommation capitaliste, pour plus de REER pour assurer ses vieux jours à la Résidence Soleil, pour quel type de mort, au fait, mériterait-il?
Ce monsieur voudrait servir de mentor à une jeunesse constituée de Yuppies et de Youppi, de Bobo ou de Laidlaid, bref, l’immaturité qu’enrobe son débitage de détails financiers montre à quel point est nocive cette nouvelle droite qui se refuse à se reconnaître comme «conservatrice». Pourtant, elle l’est. Il y a une bonne chose à être conservateur, protéger les acquis de la société, de la civilisation, l’adoucissement des mœurs comme disait Voltaire, avoir suffisamment de sécurité pour ouvrir le champ à plus de libertés. Mais dès que le soucis conservateur
 devient l’idéologie conservatrice, c’est la gangrène qui se met de la partie. La nécrose se répand, commençant par pourrir la tête, comme chez les poissons, remontant les membres jusqu’à réduire la culture en un état de putréfaction. Le Kitch est un état d’expression culturelle qui contient de ces traces de putréfaction; l’idolâtrie d’objets de facture industrielle, collectionnés comme mosaïques d’art populaire. Les partis politiques, et là-dessus M. Duhaime ne fait que constater ce que tout le monde observe, sont de mauvaises répétitions shakespeariennes de la lutte pour le pouvoir: Pauline Marois en Richard III qui poignarde Duceppe dans le dos avant que Duceppe ne la poignarde le premier, il n’y a pas là quoi faire une tragédie historique mais un drame burlesque. Vite qu’on appelle les danseuses de cancan! On pourrait dire de L’État contre la jeunesse ce qu’on disait naguère du livre du biologiste Monod: un livre écrit par hasard et sans nécessité.
devient l’idéologie conservatrice, c’est la gangrène qui se met de la partie. La nécrose se répand, commençant par pourrir la tête, comme chez les poissons, remontant les membres jusqu’à réduire la culture en un état de putréfaction. Le Kitch est un état d’expression culturelle qui contient de ces traces de putréfaction; l’idolâtrie d’objets de facture industrielle, collectionnés comme mosaïques d’art populaire. Les partis politiques, et là-dessus M. Duhaime ne fait que constater ce que tout le monde observe, sont de mauvaises répétitions shakespeariennes de la lutte pour le pouvoir: Pauline Marois en Richard III qui poignarde Duceppe dans le dos avant que Duceppe ne la poignarde le premier, il n’y a pas là quoi faire une tragédie historique mais un drame burlesque. Vite qu’on appelle les danseuses de cancan! On pourrait dire de L’État contre la jeunesse ce qu’on disait naguère du livre du biologiste Monod: un livre écrit par hasard et sans nécessité.Tout ce que nous pouvons souhaiter, c’est que la jeunesse québécoise trouve un meilleur mentor que ce M. Duhaime. Si on ne sait pas se cultiver soi-même pour mieux comprendre le monde, on ne peut que nuire et n’être utile en rien à l’éducation des autres. C’est un type pour qui la liberté représente des gros sous et qui croit dans la mythologie capitaliste comme nous, jadis, croyions en la mythologie catholique. Il n’y a pas plus de Dieu à la bourse que dans le tabernacle : il n’y a que notre dépendance affective à des symboles de mort. Voilà un «anarchiste (de droite)» plutôt singulier. Peut-être ferait-il mieux de méditer cette phrase du grand philosophe revendiqué par les néo-libéraux, Tocqueville, qui disait, avec la sagesse de Solon: «Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle-même est fait pour servir» (Tocqueville. ibid. p. 267)⌛
Montréal,
30 janvier 2012
30 janvier 2012

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire