
BÉOTIENS ET PHILISTINS CHEZ «INDIANA JONES»
Le Centre des sciences de Montréal - rien de moins! - inaugurait en grandes pompes une exposition itinérante, entièrement «conçue» à Montréal, avec la bénédiction de la multinationale Lucasfilms, Indiana Jones et l’aventure de l’archéologie. Cet amas d’artéfacts authentiques et cinématographiques présenté comme une entreprise «scientifique» mettant en valeur la science archéologique s’appelle, tout simplement, «péter plus haut que le trou». Faire du vrai avec du faux, donner à la fausse monnaie la valeur de la vraie. On a déjà exécuté publiquement des gens pour avoir fabriqué de telles fausses monnaies. Je veux bien, avec Alexandre Dumas père, qu’on s’autorise «à violer l’Histoire à condition de lui faire de beaux enfants», mais jamais Dumas n’a eu la prétention de faire œuvre «scientifique» avec ses Trois Mousquetaires.
La confusion du vrai et du faux est un passe-temps compulsif qui a donné naissance au roman policier. Chez Edgar Poe, ça restait une enquête entièrement confiée à l’opération logique
 considérée «comme un des beaux-arts». Walter Scott, suivi de Fenimore Cooper en Amérique et d’Alexandre Dumas père en France, avait tracé les règles du roman historique dont le but essentiel était de recomposer la «couleur locale» selon les endroits et selon les temps. Contrairement aux drames historiques (ceux de Shakespeare par exemples), il ne mettait pas à l’avant-scène les personnages historiques et se contentait de les présenter comme des figurants. En avant, on retrouvait des personnages mythiques ou semi-mythiques: Robin Hood, Ivanohé, et quelques autres Mourons rouges du genre. Fi des Richard III, cardinal de Richelieu ou Saint-Just. Il en va encore de même du célèbre roman épique de Tolstoï, Guerre et Paix. Tous ces romans avaient pour but de présenter des thèmes: la guerre des barons contre le despotisme d’un méchant prince; les roueries d’un ministre-cardinal sans scrupules, l’affrontement de deux peuples, de deux forces idéologiques dans un combat de Titans. Peu importait que des événements vrais s’entremêlassent à d’autres, plutôt fictifs, les lecteurs ne cherchant pas les anachronismes dans les œuvres de fictions, car elles étaient ce qu’elles étaient, des produits du rêve, de l’imagination et, déjà, d'un certain vœu de dépaysement bourgeois.
considérée «comme un des beaux-arts». Walter Scott, suivi de Fenimore Cooper en Amérique et d’Alexandre Dumas père en France, avait tracé les règles du roman historique dont le but essentiel était de recomposer la «couleur locale» selon les endroits et selon les temps. Contrairement aux drames historiques (ceux de Shakespeare par exemples), il ne mettait pas à l’avant-scène les personnages historiques et se contentait de les présenter comme des figurants. En avant, on retrouvait des personnages mythiques ou semi-mythiques: Robin Hood, Ivanohé, et quelques autres Mourons rouges du genre. Fi des Richard III, cardinal de Richelieu ou Saint-Just. Il en va encore de même du célèbre roman épique de Tolstoï, Guerre et Paix. Tous ces romans avaient pour but de présenter des thèmes: la guerre des barons contre le despotisme d’un méchant prince; les roueries d’un ministre-cardinal sans scrupules, l’affrontement de deux peuples, de deux forces idéologiques dans un combat de Titans. Peu importait que des événements vrais s’entremêlassent à d’autres, plutôt fictifs, les lecteurs ne cherchant pas les anachronismes dans les œuvres de fictions, car elles étaient ce qu’elles étaient, des produits du rêve, de l’imagination et, déjà, d'un certain vœu de dépaysement bourgeois.Avec l’invention du cinéma, la capacité technique de reproduire le réel sur pellicule donna l’idée de filmer «les actualités». La grande frustration était lorsque se déroulait un événement de portée historique sans qu’un appareil photo ou une caméra n’ait pu le saisir pour le transmettre «wie es eigentlich gewesen», tel qu’il s’était passé, pour reprendre l’objectif épistémique de l’historien Leopold von Ranke. Aussi, pour
 palier à la frustration, on s’arrangea pour reproduire l’événement en studio - l’assassinat du président William McKinley en 1901 par exemple -, puis, suivant la même logique, on filma des crimes historiques - l’assassinat du duc de Guise -, et, de l’actualité, on passa tout naturellement à l’historique. Le cinéma historique relayait le roman. Personne ne soulignait que les gestes emphatiques des personnages d’actualité ou d’histoire filmés en studio répondaient aux critères esthétiques du cinéma muet et non à ce qui s’était vraiment passé. On savait bien que derrière la fiction s’était déroulé un événement authentique et qu’il n’y avait aucune commune mesure entre ce qu’on voyait sur l’écran et ce que les témoins avaient vu. Comme dans la parabole, on rendait à la fiction ce qui appartenait à la fiction et à la vérité ce qui appartenait à la vérité.
palier à la frustration, on s’arrangea pour reproduire l’événement en studio - l’assassinat du président William McKinley en 1901 par exemple -, puis, suivant la même logique, on filma des crimes historiques - l’assassinat du duc de Guise -, et, de l’actualité, on passa tout naturellement à l’historique. Le cinéma historique relayait le roman. Personne ne soulignait que les gestes emphatiques des personnages d’actualité ou d’histoire filmés en studio répondaient aux critères esthétiques du cinéma muet et non à ce qui s’était vraiment passé. On savait bien que derrière la fiction s’était déroulé un événement authentique et qu’il n’y avait aucune commune mesure entre ce qu’on voyait sur l’écran et ce que les témoins avaient vu. Comme dans la parabole, on rendait à la fiction ce qui appartenait à la fiction et à la vérité ce qui appartenait à la vérité.Aujourd’hui, la capacité de confondre le réel et le fictif que nous procure les nouvelles
 technologies cinématographiques et télévisuelles font qu’il est de plus en plus difficile de distinguer où s’arrête la vérité et où commence la fiction. Orson Welles s’est amusé à confondre ses spectateurs dans plusieurs de ses films. Au-delà de l’amusement spectaculaire, il y avait là un sérieux avertissement. Les enquêtes d’historiens ont également révélé des faux que l’on avait tenus longtemps pour des vrais. Ainsi, Marc Ferro nous montre, grammaire du cinéma en main, que la plupart, sinon la quasi totalité, des films tournés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale l’avait été dans des studios. Déjà, le célèbre photographe ambulant de la Guerre de Sécession, Matthew Brady, avait «maquillé» les corps de soldats morts, les disposant selon un «code d’honneur» qui veut qu’on ne représente pas un soldat mort, la face couchée contre terre, afin de ne laisser nulle place à un quelconque soupçon de lâcheté. Toutes ces révélations nous forcent aujourd’hui à regarder ces «témoignages» des temps passés sur des événements qui nous marquaient profondément.
technologies cinématographiques et télévisuelles font qu’il est de plus en plus difficile de distinguer où s’arrête la vérité et où commence la fiction. Orson Welles s’est amusé à confondre ses spectateurs dans plusieurs de ses films. Au-delà de l’amusement spectaculaire, il y avait là un sérieux avertissement. Les enquêtes d’historiens ont également révélé des faux que l’on avait tenus longtemps pour des vrais. Ainsi, Marc Ferro nous montre, grammaire du cinéma en main, que la plupart, sinon la quasi totalité, des films tournés sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale l’avait été dans des studios. Déjà, le célèbre photographe ambulant de la Guerre de Sécession, Matthew Brady, avait «maquillé» les corps de soldats morts, les disposant selon un «code d’honneur» qui veut qu’on ne représente pas un soldat mort, la face couchée contre terre, afin de ne laisser nulle place à un quelconque soupçon de lâcheté. Toutes ces révélations nous forcent aujourd’hui à regarder ces «témoignages» des temps passés sur des événements qui nous marquaient profondément.Aujourd’hui, c’est un autre type d’anachronisme que l’on chasse. C’est la fameuse montre bracelet au poignet d’un légionnaire romain dans le film Ben-Hur.
 C’est aussi la ligne blanche d’un avion dans le ciel en haute altitude. Une forme de sandale qui n’existait pas à l’époque romaine… Cherchant une information sur la série anglo-irlando-canadienne The Tudors, je suis tombé sur un site web où étaient emmagasinés tous les anachronismes qu’on avait pu repérer dans les épisodes des quatre années de la série. Ce travail compulsif - je me demande quel plaisir on peut tirer de la série à s’astreindre à la scruter ainsi à la loupe? - m’apparaît plutôt vain car dès le départ, l’anachronisme est flagrant. En quoi ce jeune acteur irlandais et alcoolique peut-il évoquer le gros barbu joufflu que les tableaux de Holbein nous ont laissé? Il faut faire abstraction de ce premier anachronisme pour ensuite ne plus s’arrêter à en repérer d’autres. Il est clair que la série ne peut reconstituer wie es eigentlich gewesen le règne du gros Henry et de ses six femmes. Dans le film
C’est aussi la ligne blanche d’un avion dans le ciel en haute altitude. Une forme de sandale qui n’existait pas à l’époque romaine… Cherchant une information sur la série anglo-irlando-canadienne The Tudors, je suis tombé sur un site web où étaient emmagasinés tous les anachronismes qu’on avait pu repérer dans les épisodes des quatre années de la série. Ce travail compulsif - je me demande quel plaisir on peut tirer de la série à s’astreindre à la scruter ainsi à la loupe? - m’apparaît plutôt vain car dès le départ, l’anachronisme est flagrant. En quoi ce jeune acteur irlandais et alcoolique peut-il évoquer le gros barbu joufflu que les tableaux de Holbein nous ont laissé? Il faut faire abstraction de ce premier anachronisme pour ensuite ne plus s’arrêter à en repérer d’autres. Il est clair que la série ne peut reconstituer wie es eigentlich gewesen le règne du gros Henry et de ses six femmes. Dans le film  de Jarrott de 1969, Anne of the Thousand Days, Richard Burton pouvait être pris encore pour Henry VIII; avec The Tudors, malgré l’excellente reconstitution de la «couleur locale», on ne peut prendre au sérieux Jonathan Rhys-Meyers pour le roi Barbe-Bleue. Mais, dans une fiction, il aurait pu être n’importe quel roi: aussi bien François Ier que Charles-Quint; aussi bien le jeune Louis XIV que le jeune François-Joseph. Comme à l’opéra, où l’on accepte que l’invraisemblable soit tenu pour vrai, la série télé nous présente un invraisemblable dont on ne tire qu’un certain plaisir qu’à condition de le tenir pour vrai. Mais ce n’est qu’une histoire, comme on dit, «arrangée avec le gars des vues». Le repérage des artefacts anachroniques devient donc, par le fait même superflu. Ce n’est qu’une autre «fausse curiosité».
de Jarrott de 1969, Anne of the Thousand Days, Richard Burton pouvait être pris encore pour Henry VIII; avec The Tudors, malgré l’excellente reconstitution de la «couleur locale», on ne peut prendre au sérieux Jonathan Rhys-Meyers pour le roi Barbe-Bleue. Mais, dans une fiction, il aurait pu être n’importe quel roi: aussi bien François Ier que Charles-Quint; aussi bien le jeune Louis XIV que le jeune François-Joseph. Comme à l’opéra, où l’on accepte que l’invraisemblable soit tenu pour vrai, la série télé nous présente un invraisemblable dont on ne tire qu’un certain plaisir qu’à condition de le tenir pour vrai. Mais ce n’est qu’une histoire, comme on dit, «arrangée avec le gars des vues». Le repérage des artefacts anachroniques devient donc, par le fait même superflu. Ce n’est qu’une autre «fausse curiosité».Les musées, endroits académiques par excellence depuis toujours, afin d’attirer une clientèle qui autrement les déserterait par manque de «divertissements», se sont engagés depuis plus d’une dizaine d’années à présenter des expositions où se côtoient
 le vrai et le faux. Si je m’en tiens à la ville de Montréal seulement, on a connu l’exposition Hergé, l’exposition Snoopy et maintenant (en en passant sur plusieurs autres), l’exposition Indiana Jones. Laissons de côté Snoopy et bornons-nous entre Tintin et Indiana Jones, dont le second n’est qu’un sous-produit du premier. L’exposition Hergé avait encore de la tenue, dans la mesure où une œuvre culturelle maintenant mondialement enracinée, racontait une histoire quand même crédible. Une histoire qui fut celle d’Albert Londres au début du XXe siècle. Une histoire qui n’avait pas d’autres buts que d’éveiller une jeunesse de bon aloi
le vrai et le faux. Si je m’en tiens à la ville de Montréal seulement, on a connu l’exposition Hergé, l’exposition Snoopy et maintenant (en en passant sur plusieurs autres), l’exposition Indiana Jones. Laissons de côté Snoopy et bornons-nous entre Tintin et Indiana Jones, dont le second n’est qu’un sous-produit du premier. L’exposition Hergé avait encore de la tenue, dans la mesure où une œuvre culturelle maintenant mondialement enracinée, racontait une histoire quand même crédible. Une histoire qui fut celle d’Albert Londres au début du XXe siècle. Une histoire qui n’avait pas d’autres buts que d’éveiller une jeunesse de bon aloi  à rêver de voyages exotiques et d’aventures (non galantes!). Hergé promenait ainsi son jeune reporter d’un lieu étranger à l’autre: du pays des Soviets au Congo, de l’Amérique à l’Égypte des pharaons, à l’Inde des Maharadjas, à la Chine sous occupation japonaise; de l’Amérique amazonienne à l’Écosse folklorique aux rivalités dictatoriales d’Europe centrale, au trafic d’opium en Afrique du Nord; de la chute d’un aérolithe en plein océan nordique aux combats de pirates; de la chasse au trésor à la survivance des rites andins puis du royaume pétrolifère à la lune; de l’espionnage de la Guerre Froide au trafic négrier et aux lamaseries du Tibet; du monde de la télévision à une île volcanique survolée par un OVNI, à une farandole sud-américaine et, enfin, dans le marché des œuvres d’art. L’univers de Tintin restait celui de la rencontre du possible et du fantastique. Celui d’Indiana Jones en est tout le contraire: c’est la rencontre de l’impossible et du merveilleux.
à rêver de voyages exotiques et d’aventures (non galantes!). Hergé promenait ainsi son jeune reporter d’un lieu étranger à l’autre: du pays des Soviets au Congo, de l’Amérique à l’Égypte des pharaons, à l’Inde des Maharadjas, à la Chine sous occupation japonaise; de l’Amérique amazonienne à l’Écosse folklorique aux rivalités dictatoriales d’Europe centrale, au trafic d’opium en Afrique du Nord; de la chute d’un aérolithe en plein océan nordique aux combats de pirates; de la chasse au trésor à la survivance des rites andins puis du royaume pétrolifère à la lune; de l’espionnage de la Guerre Froide au trafic négrier et aux lamaseries du Tibet; du monde de la télévision à une île volcanique survolée par un OVNI, à une farandole sud-américaine et, enfin, dans le marché des œuvres d’art. L’univers de Tintin restait celui de la rencontre du possible et du fantastique. Celui d’Indiana Jones en est tout le contraire: c’est la rencontre de l’impossible et du merveilleux.Dans ce changement, la vérité y perd au change sans que la fiction ne s’enrichisse pour autant. Hergé s’inspirait des découvertes de son époque; il se
 documentait, s’informait auprès des experts, rendait l’imaginaire vraisemblable. Le fétiche Arumbaya de L’Oreille cassée comme la momie inca de Rascar Capac dans Les Sept boules de cristal ne sont pas que des objets transitionnels comme peuvent l’être l’Arche d’Alliance ou le Graal d’Indiana Jones. Qu’un expert archéologue déclare sur les ondes de Radio-Canada, en se forçant, que ces objets, parce qu’ils ont été véhiculés par des mythes, aient pu avoir une existence réelle, c’est une induction qui jette poudre aux yeux en vue de rendre les scénaristes de Lucas aussi scrupuleux qu’Hergé. Les artefacts d’Hergé servaient de moyens, de truchements qui permettaient d’entrer en contact avec une autre civilisation. Certes, on a reproché à Hergé d’être raciste, de donner une image infantilisante des Noirs dans Tintin au
documentait, s’informait auprès des experts, rendait l’imaginaire vraisemblable. Le fétiche Arumbaya de L’Oreille cassée comme la momie inca de Rascar Capac dans Les Sept boules de cristal ne sont pas que des objets transitionnels comme peuvent l’être l’Arche d’Alliance ou le Graal d’Indiana Jones. Qu’un expert archéologue déclare sur les ondes de Radio-Canada, en se forçant, que ces objets, parce qu’ils ont été véhiculés par des mythes, aient pu avoir une existence réelle, c’est une induction qui jette poudre aux yeux en vue de rendre les scénaristes de Lucas aussi scrupuleux qu’Hergé. Les artefacts d’Hergé servaient de moyens, de truchements qui permettaient d’entrer en contact avec une autre civilisation. Certes, on a reproché à Hergé d’être raciste, de donner une image infantilisante des Noirs dans Tintin au  Congo, d’avoir fait l’apologie de la Belgique coloniale, sinon de la mission civilisatrice de l’Occident en présentant son héros défenseur de la veuve maghrébine et de l’orphelin chinois contre les forces réactionnaires des anciennes civilisations (Le Lotus bleu, Le Temple du Soleil, Tintin au pays de l’Or noir, Tintin au Tibet surtout). On ne peut reprocher à un auteur d’être dans les paramètres idéologiques de son époque parce que ces paramètres ne correspondent plus aux nôtres. Notre soi-disant cosmopolitisme d’ouverture, notre multiculturalisme de porcelaine ne sont que des types de masques adaptés à une autre forme de poussée impérialiste qui se cache derrière le politically correctness des Droits de l’Homme et les intérêts des spéculateurs sur les matières premières. Nous sommes donc mal venus de lui lancer la pierre.
Congo, d’avoir fait l’apologie de la Belgique coloniale, sinon de la mission civilisatrice de l’Occident en présentant son héros défenseur de la veuve maghrébine et de l’orphelin chinois contre les forces réactionnaires des anciennes civilisations (Le Lotus bleu, Le Temple du Soleil, Tintin au pays de l’Or noir, Tintin au Tibet surtout). On ne peut reprocher à un auteur d’être dans les paramètres idéologiques de son époque parce que ces paramètres ne correspondent plus aux nôtres. Notre soi-disant cosmopolitisme d’ouverture, notre multiculturalisme de porcelaine ne sont que des types de masques adaptés à une autre forme de poussée impérialiste qui se cache derrière le politically correctness des Droits de l’Homme et les intérêts des spéculateurs sur les matières premières. Nous sommes donc mal venus de lui lancer la pierre.C’est dans la mesure où les intrigues fictives projetées dans l’histoire nous insufflent une curiosité saine pour l’étrangeté temporelle que les artefacts archéologiques ont de la valeur. Cette ouverture, qui part de la «couleur locale» nous permet, par la suite, la raison et l’âge adulte venus, d’aborder le passé comme autre chose qu’un entrepôt de vieilleries exotiques amassées. Le jour où l’on distingue les hommes des enfants, c’est le jour où la vérité s’impose comme valeur et la fiction comme jeu. Les deux peuvent s’inspirer mutuellement, mais ne doivent jamais se confondre. Or, c’est précisément ce qui se passe aujourd’hui avec le réalisme virtuel des jeux vidéos et du cinéma hollywoodien. Cette devise, qui devrait figurer à l’entrée des garderies (des C.P.E. pour les futurs C.P.T.) comme
 le «Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir» que Dante place à l’entrée de l’Enfer, serait «Apprenez en vous amusant, car seul ce qui amuse mérite d’être appris». Dans les faits, apprendre est une tâche exigeante. On ne peut pas toujours enrober la pilule amère d’une couche de sucre d’orge. L’exigence du moindre effort jumelé à l’«aspect ludique» de l’apprentissage afin de permettre une meilleure pédagogie pour les enfants, vision qui existe depuis près de trente ans, conduit aujourd’hui les professeurs à normaliser les notes afin de faire passer les pochetons avec la même facilité que ceux qui ont fourni le maximum d’efforts de leur crue en prenant naïvement au sérieux le mérite scolaire. En facilitant la distribution des diplômes aux seules fins d’abreuver les Universités de subventions et de crédits gouvernementaux, les vrais diplômes, ceux qui honorent les vrais efforts, perdent de leur valeur. Comme la fausse monnaie, les diplômes distribués en série font perdre de la valeur aux vrais.
le «Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir» que Dante place à l’entrée de l’Enfer, serait «Apprenez en vous amusant, car seul ce qui amuse mérite d’être appris». Dans les faits, apprendre est une tâche exigeante. On ne peut pas toujours enrober la pilule amère d’une couche de sucre d’orge. L’exigence du moindre effort jumelé à l’«aspect ludique» de l’apprentissage afin de permettre une meilleure pédagogie pour les enfants, vision qui existe depuis près de trente ans, conduit aujourd’hui les professeurs à normaliser les notes afin de faire passer les pochetons avec la même facilité que ceux qui ont fourni le maximum d’efforts de leur crue en prenant naïvement au sérieux le mérite scolaire. En facilitant la distribution des diplômes aux seules fins d’abreuver les Universités de subventions et de crédits gouvernementaux, les vrais diplômes, ceux qui honorent les vrais efforts, perdent de leur valeur. Comme la fausse monnaie, les diplômes distribués en série font perdre de la valeur aux vrais. L’archéologie n’est pas une discipline amusante. C’est une discipline ardue qui demande des connaissances diverses: en sciences pures, en fouilles de terrain, en manipulation d’objets délicats en vue de la datation, de leur certification comme objets utilitaires ou rituels, etc. On découvre rarement des objets précieux. Toujours on cherche, et toujours on pense découvrir la tombe d’Alexandre le Grand. On tripote le suaire de Turin pour savoir s’il est du Ier ou du XVIe siècle. Là, l’importance n’est que symbolique. Les archéologues québécois qui étudient les anciens campements des autochtones de la préhistoire en sont réduits à cumuler des boulettes ou des excréments fossilisés. Ceux qui fouillent sous les vieux bâtiments de Québec ou de Montréal ne trouveront guère que ce qu’on s’attend à y trouver. Il n’y aura pas de nazis fédéralistes qui courront après le soi-disant trésor du général Wolfe, dissimulés la veille de la bataille des Plaines d’Abraham! On ne trouvera pas un Temple of Doom sur l’île d’Anticosti. Les coups de fouet qui claquent et les vases remplis de crotales, c’est pour les effets spectaculaires et si un archéologue déclare que son chantier est infesté de serpents, il faut croire qu’ils ne sont pas très dangereux puisqu’il est toujours vivant.
L’archéologie n’est pas une discipline amusante. C’est une discipline ardue qui demande des connaissances diverses: en sciences pures, en fouilles de terrain, en manipulation d’objets délicats en vue de la datation, de leur certification comme objets utilitaires ou rituels, etc. On découvre rarement des objets précieux. Toujours on cherche, et toujours on pense découvrir la tombe d’Alexandre le Grand. On tripote le suaire de Turin pour savoir s’il est du Ier ou du XVIe siècle. Là, l’importance n’est que symbolique. Les archéologues québécois qui étudient les anciens campements des autochtones de la préhistoire en sont réduits à cumuler des boulettes ou des excréments fossilisés. Ceux qui fouillent sous les vieux bâtiments de Québec ou de Montréal ne trouveront guère que ce qu’on s’attend à y trouver. Il n’y aura pas de nazis fédéralistes qui courront après le soi-disant trésor du général Wolfe, dissimulés la veille de la bataille des Plaines d’Abraham! On ne trouvera pas un Temple of Doom sur l’île d’Anticosti. Les coups de fouet qui claquent et les vases remplis de crotales, c’est pour les effets spectaculaires et si un archéologue déclare que son chantier est infesté de serpents, il faut croire qu’ils ne sont pas très dangereux puisqu’il est toujours vivant.L’exposition du Centre des sciences se justifie d’une fausse valeur éducative en prétendant qu’en
 exposant côte à côte des vrais et des faux artefacts archéologiques, elle va susciter des carrières solides. Elle ne va même pas créer un intérêt authentique pour l’archéologie puisque la fiction n’est pas décanté de la réalité. Le chapeau d’Harrison Ford n’a pas plus de valeur archéologique que le bidet d’Élisabeth II. Tout cela est un ramassis de rêves mêlés à des objets glanés ici et là dans les musées pour donner à une exposition d’effets spéciaux une apparence d’entreprise pédagogique. Le prix de «conserver son âme d’enfant» devient élevé bien que, de toute façon, l’important, c’est le prix du billet qui passe au guichet et qui est là pour faire vivre ceux qui tiennent ce Centre.
exposant côte à côte des vrais et des faux artefacts archéologiques, elle va susciter des carrières solides. Elle ne va même pas créer un intérêt authentique pour l’archéologie puisque la fiction n’est pas décanté de la réalité. Le chapeau d’Harrison Ford n’a pas plus de valeur archéologique que le bidet d’Élisabeth II. Tout cela est un ramassis de rêves mêlés à des objets glanés ici et là dans les musées pour donner à une exposition d’effets spéciaux une apparence d’entreprise pédagogique. Le prix de «conserver son âme d’enfant» devient élevé bien que, de toute façon, l’important, c’est le prix du billet qui passe au guichet et qui est là pour faire vivre ceux qui tiennent ce Centre.Ce type d’entreprise convient bien à une époque où, après avoir épuisé l’exotisme géographique ou ethnologique, on s’achète un billet pour le voyage dans le temps. Ainsi, en regardant un film, une télésérie ou une bande dessinée se verra-t-on, dans un «réalisme fantastique», se promener dans les jardins suspendus de Babylone, naviguer avec Christophe Colomb, assister au massacre de la Saint-Barthélemy ou vivre la vie quotidienne d’une famille de colons de la Nouvelle-France dont la liberté des mœurs serait égale à la nôtre sans que l’on sente la moindre inquiétude. On
 cherche le dépaysement à condition de n’en point subir l’étrangeté. Ce type d’exposition a l’avantage de livrer la marchandise à cette clientèle de Béotiens et de Philistins, ignorante et grossière, barbare en un mot, qui se pique de civilisation comme d’autres d’héroïnes (et je ne pense pas ici à Madeleine de Verchères ni à Laura Secord). Ce besoin d’évasion dans l’émerveillement, le majestueux, la féerie des époques passées; de rencontrer des personnages hors du commun: des Nostradamus prophète de l’assassinat de John F. Kennedy, des comte de Saint-Germain mettant en garde Marie-Antoinette du sort qui l’attend, d’un masque de fer jumeau du roi Louis XIV ou autres petits Louis XVII devenus Grand Monarque des ésotéristes québécois, ce besoin d’évasion donc, est propre à l’ennui d’un monde suffisant qui croit avoir épuisé toutes les formes de sensations fortes sans mettre en péril leur existence. Fascinés par l’Angleterre des Tudors ou la Rome des Borgias, ces touristes du temps n’éprouveraient que difficultés à s’adapter à ces époques qui les fascinent, précisément, pour leurs mœurs dissolues et leurs facilités à faire couler le sang sans culpabilité. En fait, bien peu d’entre ces spectateurs du temps y survivraient une journée seulement.
cherche le dépaysement à condition de n’en point subir l’étrangeté. Ce type d’exposition a l’avantage de livrer la marchandise à cette clientèle de Béotiens et de Philistins, ignorante et grossière, barbare en un mot, qui se pique de civilisation comme d’autres d’héroïnes (et je ne pense pas ici à Madeleine de Verchères ni à Laura Secord). Ce besoin d’évasion dans l’émerveillement, le majestueux, la féerie des époques passées; de rencontrer des personnages hors du commun: des Nostradamus prophète de l’assassinat de John F. Kennedy, des comte de Saint-Germain mettant en garde Marie-Antoinette du sort qui l’attend, d’un masque de fer jumeau du roi Louis XIV ou autres petits Louis XVII devenus Grand Monarque des ésotéristes québécois, ce besoin d’évasion donc, est propre à l’ennui d’un monde suffisant qui croit avoir épuisé toutes les formes de sensations fortes sans mettre en péril leur existence. Fascinés par l’Angleterre des Tudors ou la Rome des Borgias, ces touristes du temps n’éprouveraient que difficultés à s’adapter à ces époques qui les fascinent, précisément, pour leurs mœurs dissolues et leurs facilités à faire couler le sang sans culpabilité. En fait, bien peu d’entre ces spectateurs du temps y survivraient une journée seulement.Certes, l’apprentissage de la connaissance ne demande pas qu’on s’impose une règle d’austérité des plus éprouvantes. On peut avoir énormément de plaisir à apprendre. L’investissement affectif permet souvent d’endurer les efforts les plus soutenus, beaucoup mieux d’ailleurs que l’enrobage sucré ne peut faire avaler la pilule amère.
 Ce que l’exotisme historique (comme l’exotisme géographique) nous fait perdre, c’est précisément cet investissement érotique de l’autre, de «l’objet» qui fait ordinairement problème. Nos rapports aux objets sont déformés constamment. D’abord, au niveau de la reproduction mentale. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons ou touchons n’est jamais exactement ce que c’est; de plus, notre représentation mentale nous enchaîne devant un «écran» où se joue le réel, tissé dans un voile d’apparences que nous prenons pour la réalité. Nous ne pouvons percevoir le monde sans passser par cet «écran» de la représentation mentale. C’est elle qui donne une logique, une esthétique, une éthique au monde dans lequel nous croyons vivre, mais, ce faisant, elle crée une distorsion entre le monde des objets et les rapports que nous entretenons avec eux. Cette distorsion peut aller jusqu’à la perversion de l’objet, l’utiliser à mauvais escient ou encore dans le sens opposé à son utilisation. Encourager la confusion entre la fiction et le réel, c’est obscurcir l’écran. C’est ajouter, maladroitement, à la confusion, la distance entre l’objet et le sujet.
Ce que l’exotisme historique (comme l’exotisme géographique) nous fait perdre, c’est précisément cet investissement érotique de l’autre, de «l’objet» qui fait ordinairement problème. Nos rapports aux objets sont déformés constamment. D’abord, au niveau de la reproduction mentale. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons ou touchons n’est jamais exactement ce que c’est; de plus, notre représentation mentale nous enchaîne devant un «écran» où se joue le réel, tissé dans un voile d’apparences que nous prenons pour la réalité. Nous ne pouvons percevoir le monde sans passser par cet «écran» de la représentation mentale. C’est elle qui donne une logique, une esthétique, une éthique au monde dans lequel nous croyons vivre, mais, ce faisant, elle crée une distorsion entre le monde des objets et les rapports que nous entretenons avec eux. Cette distorsion peut aller jusqu’à la perversion de l’objet, l’utiliser à mauvais escient ou encore dans le sens opposé à son utilisation. Encourager la confusion entre la fiction et le réel, c’est obscurcir l’écran. C’est ajouter, maladroitement, à la confusion, la distance entre l’objet et le sujet.L’Histoire, le passé, la connaissance ne sont pas là pour nous divertir. Ce ne sont pas ces «objets» qui doivent se couvrir de glamour pour nous les rendre appréciables. L’exotisme historique du genre présenté au Centre des sciences, contribue à cultiver, avec la confusion de l’objet vrai/faux, la psychose chez l’individu qui finit par perdre ses repères entre le réel et la fiction. Il régresse dans la mesure où ces objets, plutôt que d’émanciper le sujet en lui, l’aliène à
 des représentations transitionnelles qui ont pour but de le rassurer sur sa maîtrise du monde sur lequel, en fait, il n’a que très peu d’emprises. C'est là la supériorité de Hergé sur Lucas. Dans les albums Tintin, les objets transitionnels sont généralement mis à mal et même détruits: le fétiche Arumbaya, dans sa chute, laisse le bijou qu'il contenait rouler dans la mer, entraînant dans la mort ceux qui le convoitaient, et de là en enfer, pour finir en morceaux de bois replâtrés et ficelés sous sa cage de verre dans son musée; la momie de Rascar Capac, qui avait plongé dans un sommeil profond et agité les archéologues qui ont profané son tombeau, est pulvérisée par la foudre; les bijoux de la Castafiore sont volés par des pies; l'étoile mystérieuse s'enfonce sous les flots glacés, etc. C'est ainsi que l’apprentissage cognitif doit travailler sur nous-mêmes, en tant que sujet, pour nous donner du monde une appréciation qui stimule nos pulsions et les forcent à abandonner des objets sans valeur intrinsèque pour découvrir les seules valeurs authentiques qui sont contenues dans l'objet. Si Hergé, en bon catholique ambivalent, s'interdisait le rapport amoureux, du moins ses récits ouvrent-ils
des représentations transitionnelles qui ont pour but de le rassurer sur sa maîtrise du monde sur lequel, en fait, il n’a que très peu d’emprises. C'est là la supériorité de Hergé sur Lucas. Dans les albums Tintin, les objets transitionnels sont généralement mis à mal et même détruits: le fétiche Arumbaya, dans sa chute, laisse le bijou qu'il contenait rouler dans la mer, entraînant dans la mort ceux qui le convoitaient, et de là en enfer, pour finir en morceaux de bois replâtrés et ficelés sous sa cage de verre dans son musée; la momie de Rascar Capac, qui avait plongé dans un sommeil profond et agité les archéologues qui ont profané son tombeau, est pulvérisée par la foudre; les bijoux de la Castafiore sont volés par des pies; l'étoile mystérieuse s'enfonce sous les flots glacés, etc. C'est ainsi que l’apprentissage cognitif doit travailler sur nous-mêmes, en tant que sujet, pour nous donner du monde une appréciation qui stimule nos pulsions et les forcent à abandonner des objets sans valeur intrinsèque pour découvrir les seules valeurs authentiques qui sont contenues dans l'objet. Si Hergé, en bon catholique ambivalent, s'interdisait le rapport amoureux, du moins ses récits ouvrent-ils  toujours sur l'amitié, seule permise contre l'intrusion du mal. Chez Lucas, il faudra attendre le troisième volet des Indiana Jones pour que son père finisse par le convaincre de laisser chuter le Graal et le perdre définitivement, mais avec les multiples retours du personnage, on devine qu'il n'a pas bien compris la leçon et que l'aventurier est moins un pédagogue qu'un névrosé obsessionnel. La destruction des objets transitionnels rectifie notre pulsion libidinale. L’amour du passé ne compte donc pas pour lui-même, mais pour le présent, pour l’estimation du degré de développement que nous avons parcouru et des espoirs et des aspirations que nous pouvons investir dans l’avenir. Et si nous atteignons à ce niveau de la conscience de soi collectif, nous ne nous faisons plus d’idées sur notre emprise magique sur le réel. La liberté nous devient alors un bien plus précieux et nous n’avons plus à fuir dans la fantaisie d’un monde merveilleux où les Arches d’Alliance et les saints Graal courent les ravins et les déserts.
toujours sur l'amitié, seule permise contre l'intrusion du mal. Chez Lucas, il faudra attendre le troisième volet des Indiana Jones pour que son père finisse par le convaincre de laisser chuter le Graal et le perdre définitivement, mais avec les multiples retours du personnage, on devine qu'il n'a pas bien compris la leçon et que l'aventurier est moins un pédagogue qu'un névrosé obsessionnel. La destruction des objets transitionnels rectifie notre pulsion libidinale. L’amour du passé ne compte donc pas pour lui-même, mais pour le présent, pour l’estimation du degré de développement que nous avons parcouru et des espoirs et des aspirations que nous pouvons investir dans l’avenir. Et si nous atteignons à ce niveau de la conscience de soi collectif, nous ne nous faisons plus d’idées sur notre emprise magique sur le réel. La liberté nous devient alors un bien plus précieux et nous n’avons plus à fuir dans la fantaisie d’un monde merveilleux où les Arches d’Alliance et les saints Graal courent les ravins et les déserts.Nous devons aimer l’Histoire parce que nous en faisons partie, à notre place et, si je puis dire, dans notre «rôle» dont nous ignorons le moment de sortie et les conditions de cette sortie de scène. Nous devons aimer l’Histoire aussi parce qu’elle se poursuivra après nous, sans nécessairement que son cours soit aussi paisible qu’il le fut pour nous en ce dernier demi-siècle. C’est parce que nous avons des enfants et que nous les aimons que nous ne voulons pas que les perversités du passés (et même celles du présent) se reproduisent à leurs dépens. La parabole du raisin mangé par les pères et dont les noyaux agacent les dents des enfants est toujours aussi vraie en ce début de XXIe siècle qu’il y a deux milles ans.
La connaissance est libératrice. Elle nous libère de la nature dans la mesure où nous pouvons échapper aux conditionnements naturels pour affirmer notre liberté. Elle nous libère également
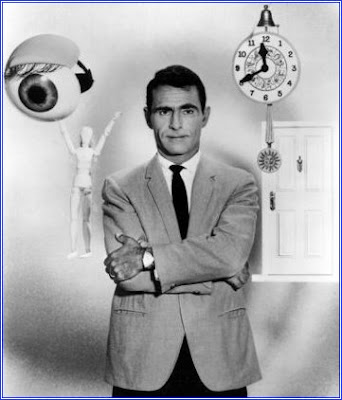 de nos mythologies religieuses et politiques, nous permettant de distinguer la rhétorique de l’intention, l’intention de l’action. Elle rend possible la libération de nos fictions et de nos fantasmes en évitant d’y sombrer comme Narcisse se noyant dans le reflet de son image. Dans un univers où le consumérisme cultive la rêvasserie, les stéréotypes, les réifications d’objets à leur plus simple expression, la connaissance est d’une nécessité cruciale. Elle nous permet d’établir une distance appréciable des objets sans les refuser ni les déformer, de cultiver un esprit critique tout en le rendant capable d’éviter de tomber dans le pyrrhonisme. Elle nous permet d’approcher, avec plus d’exactitude, les objets en évitant de les prendre pour ce qu’ils ne sont pas. Et lorsque cet objet est un autre être humain, certes, la réalité peut épuiser nos déceptions, mais en même temps, elle peut nous révéler des espérances dans la bonté humaine, et ce malgré l’hommerie qui prédomine.
de nos mythologies religieuses et politiques, nous permettant de distinguer la rhétorique de l’intention, l’intention de l’action. Elle rend possible la libération de nos fictions et de nos fantasmes en évitant d’y sombrer comme Narcisse se noyant dans le reflet de son image. Dans un univers où le consumérisme cultive la rêvasserie, les stéréotypes, les réifications d’objets à leur plus simple expression, la connaissance est d’une nécessité cruciale. Elle nous permet d’établir une distance appréciable des objets sans les refuser ni les déformer, de cultiver un esprit critique tout en le rendant capable d’éviter de tomber dans le pyrrhonisme. Elle nous permet d’approcher, avec plus d’exactitude, les objets en évitant de les prendre pour ce qu’ils ne sont pas. Et lorsque cet objet est un autre être humain, certes, la réalité peut épuiser nos déceptions, mais en même temps, elle peut nous révéler des espérances dans la bonté humaine, et ce malgré l’hommerie qui prédomine.Voilà pourquoi je honnis tous ces spectacles où le faux est assimilé innocemment au vrai. Où la «science» devient totalement idéologique en obscurcissant l’«écran» entre le sujet et l’objet. Où la représentation est surinvestie d’intentions idéologiques en stimulant un symbolisme primaire qui mène à l’infantilisation en présentant le faux comme un vrai. Où la malhonnêteté intellectuelle, finalement, fait passer la science pour un spectacle offert aux barbares venus de Béotie et de Philistie⌛
Montréal
29 avril 2011
29 avril 2011
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire