 |
| Sydney Lumet. Le crime de l'Orient-Express, 1974. |
L’ÉNIGME POLICIÈRE
Un extrait inédit de Anus Mundi, - L'énigme policière. Sur la fonction psychologique et sociale du roman policier entre 1860 et 1945 en Occident. - la fascination - le roman-problème - roman du vulgum pecus - l'ombre des origines - un roman extrait du socius - l'hygiénisme moral du roman policier - le mystère dépecé - un roman métaphysique - la prédation mentale.
LA FASCINATION
 L’histoire
et la psychanalyse fascinèrent durant tout l’âge de l’Anus
Mundi (1860-1945). Elles
posaient des questions qui interpellaient autant les hommes publiques
que les individus passionnés par l’occulte, par l’étrange, par
les névroses qui les habitaient : «Il
serait tentant de soutenir que, même si les masses ont fait bon
accueil aux livres utiles et édifiants que l’école leur
apportait, elles étaient depuis longtemps intoxiquées par une
nourriture intellectuelle fort différente : certes, le peuple
voulait connaître le monde, mais parfois, autant ou même plus, il
désirait, semble-t-il, s’en évader, en s’identifiant aux héros
criminels qui défiaient toutes les lois qu’il devait lui-même
subir dans la vie réelle, et en trouvant dans la littérature la
possibilité de satisfaire par procuration ses désirs et ses
émotions, le moyen de rêver tout éveillé. L’instruction
obligatoire tenta, dans une certaine mesure d’arracher les masses à
ces lectures considérées comme pernicieuses et corruptrices».1
Un troisième genre littéraire et pseudo-scientifique allait émerger
de ces années troubles. Le roman policier. Moins austère dans son
érudition que l’historiographie et plus accessible que la
psychanalyse tâtonnante, le roman policier suscitait la fascination.
Toutes trois exerçaient une séduction, un charme
qui ne
fût pas étranger avec le fascisme qui partageait une racine
commune : fascinus.2
La fascination nouvelle ne naissait plus du merveilleux, dont on a
répété depuis longtemps
L’histoire
et la psychanalyse fascinèrent durant tout l’âge de l’Anus
Mundi (1860-1945). Elles
posaient des questions qui interpellaient autant les hommes publiques
que les individus passionnés par l’occulte, par l’étrange, par
les névroses qui les habitaient : «Il
serait tentant de soutenir que, même si les masses ont fait bon
accueil aux livres utiles et édifiants que l’école leur
apportait, elles étaient depuis longtemps intoxiquées par une
nourriture intellectuelle fort différente : certes, le peuple
voulait connaître le monde, mais parfois, autant ou même plus, il
désirait, semble-t-il, s’en évader, en s’identifiant aux héros
criminels qui défiaient toutes les lois qu’il devait lui-même
subir dans la vie réelle, et en trouvant dans la littérature la
possibilité de satisfaire par procuration ses désirs et ses
émotions, le moyen de rêver tout éveillé. L’instruction
obligatoire tenta, dans une certaine mesure d’arracher les masses à
ces lectures considérées comme pernicieuses et corruptrices».1
Un troisième genre littéraire et pseudo-scientifique allait émerger
de ces années troubles. Le roman policier. Moins austère dans son
érudition que l’historiographie et plus accessible que la
psychanalyse tâtonnante, le roman policier suscitait la fascination.
Toutes trois exerçaient une séduction, un charme
qui ne
fût pas étranger avec le fascisme qui partageait une racine
commune : fascinus.2
La fascination nouvelle ne naissait plus du merveilleux, dont on a
répété depuis longtemps  qu’il s’était effacé avec le Moyen
Âge ou refoulé dans des paralittératures comme les récits
folkloriques ou les contes pour enfants, mais bien le fantastique,
l’hirsute, l’étrange avec son bagage d'étrangetés
inquiétantes; non plus une angoisse lourde imposée par l’existence
mais une fantaisie légère opérant par des tours
de force
techniques. Partant d’une problématique négative – un crime -,
l’esprit rationnel – la ratio
-
se confronte à des obstacles en vue de parvenir à la vérité, qui
est la fin dernière du genre. Ce qui stimula le roman policier en
cette fin de XIXe siècle et pour le siècle suivant, c’est qu’il
commençait par le crime psychique : le meurtre de la figure du
Père (le Phallus originaire), et le crime historique : la mort
de la
qu’il s’était effacé avec le Moyen
Âge ou refoulé dans des paralittératures comme les récits
folkloriques ou les contes pour enfants, mais bien le fantastique,
l’hirsute, l’étrange avec son bagage d'étrangetés
inquiétantes; non plus une angoisse lourde imposée par l’existence
mais une fantaisie légère opérant par des tours
de force
techniques. Partant d’une problématique négative – un crime -,
l’esprit rationnel – la ratio
-
se confronte à des obstacles en vue de parvenir à la vérité, qui
est la fin dernière du genre. Ce qui stimula le roman policier en
cette fin de XIXe siècle et pour le siècle suivant, c’est qu’il
commençait par le crime psychique : le meurtre de la figure du
Père (le Phallus originaire), et le crime historique : la mort
de la  gérontocratie fin-de-siècle
emportée avec ses fils dans le grand conflit mondial de 1914-1918.
La fascination pour les grands crimes et les criminels célèbres
s’était établi au fur et à mesure que le XIXe siècle avait
progressé. Déjà Géricault se montrait fasciné par l’assassinat
de Fualdès, le 19 mars 1817, crime crapuleux parce qu’on fit jouer
de l’orgue de barbarie afin d’étouffer les cris de la victime.
Le peintre dessina tous les moments de la commission du crime. De
même, l’assassinat des huit membres de la famille Kinck par le
truand Jean-Baptiste Troppmann (1868). Commençant par attirer le
père dans un guet-apens pour l’empoisonner, il assassina par après
son fils aîné de 16 ans en le déchiquetant à coups de couteaux,
enfin, l’épouse et ses autres enfants (sauf son plus jeune placé
en nourrice), six personnes en tout massacrés par le tueur acharné
qui poursuivait la famille afin d’en tirer un substantiel montant
d’argent. Les deux plus jeunes furent égorgés, les trois derniers
étranglés et tous achevés à coups de pelle, certains enterrés
vivants. Enfin, les récits des crimes de Jack l’Éventreur (1888)
cultivèrent les goûts morbides populaires par la couverture
médiatique des journaux à sensations de l’époque.
gérontocratie fin-de-siècle
emportée avec ses fils dans le grand conflit mondial de 1914-1918.
La fascination pour les grands crimes et les criminels célèbres
s’était établi au fur et à mesure que le XIXe siècle avait
progressé. Déjà Géricault se montrait fasciné par l’assassinat
de Fualdès, le 19 mars 1817, crime crapuleux parce qu’on fit jouer
de l’orgue de barbarie afin d’étouffer les cris de la victime.
Le peintre dessina tous les moments de la commission du crime. De
même, l’assassinat des huit membres de la famille Kinck par le
truand Jean-Baptiste Troppmann (1868). Commençant par attirer le
père dans un guet-apens pour l’empoisonner, il assassina par après
son fils aîné de 16 ans en le déchiquetant à coups de couteaux,
enfin, l’épouse et ses autres enfants (sauf son plus jeune placé
en nourrice), six personnes en tout massacrés par le tueur acharné
qui poursuivait la famille afin d’en tirer un substantiel montant
d’argent. Les deux plus jeunes furent égorgés, les trois derniers
étranglés et tous achevés à coups de pelle, certains enterrés
vivants. Enfin, les récits des crimes de Jack l’Éventreur (1888)
cultivèrent les goûts morbides populaires par la couverture
médiatique des journaux à sensations de l’époque.
C’est
dans ce contexte qu’on passa des crimes horribles ou terrifiants à
la littérature romanesque. «Les
histoires de crime, prolongement des contes du dix-huitième siècle
sur les bandits célèbres, prirent un nouveau tour avec l’apparition
du détective. Le crime et la violence avaient toujours été
fascinants. L’intrigue policière y ajouta une nouvelle sorte de
jeu où, selon les mots de Gaboriau (1835-73) - le créateur de
Monsieur Lecoq (1868) -, l’auteur et le lecteur jouaient au plus
 fin. Un an avant que ne paraisse le premier Sherlock Holmes, Henri
Cauvain (1847-99) créa un héros semblable, nommé
Maximilien Heller
(1886) qui, comme Holmes, se droguait, avait pour fidèle compagnon
un docteur et qui, pour couronner le tout, était aux prises avec un
personnage nommé Docteur Wickson. De plus en plus, le roman policier
anglais servait de modèle aux Français, et en fait à la moitié
des romans policiers déjà parus étaient traduits de l’anglais.
Maurice Leblanc (1864-1941) avait créé avec Arsène Lupin une
alternative française à Holmes, encore qu’il y eût, il est vrai,
une différence majeure : Lupin était un héros à la française, un
chétif “petit homme”, qui se prouvait à lui-même et démontrait
à ses lecteurs qu’il pouvait surmonter sa faiblesse : il savait
comment résister aux autorités et avait l’art du coup de théâtre.
Cependant, Maurice Leblanc était lui-même fils d’un riche
armateur de Rouen. Quant à Gaston Leroux (1867-1927), le créateur
de Rouletabille (enfant-prodige, reporter-détective dans un journal)
et de Chéri-Bibi, il ne se mit à écrire qu’après avoir dilapidé
au jeu le million de
fin. Un an avant que ne paraisse le premier Sherlock Holmes, Henri
Cauvain (1847-99) créa un héros semblable, nommé
Maximilien Heller
(1886) qui, comme Holmes, se droguait, avait pour fidèle compagnon
un docteur et qui, pour couronner le tout, était aux prises avec un
personnage nommé Docteur Wickson. De plus en plus, le roman policier
anglais servait de modèle aux Français, et en fait à la moitié
des romans policiers déjà parus étaient traduits de l’anglais.
Maurice Leblanc (1864-1941) avait créé avec Arsène Lupin une
alternative française à Holmes, encore qu’il y eût, il est vrai,
une différence majeure : Lupin était un héros à la française, un
chétif “petit homme”, qui se prouvait à lui-même et démontrait
à ses lecteurs qu’il pouvait surmonter sa faiblesse : il savait
comment résister aux autorités et avait l’art du coup de théâtre.
Cependant, Maurice Leblanc était lui-même fils d’un riche
armateur de Rouen. Quant à Gaston Leroux (1867-1927), le créateur
de Rouletabille (enfant-prodige, reporter-détective dans un journal)
et de Chéri-Bibi, il ne se mit à écrire qu’après avoir dilapidé
au jeu le million de  francs de son héritage. Ponson du Terrail
(1829-71), pionnier du roman d’aventure à épisodes et créateur
de Rocambole, s’était intitulé lui-même. Vicomte. Ces écrivains
avaient créé des héros qui étaient légèrement opposés à
l’ordre établi, mais leur but n’était pas de bouleverser la
société. Les techniques scientifiques fascinaient les esprits et
les détournaient des problèmes sociaux».3
Les premiers romans policiers étaient publiés en feuilletons dans
le même type de magazines qui rapportaient les meurtres crapuleux.
«Rappelons
seulement que le développement extraordinaire d’une presse
spécialisée, la croissance parallèle de la vie urbaine et, suite
inévitable de la concentration des populations, l’augmentation
sensible de la criminalité, ont été les causes prochaines de la
naissance du roman policier. Le voici donc qui s’avance dans le
monde, insolite, inquiétant, gros de violence et de sang mais
curieusement “dandy”, avec ses prouesses logiques, son insolence
patricienne dans le maniement des arguments, son allure, enfin, qui
séduit, déconcerte et provoque bien vite l’enthousiasme. Nul
doute! Cette jeune littérature était bien la littérature
d’avant-garde que l’on attendait, celle qui, portée par la
science, mettait les procédés les plus fins de la science à la
portée de tous».4
francs de son héritage. Ponson du Terrail
(1829-71), pionnier du roman d’aventure à épisodes et créateur
de Rocambole, s’était intitulé lui-même. Vicomte. Ces écrivains
avaient créé des héros qui étaient légèrement opposés à
l’ordre établi, mais leur but n’était pas de bouleverser la
société. Les techniques scientifiques fascinaient les esprits et
les détournaient des problèmes sociaux».3
Les premiers romans policiers étaient publiés en feuilletons dans
le même type de magazines qui rapportaient les meurtres crapuleux.
«Rappelons
seulement que le développement extraordinaire d’une presse
spécialisée, la croissance parallèle de la vie urbaine et, suite
inévitable de la concentration des populations, l’augmentation
sensible de la criminalité, ont été les causes prochaines de la
naissance du roman policier. Le voici donc qui s’avance dans le
monde, insolite, inquiétant, gros de violence et de sang mais
curieusement “dandy”, avec ses prouesses logiques, son insolence
patricienne dans le maniement des arguments, son allure, enfin, qui
séduit, déconcerte et provoque bien vite l’enthousiasme. Nul
doute! Cette jeune littérature était bien la littérature
d’avant-garde que l’on attendait, celle qui, portée par la
science, mettait les procédés les plus fins de la science à la
portée de tous».4
 fin. Un an avant que ne paraisse le premier Sherlock Holmes, Henri
Cauvain (1847-99) créa un héros semblable, nommé
Maximilien Heller
(1886) qui, comme Holmes, se droguait, avait pour fidèle compagnon
un docteur et qui, pour couronner le tout, était aux prises avec un
personnage nommé Docteur Wickson. De plus en plus, le roman policier
anglais servait de modèle aux Français, et en fait à la moitié
des romans policiers déjà parus étaient traduits de l’anglais.
Maurice Leblanc (1864-1941) avait créé avec Arsène Lupin une
alternative française à Holmes, encore qu’il y eût, il est vrai,
une différence majeure : Lupin était un héros à la française, un
chétif “petit homme”, qui se prouvait à lui-même et démontrait
à ses lecteurs qu’il pouvait surmonter sa faiblesse : il savait
comment résister aux autorités et avait l’art du coup de théâtre.
Cependant, Maurice Leblanc était lui-même fils d’un riche
armateur de Rouen. Quant à Gaston Leroux (1867-1927), le créateur
de Rouletabille (enfant-prodige, reporter-détective dans un journal)
et de Chéri-Bibi, il ne se mit à écrire qu’après avoir dilapidé
au jeu le million de
fin. Un an avant que ne paraisse le premier Sherlock Holmes, Henri
Cauvain (1847-99) créa un héros semblable, nommé
Maximilien Heller
(1886) qui, comme Holmes, se droguait, avait pour fidèle compagnon
un docteur et qui, pour couronner le tout, était aux prises avec un
personnage nommé Docteur Wickson. De plus en plus, le roman policier
anglais servait de modèle aux Français, et en fait à la moitié
des romans policiers déjà parus étaient traduits de l’anglais.
Maurice Leblanc (1864-1941) avait créé avec Arsène Lupin une
alternative française à Holmes, encore qu’il y eût, il est vrai,
une différence majeure : Lupin était un héros à la française, un
chétif “petit homme”, qui se prouvait à lui-même et démontrait
à ses lecteurs qu’il pouvait surmonter sa faiblesse : il savait
comment résister aux autorités et avait l’art du coup de théâtre.
Cependant, Maurice Leblanc était lui-même fils d’un riche
armateur de Rouen. Quant à Gaston Leroux (1867-1927), le créateur
de Rouletabille (enfant-prodige, reporter-détective dans un journal)
et de Chéri-Bibi, il ne se mit à écrire qu’après avoir dilapidé
au jeu le million de  francs de son héritage. Ponson du Terrail
(1829-71), pionnier du roman d’aventure à épisodes et créateur
de Rocambole, s’était intitulé lui-même. Vicomte. Ces écrivains
avaient créé des héros qui étaient légèrement opposés à
l’ordre établi, mais leur but n’était pas de bouleverser la
société. Les techniques scientifiques fascinaient les esprits et
les détournaient des problèmes sociaux».3
Les premiers romans policiers étaient publiés en feuilletons dans
le même type de magazines qui rapportaient les meurtres crapuleux.
«Rappelons
seulement que le développement extraordinaire d’une presse
spécialisée, la croissance parallèle de la vie urbaine et, suite
inévitable de la concentration des populations, l’augmentation
sensible de la criminalité, ont été les causes prochaines de la
naissance du roman policier. Le voici donc qui s’avance dans le
monde, insolite, inquiétant, gros de violence et de sang mais
curieusement “dandy”, avec ses prouesses logiques, son insolence
patricienne dans le maniement des arguments, son allure, enfin, qui
séduit, déconcerte et provoque bien vite l’enthousiasme. Nul
doute! Cette jeune littérature était bien la littérature
d’avant-garde que l’on attendait, celle qui, portée par la
science, mettait les procédés les plus fins de la science à la
portée de tous».4
francs de son héritage. Ponson du Terrail
(1829-71), pionnier du roman d’aventure à épisodes et créateur
de Rocambole, s’était intitulé lui-même. Vicomte. Ces écrivains
avaient créé des héros qui étaient légèrement opposés à
l’ordre établi, mais leur but n’était pas de bouleverser la
société. Les techniques scientifiques fascinaient les esprits et
les détournaient des problèmes sociaux».3
Les premiers romans policiers étaient publiés en feuilletons dans
le même type de magazines qui rapportaient les meurtres crapuleux.
«Rappelons
seulement que le développement extraordinaire d’une presse
spécialisée, la croissance parallèle de la vie urbaine et, suite
inévitable de la concentration des populations, l’augmentation
sensible de la criminalité, ont été les causes prochaines de la
naissance du roman policier. Le voici donc qui s’avance dans le
monde, insolite, inquiétant, gros de violence et de sang mais
curieusement “dandy”, avec ses prouesses logiques, son insolence
patricienne dans le maniement des arguments, son allure, enfin, qui
séduit, déconcerte et provoque bien vite l’enthousiasme. Nul
doute! Cette jeune littérature était bien la littérature
d’avant-garde que l’on attendait, celle qui, portée par la
science, mettait les procédés les plus fins de la science à la
portée de tous».4
Une
demande manifeste se faisait pour ce genre du grand-guignolesque
journalistique. «Il
saisissait toute occasion de pousser le tirage. C’est ainsi que la
Presse,
usant et abusant de la sensation, multipliait les “sombres drames”,
les “mystères impénétrables”, les récits détaillés de
 scènes criminelles».5
Il est vrai que des mises en scène comme le meurtre de Fualdès où
l’achar-
scènes criminelles».5
Il est vrai que des mises en scène comme le meurtre de Fualdès où
l’achar-
nement démo-
niaque avec lequel Troppmann poursuivit la famille Kinck sortaient de l’ordinaire. D’autres rubriques criminelles furent consacrées à Pierre Rivière qui avait égorgé sa mère (enceinte), sa sœur et son plus jeune frère à coups de serpe (1835); le sergent François Bertrand qui, dans les années 1870, déterraient des cadavres de femmes pour les mutiler dans un acte de nécrophilie; un autre sergent, Joseph Vacher, exécuté pour
avoir violé, mutilé et tué au moins vingt femmes et adolescents –
généralement des bergers -, au début des années 1890, deux ans
après la couverture mondiale des crimes de Jack l’Éventreur. Aux
États-Unis, l’hôtel labyrinthique du docteur Holmes (1892) où
s’y commettaient d’autres crimes atroces fit la une des journaux
américains. Après la guerre, les crimes sadiques et cannibalesques
de Haarmann à Hambourg et de Kurten à Düsseldorf illustraient les
faiblesses même de l’Allemagne de Weimar. La couverture de ces
monstruosités était faite par des journalistes et la rubrique était
souvent accompagnée d’illustrations morbides ou des photos
sensationnalistes de la scène de crime ou du criminel. Quelques
auteurs de romans saisirent la balle au bond. Aux crimes réels, trop
souvent sadiques et primitifs, ils allaient substituer des crimes
intelligents,
roués,
véritables défis à la logique déductive d’un héros de nouveau
style : l'enquêteur. «Fasciné
par l’idée de rendre possible l’impossible, l’écrivain nous
présentait un savant criminologue qui sait faire parler, à l’aide
de procédés techniques, chimiques et biologiques, non seulement les
taches de sang, mais
Joseph Vacher, exécuté pour
avoir violé, mutilé et tué au moins vingt femmes et adolescents –
généralement des bergers -, au début des années 1890, deux ans
après la couverture mondiale des crimes de Jack l’Éventreur. Aux
États-Unis, l’hôtel labyrinthique du docteur Holmes (1892) où
s’y commettaient d’autres crimes atroces fit la une des journaux
américains. Après la guerre, les crimes sadiques et cannibalesques
de Haarmann à Hambourg et de Kurten à Düsseldorf illustraient les
faiblesses même de l’Allemagne de Weimar. La couverture de ces
monstruosités était faite par des journalistes et la rubrique était
souvent accompagnée d’illustrations morbides ou des photos
sensationnalistes de la scène de crime ou du criminel. Quelques
auteurs de romans saisirent la balle au bond. Aux crimes réels, trop
souvent sadiques et primitifs, ils allaient substituer des crimes
intelligents,
roués,
véritables défis à la logique déductive d’un héros de nouveau
style : l'enquêteur. «Fasciné
par l’idée de rendre possible l’impossible, l’écrivain nous
présentait un savant criminologue qui sait faire parler, à l’aide
de procédés techniques, chimiques et biologiques, non seulement les
taches de sang, mais  toutes les autres laissées sur le lieu du
méfait et en tirer les conclusions permettant de définir le
criminel et de reconstituer ses gestes».6
Autant dire, le détective était prêt à jouer dans toutes les
humeurs du corps humain afin de trouver, à partir d'un cadavre, les
indices qui conduiraient au corps de l’assassin, ce que
l’utilisation actuelle des prélèvements d’ADN parvient à
accomplir de façon à exclure tous doutes raisonnables. Pour
l’époque, le roman policier offrait un divertissement qui faisait
appel non aux émotions – bien que les auteurs savaient en jouer de
temps à autres -, mais à la réflexion, voire à l’analyse. Ce
n’était pas «une
nouveauté, si l’on pense aux
Mystères de Paris,
à certains passages des
Misérables
ou au cadre de plusieurs nouvelles de Poe. Mais ce qui est nouveau,
c’est l’extension de cette paralittérature, issue d’une presse
qui donne de plus en plus d’importance aux récits de faits divers
criminels (ils occupent 10% du journal
Le Petit Parisien,
sans compter des “livraisons spéciales” consacrées aux affaires
les plus marquantes). Sazie, Gaston Leroux ainsi qu’Émile
Souvestre et Marcel Allain, sont d’ailleurs des journalistes de
métier».7
L’auteur de roman policier invitait même son lectorat à relever
le défi et on pouvait mesurer la qualité d’un auteur par sa façon
de mystifier son lectorat sans abuser de fausses pistes ou de
personnages qui n’apparaîtraient qu’au moment de la solution du
crime et inconnus des lecteurs.
toutes les autres laissées sur le lieu du
méfait et en tirer les conclusions permettant de définir le
criminel et de reconstituer ses gestes».6
Autant dire, le détective était prêt à jouer dans toutes les
humeurs du corps humain afin de trouver, à partir d'un cadavre, les
indices qui conduiraient au corps de l’assassin, ce que
l’utilisation actuelle des prélèvements d’ADN parvient à
accomplir de façon à exclure tous doutes raisonnables. Pour
l’époque, le roman policier offrait un divertissement qui faisait
appel non aux émotions – bien que les auteurs savaient en jouer de
temps à autres -, mais à la réflexion, voire à l’analyse. Ce
n’était pas «une
nouveauté, si l’on pense aux
Mystères de Paris,
à certains passages des
Misérables
ou au cadre de plusieurs nouvelles de Poe. Mais ce qui est nouveau,
c’est l’extension de cette paralittérature, issue d’une presse
qui donne de plus en plus d’importance aux récits de faits divers
criminels (ils occupent 10% du journal
Le Petit Parisien,
sans compter des “livraisons spéciales” consacrées aux affaires
les plus marquantes). Sazie, Gaston Leroux ainsi qu’Émile
Souvestre et Marcel Allain, sont d’ailleurs des journalistes de
métier».7
L’auteur de roman policier invitait même son lectorat à relever
le défi et on pouvait mesurer la qualité d’un auteur par sa façon
de mystifier son lectorat sans abuser de fausses pistes ou de
personnages qui n’apparaîtraient qu’au moment de la solution du
crime et inconnus des lecteurs.
 scènes criminelles».5
Il est vrai que des mises en scène comme le meurtre de Fualdès où
l’achar-
scènes criminelles».5
Il est vrai que des mises en scène comme le meurtre de Fualdès où
l’achar-nement démo-
niaque avec lequel Troppmann poursuivit la famille Kinck sortaient de l’ordinaire. D’autres rubriques criminelles furent consacrées à Pierre Rivière qui avait égorgé sa mère (enceinte), sa sœur et son plus jeune frère à coups de serpe (1835); le sergent François Bertrand qui, dans les années 1870, déterraient des cadavres de femmes pour les mutiler dans un acte de nécrophilie; un autre sergent,
 Joseph Vacher, exécuté pour
avoir violé, mutilé et tué au moins vingt femmes et adolescents –
généralement des bergers -, au début des années 1890, deux ans
après la couverture mondiale des crimes de Jack l’Éventreur. Aux
États-Unis, l’hôtel labyrinthique du docteur Holmes (1892) où
s’y commettaient d’autres crimes atroces fit la une des journaux
américains. Après la guerre, les crimes sadiques et cannibalesques
de Haarmann à Hambourg et de Kurten à Düsseldorf illustraient les
faiblesses même de l’Allemagne de Weimar. La couverture de ces
monstruosités était faite par des journalistes et la rubrique était
souvent accompagnée d’illustrations morbides ou des photos
sensationnalistes de la scène de crime ou du criminel. Quelques
auteurs de romans saisirent la balle au bond. Aux crimes réels, trop
souvent sadiques et primitifs, ils allaient substituer des crimes
intelligents,
roués,
véritables défis à la logique déductive d’un héros de nouveau
style : l'enquêteur. «Fasciné
par l’idée de rendre possible l’impossible, l’écrivain nous
présentait un savant criminologue qui sait faire parler, à l’aide
de procédés techniques, chimiques et biologiques, non seulement les
taches de sang, mais
Joseph Vacher, exécuté pour
avoir violé, mutilé et tué au moins vingt femmes et adolescents –
généralement des bergers -, au début des années 1890, deux ans
après la couverture mondiale des crimes de Jack l’Éventreur. Aux
États-Unis, l’hôtel labyrinthique du docteur Holmes (1892) où
s’y commettaient d’autres crimes atroces fit la une des journaux
américains. Après la guerre, les crimes sadiques et cannibalesques
de Haarmann à Hambourg et de Kurten à Düsseldorf illustraient les
faiblesses même de l’Allemagne de Weimar. La couverture de ces
monstruosités était faite par des journalistes et la rubrique était
souvent accompagnée d’illustrations morbides ou des photos
sensationnalistes de la scène de crime ou du criminel. Quelques
auteurs de romans saisirent la balle au bond. Aux crimes réels, trop
souvent sadiques et primitifs, ils allaient substituer des crimes
intelligents,
roués,
véritables défis à la logique déductive d’un héros de nouveau
style : l'enquêteur. «Fasciné
par l’idée de rendre possible l’impossible, l’écrivain nous
présentait un savant criminologue qui sait faire parler, à l’aide
de procédés techniques, chimiques et biologiques, non seulement les
taches de sang, mais  toutes les autres laissées sur le lieu du
méfait et en tirer les conclusions permettant de définir le
criminel et de reconstituer ses gestes».6
Autant dire, le détective était prêt à jouer dans toutes les
humeurs du corps humain afin de trouver, à partir d'un cadavre, les
indices qui conduiraient au corps de l’assassin, ce que
l’utilisation actuelle des prélèvements d’ADN parvient à
accomplir de façon à exclure tous doutes raisonnables. Pour
l’époque, le roman policier offrait un divertissement qui faisait
appel non aux émotions – bien que les auteurs savaient en jouer de
temps à autres -, mais à la réflexion, voire à l’analyse. Ce
n’était pas «une
nouveauté, si l’on pense aux
Mystères de Paris,
à certains passages des
Misérables
ou au cadre de plusieurs nouvelles de Poe. Mais ce qui est nouveau,
c’est l’extension de cette paralittérature, issue d’une presse
qui donne de plus en plus d’importance aux récits de faits divers
criminels (ils occupent 10% du journal
Le Petit Parisien,
sans compter des “livraisons spéciales” consacrées aux affaires
les plus marquantes). Sazie, Gaston Leroux ainsi qu’Émile
Souvestre et Marcel Allain, sont d’ailleurs des journalistes de
métier».7
L’auteur de roman policier invitait même son lectorat à relever
le défi et on pouvait mesurer la qualité d’un auteur par sa façon
de mystifier son lectorat sans abuser de fausses pistes ou de
personnages qui n’apparaîtraient qu’au moment de la solution du
crime et inconnus des lecteurs.
toutes les autres laissées sur le lieu du
méfait et en tirer les conclusions permettant de définir le
criminel et de reconstituer ses gestes».6
Autant dire, le détective était prêt à jouer dans toutes les
humeurs du corps humain afin de trouver, à partir d'un cadavre, les
indices qui conduiraient au corps de l’assassin, ce que
l’utilisation actuelle des prélèvements d’ADN parvient à
accomplir de façon à exclure tous doutes raisonnables. Pour
l’époque, le roman policier offrait un divertissement qui faisait
appel non aux émotions – bien que les auteurs savaient en jouer de
temps à autres -, mais à la réflexion, voire à l’analyse. Ce
n’était pas «une
nouveauté, si l’on pense aux
Mystères de Paris,
à certains passages des
Misérables
ou au cadre de plusieurs nouvelles de Poe. Mais ce qui est nouveau,
c’est l’extension de cette paralittérature, issue d’une presse
qui donne de plus en plus d’importance aux récits de faits divers
criminels (ils occupent 10% du journal
Le Petit Parisien,
sans compter des “livraisons spéciales” consacrées aux affaires
les plus marquantes). Sazie, Gaston Leroux ainsi qu’Émile
Souvestre et Marcel Allain, sont d’ailleurs des journalistes de
métier».7
L’auteur de roman policier invitait même son lectorat à relever
le défi et on pouvait mesurer la qualité d’un auteur par sa façon
de mystifier son lectorat sans abuser de fausses pistes ou de
personnages qui n’apparaîtraient qu’au moment de la solution du
crime et inconnus des lecteurs.
Certes,
les détectives ou enquêteurs des romans policiers avaient également
des modèles vivants. Depuis les mémoires de Vidocq, datant du début
du XIXe siècle, le monde de la police urbaine commençait à prendre
les allures que nous lui connaissons. Ancien forçat, Vidocq «était
un policier sans génie parce que sans méthode. Il s’appuyait sur
une foule obscure d’indicateurs et comptait plus sur la
dénonciation que sur la déduction pour arrêter les coupables.
Cependant cette  police, faite d’espions plus que de limiers, a le
mérite d’être là, de faire partie du panorama de la ville.
Désormais, le policier est un type social. Le haut de forme, les
favoris, la redingote strictement boutonnée, le gourdin torsadé lui
composent une silhouette familière».8
Hugo s’en inspira dans Les
Misérables,
pour dessiner son policier opiniâtre, Javert.
La création d’un corps de police comme Scotland Yard, à Londres
en 1829, sous l’initiative du Premier ministre de l’époque, sir
Robert Peel, offrit le premier modèle qui devait être repris par
l’ensemble des nations occidentales. Entre les crimes de droit
commun et les assassinats, la répression des violences populaires et
l’utilisation à des fins politiques, les corps de police jouaient
le rôle d’une milice locale tenue par les lettres de la loi. La
violence physique cessa progressivement au détriment de la violence
psychologique, d’où l’importance de munir ces corps de l’esprit
positiviste de l’époque. L’ajout de laboratoires, de traités de
criminologie, d’experts (chimistes, physiciens, médecins,
psychiatres etc.) faisait de la police un corps scientifique,
faisant oublier par là sa fonction ultime : imposer l’ordre
bourgeois dans la cité. De là, on vit «se
dessiner une thématique qui a un bel avenir dans le secteur de
presse : l’héroïsation du flic.
L’apothéose de l’héroïsme flicard, qui fait du policier le
paladin, le défenseur solitaire et intrépide de l’ordre social se
reconnaît dans certaines chroniques complaisantes sur M. Goron, le
chef de la Sûreté et ses “meilleurs agents”, dans l’apologie
de “l’Inspecteur principal Jaume”. Goron qui passe pour avoir
résolu l’affaire Pranzini et l’affaire Allmeyer, est mythifié
pour son talent de
police, faite d’espions plus que de limiers, a le
mérite d’être là, de faire partie du panorama de la ville.
Désormais, le policier est un type social. Le haut de forme, les
favoris, la redingote strictement boutonnée, le gourdin torsadé lui
composent une silhouette familière».8
Hugo s’en inspira dans Les
Misérables,
pour dessiner son policier opiniâtre, Javert.
La création d’un corps de police comme Scotland Yard, à Londres
en 1829, sous l’initiative du Premier ministre de l’époque, sir
Robert Peel, offrit le premier modèle qui devait être repris par
l’ensemble des nations occidentales. Entre les crimes de droit
commun et les assassinats, la répression des violences populaires et
l’utilisation à des fins politiques, les corps de police jouaient
le rôle d’une milice locale tenue par les lettres de la loi. La
violence physique cessa progressivement au détriment de la violence
psychologique, d’où l’importance de munir ces corps de l’esprit
positiviste de l’époque. L’ajout de laboratoires, de traités de
criminologie, d’experts (chimistes, physiciens, médecins,
psychiatres etc.) faisait de la police un corps scientifique,
faisant oublier par là sa fonction ultime : imposer l’ordre
bourgeois dans la cité. De là, on vit «se
dessiner une thématique qui a un bel avenir dans le secteur de
presse : l’héroïsation du flic.
L’apothéose de l’héroïsme flicard, qui fait du policier le
paladin, le défenseur solitaire et intrépide de l’ordre social se
reconnaît dans certaines chroniques complaisantes sur M. Goron, le
chef de la Sûreté et ses “meilleurs agents”, dans l’apologie
de “l’Inspecteur principal Jaume”. Goron qui passe pour avoir
résolu l’affaire Pranzini et l’affaire Allmeyer, est mythifié
pour son talent de  détective et servira de modèle dans le roman
policier».9
On peut penser aussi à «Marius Jacob, anarchiste individualiste et voleur de génie, condamné pour
n’avoir pas demandé au procès la clémence des juges. Jacob est
le modèle d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur».10
Avec l’Américain Edgar Poe, le créateur du genre, le roman
policier plongeait ses racines dans la littérature gothique du
tournant du XIXe siècle. Des anecdotes racontant les hauts faits de
truands comme Mandrin ou Cartouche «se
développait une autre littérature du crime : une littérature où
le crime est glorifié, mais parce qu’il est un des beaux-arts,
parce qu’il ne peut être l’œuvre que de natures d’exception,
parce qu’il révèle la monstruosité des forts et des puissants,
parce que la scélératesse est encore une façon d’être un
privilégié : du roman noir à Quincey, ou du
Château d’Otrante
à Baudelaire, il y a toute une réécriture esthétique du crime,
qui est aussi l’appropriation de la criminalité sous des formes
recevables. C’est, en apparence, la découverte de la beauté et de
la grandeur du crime; de fait c’est l’affirmation que la grandeur
aussi a droit au crime et qu’il devient même le privilège
exclusif de ceux qui sont réellement grands. Les beaux meurtres ne
sont pas pour les gagne-petit de l’illégalisme. Quant à la
littérature policière, à partir de Gaboriau, elle fait suite à ce
premier déplacement : par ses ruses, ses subtilités, l’acuité
extrême de son intelligence, le criminel qu’elle représente s’est
rendu insoupçonnable; et la lutte entre deux purs esprits - celui du
meurtrier, celui du
détective et servira de modèle dans le roman
policier».9
On peut penser aussi à «Marius Jacob, anarchiste individualiste et voleur de génie, condamné pour
n’avoir pas demandé au procès la clémence des juges. Jacob est
le modèle d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur».10
Avec l’Américain Edgar Poe, le créateur du genre, le roman
policier plongeait ses racines dans la littérature gothique du
tournant du XIXe siècle. Des anecdotes racontant les hauts faits de
truands comme Mandrin ou Cartouche «se
développait une autre littérature du crime : une littérature où
le crime est glorifié, mais parce qu’il est un des beaux-arts,
parce qu’il ne peut être l’œuvre que de natures d’exception,
parce qu’il révèle la monstruosité des forts et des puissants,
parce que la scélératesse est encore une façon d’être un
privilégié : du roman noir à Quincey, ou du
Château d’Otrante
à Baudelaire, il y a toute une réécriture esthétique du crime,
qui est aussi l’appropriation de la criminalité sous des formes
recevables. C’est, en apparence, la découverte de la beauté et de
la grandeur du crime; de fait c’est l’affirmation que la grandeur
aussi a droit au crime et qu’il devient même le privilège
exclusif de ceux qui sont réellement grands. Les beaux meurtres ne
sont pas pour les gagne-petit de l’illégalisme. Quant à la
littérature policière, à partir de Gaboriau, elle fait suite à ce
premier déplacement : par ses ruses, ses subtilités, l’acuité
extrême de son intelligence, le criminel qu’elle représente s’est
rendu insoupçonnable; et la lutte entre deux purs esprits - celui du
meurtrier, celui du  détective - constituera la forme essentielle de
l’affrontement. On est au plus loin de ces récits qui détaillaient
la vie et les méfaits du criminel, qui lui faisaient avouer lui-même
ses crimes, et qui racontaient par le menu le supplice enduré; on
est passé de l’exposé des faits ou de l’aveu au lent processus
de la découverte; du moment du supplice à la phase de l’enquête;
de l’affrontement physique avec le pouvoir à la lutte
intellectuelle entre le criminel et l’enquêteur.
[…] L’homme
du peuple est trop simple maintenant pour être le protagoniste des
vérités subtiles. Dans ce genre nouveau, il n’y a plus ni héros
populaires ni grandes exécutions; on y est méchant, mais
intelligent; et si on est puni, on n’a pas à souffrir. La
littérature policière transpose à une autre classe sociale cet
éclat dont le criminel avait été entouré. Les journaux, eux,
reprendront dans leurs faits divers quotidiens la grisaille sans
épopée des délits et de leurs punitions. Le partage est fait; que
le peuple se dépouille de l’ancien orgueil de ses crimes; les
grands assassinats sont devenus le jeu silencieux des sages».11
Comment s’étonner par après «que
le roman policier est la lecture favorite des hommes d’État, des
professeurs de Facultés dans nos universités les plus ancienne et,
en fait, de tout ce qu’il y a de plus intellectuel dans le
public».12 Alors que le jeune Hitler en restait à des romans pour adolescents
racontant des combats entre les Indiens et les cow-boys, Franklin D.
Roosevelt se passionnait pour les romans policiers, ce qui n’était
pas inconnu de son entourage. Lors du «voyage
naval qui le conduisit des États-Unis jusqu’à l’île de Malte,
dans la Méditerranée, à bord du croiseur de bataille
Quincey,
Roosevelt n’avait pratiquement pas quitté
détective - constituera la forme essentielle de
l’affrontement. On est au plus loin de ces récits qui détaillaient
la vie et les méfaits du criminel, qui lui faisaient avouer lui-même
ses crimes, et qui racontaient par le menu le supplice enduré; on
est passé de l’exposé des faits ou de l’aveu au lent processus
de la découverte; du moment du supplice à la phase de l’enquête;
de l’affrontement physique avec le pouvoir à la lutte
intellectuelle entre le criminel et l’enquêteur.
[…] L’homme
du peuple est trop simple maintenant pour être le protagoniste des
vérités subtiles. Dans ce genre nouveau, il n’y a plus ni héros
populaires ni grandes exécutions; on y est méchant, mais
intelligent; et si on est puni, on n’a pas à souffrir. La
littérature policière transpose à une autre classe sociale cet
éclat dont le criminel avait été entouré. Les journaux, eux,
reprendront dans leurs faits divers quotidiens la grisaille sans
épopée des délits et de leurs punitions. Le partage est fait; que
le peuple se dépouille de l’ancien orgueil de ses crimes; les
grands assassinats sont devenus le jeu silencieux des sages».11
Comment s’étonner par après «que
le roman policier est la lecture favorite des hommes d’État, des
professeurs de Facultés dans nos universités les plus ancienne et,
en fait, de tout ce qu’il y a de plus intellectuel dans le
public».12 Alors que le jeune Hitler en restait à des romans pour adolescents
racontant des combats entre les Indiens et les cow-boys, Franklin D.
Roosevelt se passionnait pour les romans policiers, ce qui n’était
pas inconnu de son entourage. Lors du «voyage
naval qui le conduisit des États-Unis jusqu’à l’île de Malte,
dans la Méditerranée, à bord du croiseur de bataille
Quincey,
Roosevelt n’avait pratiquement pas quitté  sa couchette. Lisant une
brassée de romans policiers, dont il se montrait habituellement
friand».13 Dès ses premiers tournages, le cinéma lui offrit une place
privilégiée dans ses scénarios et ce que Kracauer écrit à propos
du film de Gerhart Lamprecht de 1931, vaut pour l’ensemble de
l’Occident : «Le
personnage littéraire du détective est étroitement lié aux
institutions démocratiques. À travers l’appréciation de
l’habileté des gamins, Emilund die Detektive
suggère donc une certaine démocratisation de la vie quotidienne en
Allemagne. Cette déduction est étayée par l’attitude
indépendante et bien disciplinée des garçons, ainsi que par
l’utilisation de l’instantané dans le travail de la caméra».
sa couchette. Lisant une
brassée de romans policiers, dont il se montrait habituellement
friand».13 Dès ses premiers tournages, le cinéma lui offrit une place
privilégiée dans ses scénarios et ce que Kracauer écrit à propos
du film de Gerhart Lamprecht de 1931, vaut pour l’ensemble de
l’Occident : «Le
personnage littéraire du détective est étroitement lié aux
institutions démocratiques. À travers l’appréciation de
l’habileté des gamins, Emilund die Detektive
suggère donc une certaine démocratisation de la vie quotidienne en
Allemagne. Cette déduction est étayée par l’attitude
indépendante et bien disciplinée des garçons, ainsi que par
l’utilisation de l’instantané dans le travail de la caméra».
 police, faite d’espions plus que de limiers, a le
mérite d’être là, de faire partie du panorama de la ville.
Désormais, le policier est un type social. Le haut de forme, les
favoris, la redingote strictement boutonnée, le gourdin torsadé lui
composent une silhouette familière».8
Hugo s’en inspira dans Les
Misérables,
pour dessiner son policier opiniâtre, Javert.
La création d’un corps de police comme Scotland Yard, à Londres
en 1829, sous l’initiative du Premier ministre de l’époque, sir
Robert Peel, offrit le premier modèle qui devait être repris par
l’ensemble des nations occidentales. Entre les crimes de droit
commun et les assassinats, la répression des violences populaires et
l’utilisation à des fins politiques, les corps de police jouaient
le rôle d’une milice locale tenue par les lettres de la loi. La
violence physique cessa progressivement au détriment de la violence
psychologique, d’où l’importance de munir ces corps de l’esprit
positiviste de l’époque. L’ajout de laboratoires, de traités de
criminologie, d’experts (chimistes, physiciens, médecins,
psychiatres etc.) faisait de la police un corps scientifique,
faisant oublier par là sa fonction ultime : imposer l’ordre
bourgeois dans la cité. De là, on vit «se
dessiner une thématique qui a un bel avenir dans le secteur de
presse : l’héroïsation du flic.
L’apothéose de l’héroïsme flicard, qui fait du policier le
paladin, le défenseur solitaire et intrépide de l’ordre social se
reconnaît dans certaines chroniques complaisantes sur M. Goron, le
chef de la Sûreté et ses “meilleurs agents”, dans l’apologie
de “l’Inspecteur principal Jaume”. Goron qui passe pour avoir
résolu l’affaire Pranzini et l’affaire Allmeyer, est mythifié
pour son talent de
police, faite d’espions plus que de limiers, a le
mérite d’être là, de faire partie du panorama de la ville.
Désormais, le policier est un type social. Le haut de forme, les
favoris, la redingote strictement boutonnée, le gourdin torsadé lui
composent une silhouette familière».8
Hugo s’en inspira dans Les
Misérables,
pour dessiner son policier opiniâtre, Javert.
La création d’un corps de police comme Scotland Yard, à Londres
en 1829, sous l’initiative du Premier ministre de l’époque, sir
Robert Peel, offrit le premier modèle qui devait être repris par
l’ensemble des nations occidentales. Entre les crimes de droit
commun et les assassinats, la répression des violences populaires et
l’utilisation à des fins politiques, les corps de police jouaient
le rôle d’une milice locale tenue par les lettres de la loi. La
violence physique cessa progressivement au détriment de la violence
psychologique, d’où l’importance de munir ces corps de l’esprit
positiviste de l’époque. L’ajout de laboratoires, de traités de
criminologie, d’experts (chimistes, physiciens, médecins,
psychiatres etc.) faisait de la police un corps scientifique,
faisant oublier par là sa fonction ultime : imposer l’ordre
bourgeois dans la cité. De là, on vit «se
dessiner une thématique qui a un bel avenir dans le secteur de
presse : l’héroïsation du flic.
L’apothéose de l’héroïsme flicard, qui fait du policier le
paladin, le défenseur solitaire et intrépide de l’ordre social se
reconnaît dans certaines chroniques complaisantes sur M. Goron, le
chef de la Sûreté et ses “meilleurs agents”, dans l’apologie
de “l’Inspecteur principal Jaume”. Goron qui passe pour avoir
résolu l’affaire Pranzini et l’affaire Allmeyer, est mythifié
pour son talent de  détective et servira de modèle dans le roman
policier».9
On peut penser aussi à «Marius Jacob, anarchiste individualiste et voleur de génie, condamné pour
n’avoir pas demandé au procès la clémence des juges. Jacob est
le modèle d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur».10
Avec l’Américain Edgar Poe, le créateur du genre, le roman
policier plongeait ses racines dans la littérature gothique du
tournant du XIXe siècle. Des anecdotes racontant les hauts faits de
truands comme Mandrin ou Cartouche «se
développait une autre littérature du crime : une littérature où
le crime est glorifié, mais parce qu’il est un des beaux-arts,
parce qu’il ne peut être l’œuvre que de natures d’exception,
parce qu’il révèle la monstruosité des forts et des puissants,
parce que la scélératesse est encore une façon d’être un
privilégié : du roman noir à Quincey, ou du
Château d’Otrante
à Baudelaire, il y a toute une réécriture esthétique du crime,
qui est aussi l’appropriation de la criminalité sous des formes
recevables. C’est, en apparence, la découverte de la beauté et de
la grandeur du crime; de fait c’est l’affirmation que la grandeur
aussi a droit au crime et qu’il devient même le privilège
exclusif de ceux qui sont réellement grands. Les beaux meurtres ne
sont pas pour les gagne-petit de l’illégalisme. Quant à la
littérature policière, à partir de Gaboriau, elle fait suite à ce
premier déplacement : par ses ruses, ses subtilités, l’acuité
extrême de son intelligence, le criminel qu’elle représente s’est
rendu insoupçonnable; et la lutte entre deux purs esprits - celui du
meurtrier, celui du
détective et servira de modèle dans le roman
policier».9
On peut penser aussi à «Marius Jacob, anarchiste individualiste et voleur de génie, condamné pour
n’avoir pas demandé au procès la clémence des juges. Jacob est
le modèle d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur».10
Avec l’Américain Edgar Poe, le créateur du genre, le roman
policier plongeait ses racines dans la littérature gothique du
tournant du XIXe siècle. Des anecdotes racontant les hauts faits de
truands comme Mandrin ou Cartouche «se
développait une autre littérature du crime : une littérature où
le crime est glorifié, mais parce qu’il est un des beaux-arts,
parce qu’il ne peut être l’œuvre que de natures d’exception,
parce qu’il révèle la monstruosité des forts et des puissants,
parce que la scélératesse est encore une façon d’être un
privilégié : du roman noir à Quincey, ou du
Château d’Otrante
à Baudelaire, il y a toute une réécriture esthétique du crime,
qui est aussi l’appropriation de la criminalité sous des formes
recevables. C’est, en apparence, la découverte de la beauté et de
la grandeur du crime; de fait c’est l’affirmation que la grandeur
aussi a droit au crime et qu’il devient même le privilège
exclusif de ceux qui sont réellement grands. Les beaux meurtres ne
sont pas pour les gagne-petit de l’illégalisme. Quant à la
littérature policière, à partir de Gaboriau, elle fait suite à ce
premier déplacement : par ses ruses, ses subtilités, l’acuité
extrême de son intelligence, le criminel qu’elle représente s’est
rendu insoupçonnable; et la lutte entre deux purs esprits - celui du
meurtrier, celui du  détective - constituera la forme essentielle de
l’affrontement. On est au plus loin de ces récits qui détaillaient
la vie et les méfaits du criminel, qui lui faisaient avouer lui-même
ses crimes, et qui racontaient par le menu le supplice enduré; on
est passé de l’exposé des faits ou de l’aveu au lent processus
de la découverte; du moment du supplice à la phase de l’enquête;
de l’affrontement physique avec le pouvoir à la lutte
intellectuelle entre le criminel et l’enquêteur.
[…] L’homme
du peuple est trop simple maintenant pour être le protagoniste des
vérités subtiles. Dans ce genre nouveau, il n’y a plus ni héros
populaires ni grandes exécutions; on y est méchant, mais
intelligent; et si on est puni, on n’a pas à souffrir. La
littérature policière transpose à une autre classe sociale cet
éclat dont le criminel avait été entouré. Les journaux, eux,
reprendront dans leurs faits divers quotidiens la grisaille sans
épopée des délits et de leurs punitions. Le partage est fait; que
le peuple se dépouille de l’ancien orgueil de ses crimes; les
grands assassinats sont devenus le jeu silencieux des sages».11
Comment s’étonner par après «que
le roman policier est la lecture favorite des hommes d’État, des
professeurs de Facultés dans nos universités les plus ancienne et,
en fait, de tout ce qu’il y a de plus intellectuel dans le
public».12 Alors que le jeune Hitler en restait à des romans pour adolescents
racontant des combats entre les Indiens et les cow-boys, Franklin D.
Roosevelt se passionnait pour les romans policiers, ce qui n’était
pas inconnu de son entourage. Lors du «voyage
naval qui le conduisit des États-Unis jusqu’à l’île de Malte,
dans la Méditerranée, à bord du croiseur de bataille
Quincey,
Roosevelt n’avait pratiquement pas quitté
détective - constituera la forme essentielle de
l’affrontement. On est au plus loin de ces récits qui détaillaient
la vie et les méfaits du criminel, qui lui faisaient avouer lui-même
ses crimes, et qui racontaient par le menu le supplice enduré; on
est passé de l’exposé des faits ou de l’aveu au lent processus
de la découverte; du moment du supplice à la phase de l’enquête;
de l’affrontement physique avec le pouvoir à la lutte
intellectuelle entre le criminel et l’enquêteur.
[…] L’homme
du peuple est trop simple maintenant pour être le protagoniste des
vérités subtiles. Dans ce genre nouveau, il n’y a plus ni héros
populaires ni grandes exécutions; on y est méchant, mais
intelligent; et si on est puni, on n’a pas à souffrir. La
littérature policière transpose à une autre classe sociale cet
éclat dont le criminel avait été entouré. Les journaux, eux,
reprendront dans leurs faits divers quotidiens la grisaille sans
épopée des délits et de leurs punitions. Le partage est fait; que
le peuple se dépouille de l’ancien orgueil de ses crimes; les
grands assassinats sont devenus le jeu silencieux des sages».11
Comment s’étonner par après «que
le roman policier est la lecture favorite des hommes d’État, des
professeurs de Facultés dans nos universités les plus ancienne et,
en fait, de tout ce qu’il y a de plus intellectuel dans le
public».12 Alors que le jeune Hitler en restait à des romans pour adolescents
racontant des combats entre les Indiens et les cow-boys, Franklin D.
Roosevelt se passionnait pour les romans policiers, ce qui n’était
pas inconnu de son entourage. Lors du «voyage
naval qui le conduisit des États-Unis jusqu’à l’île de Malte,
dans la Méditerranée, à bord du croiseur de bataille
Quincey,
Roosevelt n’avait pratiquement pas quitté  sa couchette. Lisant une
brassée de romans policiers, dont il se montrait habituellement
friand».13 Dès ses premiers tournages, le cinéma lui offrit une place
privilégiée dans ses scénarios et ce que Kracauer écrit à propos
du film de Gerhart Lamprecht de 1931, vaut pour l’ensemble de
l’Occident : «Le
personnage littéraire du détective est étroitement lié aux
institutions démocratiques. À travers l’appréciation de
l’habileté des gamins, Emilund die Detektive
suggère donc une certaine démocratisation de la vie quotidienne en
Allemagne. Cette déduction est étayée par l’attitude
indépendante et bien disciplinée des garçons, ainsi que par
l’utilisation de l’instantané dans le travail de la caméra».
sa couchette. Lisant une
brassée de romans policiers, dont il se montrait habituellement
friand».13 Dès ses premiers tournages, le cinéma lui offrit une place
privilégiée dans ses scénarios et ce que Kracauer écrit à propos
du film de Gerhart Lamprecht de 1931, vaut pour l’ensemble de
l’Occident : «Le
personnage littéraire du détective est étroitement lié aux
institutions démocratiques. À travers l’appréciation de
l’habileté des gamins, Emilund die Detektive
suggère donc une certaine démocratisation de la vie quotidienne en
Allemagne. Cette déduction est étayée par l’attitude
indépendante et bien disciplinée des garçons, ainsi que par
l’utilisation de l’instantané dans le travail de la caméra».LE ROMAN-PROBLÈME
De la critique du roman gothique, Edgar Allan Poe avait tiré une histoire à suspens et à mystère qui ne portait en lui rien de merveilleux, ni même de fantastique contrairement à certains autres de ces contes. Ici, «le détective Dupin [était] incontestablement le fruit de la croyance de l’époque positiviste en la puissance du raisonnement logique qui arrive à surmonter tous les obstacles».15
 Dupin, le premier armchair
detective, s’en
remettait à un minimum d’enquête et à un maximum de jongleries
logiques afin d’épater son collègue, le narrateur, annonçant ces
couples imparables que sont Holmes/Watson et Poirot/Hastings. On peut
dire, avec Boileau-Narcejac, que le roman policier en est un «dont
les traits sont si fortement marqués qu’il n’a pas évolué,
depuis Edgar Poe, mais a simplement développé les virtualités
qu’il portait en sa nature.
[…] le
roman policier s’est développé en roman problème, en roman jeu,
en roman noir, en suspense, etc.».16
Il est resté cette «école
du roman-problème, tant l’issue de l’enquête ressemblait à un
problème d’algèbre».17
Si le roman policier a besoin d’un crime atroce pour commencer,
tout le reste se poursuit à travers des questionnements, des
hypothèses, des indices qui finissent par aboutir, presque sans
effort physique, à résoudre l’énigme. Contrairement à ce que le
cinéma nous a habitué à voir dans le film
noir, le
roman policier était peinard. Bourgeois, il se lisait au bord du
feu, par une soirée tranquille, où rien n'était sensé angoisser
le lecteur. Comme l'écrit Alfred Hitchcock dans une préface aux
Histoires
extraordinaires de
Poe : «La
peur, voyez-vous, est un sentiment que les hommes aiment éprouver
quand ils sont certains d'être en sécurité. Lorsqu'on est assis
tranquillement chez soi et qu'on lit une histoire macabre, on se sent
néanmoins en sécurité.
Dupin, le premier armchair
detective, s’en
remettait à un minimum d’enquête et à un maximum de jongleries
logiques afin d’épater son collègue, le narrateur, annonçant ces
couples imparables que sont Holmes/Watson et Poirot/Hastings. On peut
dire, avec Boileau-Narcejac, que le roman policier en est un «dont
les traits sont si fortement marqués qu’il n’a pas évolué,
depuis Edgar Poe, mais a simplement développé les virtualités
qu’il portait en sa nature.
[…] le
roman policier s’est développé en roman problème, en roman jeu,
en roman noir, en suspense, etc.».16
Il est resté cette «école
du roman-problème, tant l’issue de l’enquête ressemblait à un
problème d’algèbre».17
Si le roman policier a besoin d’un crime atroce pour commencer,
tout le reste se poursuit à travers des questionnements, des
hypothèses, des indices qui finissent par aboutir, presque sans
effort physique, à résoudre l’énigme. Contrairement à ce que le
cinéma nous a habitué à voir dans le film
noir, le
roman policier était peinard. Bourgeois, il se lisait au bord du
feu, par une soirée tranquille, où rien n'était sensé angoisser
le lecteur. Comme l'écrit Alfred Hitchcock dans une préface aux
Histoires
extraordinaires de
Poe : «La
peur, voyez-vous, est un sentiment que les hommes aiment éprouver
quand ils sont certains d'être en sécurité. Lorsqu'on est assis
tranquillement chez soi et qu'on lit une histoire macabre, on se sent
néanmoins en sécurité.  Naturellement, on tremble, mais, comme on
se trouve dans un décor familier, et quand on se rend compte que
seule l'imagination est responsable de la frayeur, on est envahi par
un extraordinaire bonheur. […]
Un
bonheur qui fait apprécier la douce chaleur que diffuse, sous son
abat-jour, la lampe amicale et le moelleux fauteuil dans lequel on
est confortablement assis».18
C’est aussi ce qu’il y a de plus pervers dans le roman policier,
ce qui le caractérise mieux que tout autre genre romanesque :
«le roman
policier classique, ce n’est pas l’enquête, la discussion des
témoignages, etc., c’est l’affirmation, souvent répétée,
qu’un bon roman policier est d’abord le récit d’une affaire
qui pourrait être vraie.
La déduction retire à la fiction ce qu’elle pourrait avoir
d’imaginaire et par là de hasardeux. La déduction fait d’une
histoire quelque chose d’historique, ou, du moins, on le croit
fermement».19
Cette quête du vraie relevait des origines positivistes du genre,
mais le jeu de se faire rappeler qu’on pourrait se faire
assassiner, pendant qu'on se délecte d'un récit macabre,
confortablement installé dans son moelleux fauteuil à côté de sa
lampe amicale sous son abat-jour, relevait d'un défi lancé aux
instincts primitifs de l’être humain. En cherchant la fascination
du lecteur ou du spectateur, le roman ou le film policier l’invitait
à soutenir une tension masochiste. Mais, heureusement, le détective
incorruptible et la science veillent. Il n’y a donc rien à
craindre.
Naturellement, on tremble, mais, comme on
se trouve dans un décor familier, et quand on se rend compte que
seule l'imagination est responsable de la frayeur, on est envahi par
un extraordinaire bonheur. […]
Un
bonheur qui fait apprécier la douce chaleur que diffuse, sous son
abat-jour, la lampe amicale et le moelleux fauteuil dans lequel on
est confortablement assis».18
C’est aussi ce qu’il y a de plus pervers dans le roman policier,
ce qui le caractérise mieux que tout autre genre romanesque :
«le roman
policier classique, ce n’est pas l’enquête, la discussion des
témoignages, etc., c’est l’affirmation, souvent répétée,
qu’un bon roman policier est d’abord le récit d’une affaire
qui pourrait être vraie.
La déduction retire à la fiction ce qu’elle pourrait avoir
d’imaginaire et par là de hasardeux. La déduction fait d’une
histoire quelque chose d’historique, ou, du moins, on le croit
fermement».19
Cette quête du vraie relevait des origines positivistes du genre,
mais le jeu de se faire rappeler qu’on pourrait se faire
assassiner, pendant qu'on se délecte d'un récit macabre,
confortablement installé dans son moelleux fauteuil à côté de sa
lampe amicale sous son abat-jour, relevait d'un défi lancé aux
instincts primitifs de l’être humain. En cherchant la fascination
du lecteur ou du spectateur, le roman ou le film policier l’invitait
à soutenir une tension masochiste. Mais, heureusement, le détective
incorruptible et la science veillent. Il n’y a donc rien à
craindre.
C’était
déjà cela dans les nouvelles de Poe : la quête de l'exorcisme
des angoisses. Double
assassinat dans la rue Morgue, où
apparaît Dupin, après un exercice de logique déroutante aux yeux
du narrateur, «suit
une description horrible. Il y a un rasoir souillé de sang, des
cheveux arrachés, un cadavre égorgé dont la tête se détache du
tronc, etc. Ce monde atroce est celui du
thriller,
de l’effroi  pour l’effroi. Mais Poe a pris soin de compenser, en
quelque sorte, la terreur par l’étonnement. Les deux sentiments
sont produits ensemble. Bien plus, ils se fortifient mutuellement. La
terreur est d’autant plus grande que l’on ne comprend pas;
l’étonnement est d’autant plus grand que la réflexion est
paralysée par la terreur. C’est pourquoi le lecteur, comme le
spectateur, est jeté hors de lui-même et appelle silencieusement au
secours. Vite! Qu’on lui dise ce qui s’est passé, car si la
moindre lueur luisait dans ces ténèbres, il demeurerait fortement
secoué mais commencerait à se reprendre, c’est-à-dire à dominer
une situation jusque-là affolante».20
Le lecteur se montre trop obnubilé par l'effet
à sensation qu'il
ne peut plus réfléchir ni analyser.
Poe
voulait que ce soit là «le
point de départ
[qui] constitue
les données du problème sur lesquelles s’articule la “déduction”.
Pourquoi ces guillemets? Dupin, en effet, ne va pas du général au
particulier, du principe à la conséquence (déduction), ni même
exactement du particulier au général (induction), mais du
particulier (faits épars) au particulier (la cause)».21
Contrairement aux détectives ultérieurs, Dupin ne s’intéresse
nullement à la vie ni au passé de Mme
Lespanaye et de sa fille; il ne s’intéresse pas plus aux témoins
qui ne sont que des témoins auditifs dont les déclarations se
contredisent. Il n’y a pas de suspect. La seule énigme, outre la
sauvagerie du crime, c’est le fait que la pièce était fermée de
l’intérieure et qu’on ignore comment le criminel a pu y entrer
et puis s’enfuir. Le seul indice, et nous le saurons au moment du
dévoilement de l’intrigue, est une touffe de poil brunâtre
récupérée à la fenêtre. Dès lors, l’esprit algébrique de
Dupin a, non pas deviné mais trouvé
qui est l’assassin. «Poe
est l’inventeur d’un genre littéraire qui repose sur un double
émerveillement : on éblouit d’abord le lecteur en embrouillant
les données pour lui cacher la vérité; puis on l’éblouit de
nouveau en
pour l’effroi. Mais Poe a pris soin de compenser, en
quelque sorte, la terreur par l’étonnement. Les deux sentiments
sont produits ensemble. Bien plus, ils se fortifient mutuellement. La
terreur est d’autant plus grande que l’on ne comprend pas;
l’étonnement est d’autant plus grand que la réflexion est
paralysée par la terreur. C’est pourquoi le lecteur, comme le
spectateur, est jeté hors de lui-même et appelle silencieusement au
secours. Vite! Qu’on lui dise ce qui s’est passé, car si la
moindre lueur luisait dans ces ténèbres, il demeurerait fortement
secoué mais commencerait à se reprendre, c’est-à-dire à dominer
une situation jusque-là affolante».20
Le lecteur se montre trop obnubilé par l'effet
à sensation qu'il
ne peut plus réfléchir ni analyser.
Poe
voulait que ce soit là «le
point de départ
[qui] constitue
les données du problème sur lesquelles s’articule la “déduction”.
Pourquoi ces guillemets? Dupin, en effet, ne va pas du général au
particulier, du principe à la conséquence (déduction), ni même
exactement du particulier au général (induction), mais du
particulier (faits épars) au particulier (la cause)».21
Contrairement aux détectives ultérieurs, Dupin ne s’intéresse
nullement à la vie ni au passé de Mme
Lespanaye et de sa fille; il ne s’intéresse pas plus aux témoins
qui ne sont que des témoins auditifs dont les déclarations se
contredisent. Il n’y a pas de suspect. La seule énigme, outre la
sauvagerie du crime, c’est le fait que la pièce était fermée de
l’intérieure et qu’on ignore comment le criminel a pu y entrer
et puis s’enfuir. Le seul indice, et nous le saurons au moment du
dévoilement de l’intrigue, est une touffe de poil brunâtre
récupérée à la fenêtre. Dès lors, l’esprit algébrique de
Dupin a, non pas deviné mais trouvé
qui est l’assassin. «Poe
est l’inventeur d’un genre littéraire qui repose sur un double
émerveillement : on éblouit d’abord le lecteur en embrouillant
les données pour lui cacher la vérité; puis on l’éblouit de
nouveau en  rétablissant la logique des faits, et en montrant au
lecteur qu’il a toujours eu la solution sous les yeux sans la voir.
Sherlock Holmes et Hercule Poirot ne sont que les brillants disciples
de Dupin».22
Disons-le, c’est une fumisterie.
Elle
était pourtant essentielle au bon fonctionnement du roman policier.
Comme un magicien qui distrairait son public par le corps de Mlle
l’Espanaye fourré dans la cheminée, il sort du chapeau, non un
lapin mais un orang-outan. Entre l’hallucination et la déduction,
Poe posait l’alternative entre la faillite de l'esprit et sa
reprise en main. La fascination résultait de cet exercice
vertigineux : «Ses
héros se répartissent selon une hiérarchie, dont les degrés sont
ceux de l’initiation à la logique : au ciel l’archange de la
déduction; en enfer les possédés de l’hallucination.
[…] Ayant
démonté le mécanismes des choses, Poe se croit le maître du
monde. Il est rassuré.
[…] C’est
pourtant à ces mécanismes de déduction que Poe tient le plus. Il a
deux visages, et toujours insiste pour qu’on fasse part égale aux
deux profils de son œuvre : d’une part les contes d’impuissance,
ou contes d’halluciné, d’autre part les contes de puissance ou
contes de maître de la déduction, où Poe dresse de soi-même une
silhouette de grand Logicien».23
La fascination conduit à des hallucinations comparables à celles
produites par l’usage de drogues ou de spiritueux. Combien de
contes de Poe se réduisaient à des phénomènes hallucinatoires,
tels L’ange
du bizarre ou
Le sphinx.
La
déduction, qui est également un travail de l’esprit, conduit à
solutionner des problèmes à première vue insolubles : Double
assassinat dans la rue Morgue, Le mystère de Marie Rogêt, Le
scarabée d’or et
surtout La
lettre volée se
veulent des exemples de la
puissance de l’esprit. Lorsque
Freud parle de l’inhibition
rétablissant la logique des faits, et en montrant au
lecteur qu’il a toujours eu la solution sous les yeux sans la voir.
Sherlock Holmes et Hercule Poirot ne sont que les brillants disciples
de Dupin».22
Disons-le, c’est une fumisterie.
Elle
était pourtant essentielle au bon fonctionnement du roman policier.
Comme un magicien qui distrairait son public par le corps de Mlle
l’Espanaye fourré dans la cheminée, il sort du chapeau, non un
lapin mais un orang-outan. Entre l’hallucination et la déduction,
Poe posait l’alternative entre la faillite de l'esprit et sa
reprise en main. La fascination résultait de cet exercice
vertigineux : «Ses
héros se répartissent selon une hiérarchie, dont les degrés sont
ceux de l’initiation à la logique : au ciel l’archange de la
déduction; en enfer les possédés de l’hallucination.
[…] Ayant
démonté le mécanismes des choses, Poe se croit le maître du
monde. Il est rassuré.
[…] C’est
pourtant à ces mécanismes de déduction que Poe tient le plus. Il a
deux visages, et toujours insiste pour qu’on fasse part égale aux
deux profils de son œuvre : d’une part les contes d’impuissance,
ou contes d’halluciné, d’autre part les contes de puissance ou
contes de maître de la déduction, où Poe dresse de soi-même une
silhouette de grand Logicien».23
La fascination conduit à des hallucinations comparables à celles
produites par l’usage de drogues ou de spiritueux. Combien de
contes de Poe se réduisaient à des phénomènes hallucinatoires,
tels L’ange
du bizarre ou
Le sphinx.
La
déduction, qui est également un travail de l’esprit, conduit à
solutionner des problèmes à première vue insolubles : Double
assassinat dans la rue Morgue, Le mystère de Marie Rogêt, Le
scarabée d’or et
surtout La
lettre volée se
veulent des exemples de la
puissance de l’esprit. Lorsque
Freud parle de l’inhibition  de l’éros par l'activité cérébrale
ou que Pascal, avant lui, mentionnait la libido
sciendi, il
y a, chez Poe, une sublimation comparable de l’hallucination à la
déduction, bien différente de ce que peut en tirer un fonctionnaire
qui ne voit un crime que comme une affaire à classer pour rassurer
la population. Cette «sagesse
du préfet “est tout en tête et n’a pas de corps”. C’est
donc que la sagesse de Dupin, elle, en a, du corps. Qu’est-ce à
dire? Comme toujours chez Poe, la fin du conte s’éclaire de son
début. Le premier paragraphe s’ouvre sur la difficulté de savoir
comment analyser les facultés analytiques. La solution, oblique,
consiste à apprécier leur effet sur celui qui les exerce. Or cet
effet, c’est le plaisir. Les synonymes se bousculent, portés par
une comparaison avec le plaisir physique de l’athlète : l’analyse
offre “une source de jubilation des plus vives”, l’analyste “se
réjouit”, “exulte”, “triomphe”, “tire du plaisir”,
“raffole”. Le plaisir chez Dupin est tout entier cérébral, ce
qui ne signifie pas que Dupin est un pur cerveau mais que toutes ses
énergies vitales se sont là concentrées, voire réfugiées; son
intelligence est “surexcitée, malade peut-être”. D’où le
voyeurisme de ses déambulations nocturnes dans la “populeuse cité”
: elles lui donnent non pas “ces innombrables excitations
spirituelles que l’étude paisible ne peut pas donner” comme
Baudelaire continue à le faire croire à d’innocents lecteurs,
mais bien “ces innombrables excitations
mentales
que peut
offrir l’observation
tranquille”.
Instincts, affects, passions, tout est là, mis à distance de
regard, d’intellection. Le corps est tranquille, comme vide, le
cerveau “a du corps”».24
de l’éros par l'activité cérébrale
ou que Pascal, avant lui, mentionnait la libido
sciendi, il
y a, chez Poe, une sublimation comparable de l’hallucination à la
déduction, bien différente de ce que peut en tirer un fonctionnaire
qui ne voit un crime que comme une affaire à classer pour rassurer
la population. Cette «sagesse
du préfet “est tout en tête et n’a pas de corps”. C’est
donc que la sagesse de Dupin, elle, en a, du corps. Qu’est-ce à
dire? Comme toujours chez Poe, la fin du conte s’éclaire de son
début. Le premier paragraphe s’ouvre sur la difficulté de savoir
comment analyser les facultés analytiques. La solution, oblique,
consiste à apprécier leur effet sur celui qui les exerce. Or cet
effet, c’est le plaisir. Les synonymes se bousculent, portés par
une comparaison avec le plaisir physique de l’athlète : l’analyse
offre “une source de jubilation des plus vives”, l’analyste “se
réjouit”, “exulte”, “triomphe”, “tire du plaisir”,
“raffole”. Le plaisir chez Dupin est tout entier cérébral, ce
qui ne signifie pas que Dupin est un pur cerveau mais que toutes ses
énergies vitales se sont là concentrées, voire réfugiées; son
intelligence est “surexcitée, malade peut-être”. D’où le
voyeurisme de ses déambulations nocturnes dans la “populeuse cité”
: elles lui donnent non pas “ces innombrables excitations
spirituelles que l’étude paisible ne peut pas donner” comme
Baudelaire continue à le faire croire à d’innocents lecteurs,
mais bien “ces innombrables excitations
mentales
que peut
offrir l’observation
tranquille”.
Instincts, affects, passions, tout est là, mis à distance de
regard, d’intellection. Le corps est tranquille, comme vide, le
cerveau “a du corps”».24
 pour l’effroi. Mais Poe a pris soin de compenser, en
quelque sorte, la terreur par l’étonnement. Les deux sentiments
sont produits ensemble. Bien plus, ils se fortifient mutuellement. La
terreur est d’autant plus grande que l’on ne comprend pas;
l’étonnement est d’autant plus grand que la réflexion est
paralysée par la terreur. C’est pourquoi le lecteur, comme le
spectateur, est jeté hors de lui-même et appelle silencieusement au
secours. Vite! Qu’on lui dise ce qui s’est passé, car si la
moindre lueur luisait dans ces ténèbres, il demeurerait fortement
secoué mais commencerait à se reprendre, c’est-à-dire à dominer
une situation jusque-là affolante».20
Le lecteur se montre trop obnubilé par l'effet
à sensation qu'il
ne peut plus réfléchir ni analyser.
Poe
voulait que ce soit là «le
point de départ
[qui] constitue
les données du problème sur lesquelles s’articule la “déduction”.
Pourquoi ces guillemets? Dupin, en effet, ne va pas du général au
particulier, du principe à la conséquence (déduction), ni même
exactement du particulier au général (induction), mais du
particulier (faits épars) au particulier (la cause)».21
Contrairement aux détectives ultérieurs, Dupin ne s’intéresse
nullement à la vie ni au passé de Mme
Lespanaye et de sa fille; il ne s’intéresse pas plus aux témoins
qui ne sont que des témoins auditifs dont les déclarations se
contredisent. Il n’y a pas de suspect. La seule énigme, outre la
sauvagerie du crime, c’est le fait que la pièce était fermée de
l’intérieure et qu’on ignore comment le criminel a pu y entrer
et puis s’enfuir. Le seul indice, et nous le saurons au moment du
dévoilement de l’intrigue, est une touffe de poil brunâtre
récupérée à la fenêtre. Dès lors, l’esprit algébrique de
Dupin a, non pas deviné mais trouvé
qui est l’assassin. «Poe
est l’inventeur d’un genre littéraire qui repose sur un double
émerveillement : on éblouit d’abord le lecteur en embrouillant
les données pour lui cacher la vérité; puis on l’éblouit de
nouveau en
pour l’effroi. Mais Poe a pris soin de compenser, en
quelque sorte, la terreur par l’étonnement. Les deux sentiments
sont produits ensemble. Bien plus, ils se fortifient mutuellement. La
terreur est d’autant plus grande que l’on ne comprend pas;
l’étonnement est d’autant plus grand que la réflexion est
paralysée par la terreur. C’est pourquoi le lecteur, comme le
spectateur, est jeté hors de lui-même et appelle silencieusement au
secours. Vite! Qu’on lui dise ce qui s’est passé, car si la
moindre lueur luisait dans ces ténèbres, il demeurerait fortement
secoué mais commencerait à se reprendre, c’est-à-dire à dominer
une situation jusque-là affolante».20
Le lecteur se montre trop obnubilé par l'effet
à sensation qu'il
ne peut plus réfléchir ni analyser.
Poe
voulait que ce soit là «le
point de départ
[qui] constitue
les données du problème sur lesquelles s’articule la “déduction”.
Pourquoi ces guillemets? Dupin, en effet, ne va pas du général au
particulier, du principe à la conséquence (déduction), ni même
exactement du particulier au général (induction), mais du
particulier (faits épars) au particulier (la cause)».21
Contrairement aux détectives ultérieurs, Dupin ne s’intéresse
nullement à la vie ni au passé de Mme
Lespanaye et de sa fille; il ne s’intéresse pas plus aux témoins
qui ne sont que des témoins auditifs dont les déclarations se
contredisent. Il n’y a pas de suspect. La seule énigme, outre la
sauvagerie du crime, c’est le fait que la pièce était fermée de
l’intérieure et qu’on ignore comment le criminel a pu y entrer
et puis s’enfuir. Le seul indice, et nous le saurons au moment du
dévoilement de l’intrigue, est une touffe de poil brunâtre
récupérée à la fenêtre. Dès lors, l’esprit algébrique de
Dupin a, non pas deviné mais trouvé
qui est l’assassin. «Poe
est l’inventeur d’un genre littéraire qui repose sur un double
émerveillement : on éblouit d’abord le lecteur en embrouillant
les données pour lui cacher la vérité; puis on l’éblouit de
nouveau en  rétablissant la logique des faits, et en montrant au
lecteur qu’il a toujours eu la solution sous les yeux sans la voir.
Sherlock Holmes et Hercule Poirot ne sont que les brillants disciples
de Dupin».22
Disons-le, c’est une fumisterie.
Elle
était pourtant essentielle au bon fonctionnement du roman policier.
Comme un magicien qui distrairait son public par le corps de Mlle
l’Espanaye fourré dans la cheminée, il sort du chapeau, non un
lapin mais un orang-outan. Entre l’hallucination et la déduction,
Poe posait l’alternative entre la faillite de l'esprit et sa
reprise en main. La fascination résultait de cet exercice
vertigineux : «Ses
héros se répartissent selon une hiérarchie, dont les degrés sont
ceux de l’initiation à la logique : au ciel l’archange de la
déduction; en enfer les possédés de l’hallucination.
[…] Ayant
démonté le mécanismes des choses, Poe se croit le maître du
monde. Il est rassuré.
[…] C’est
pourtant à ces mécanismes de déduction que Poe tient le plus. Il a
deux visages, et toujours insiste pour qu’on fasse part égale aux
deux profils de son œuvre : d’une part les contes d’impuissance,
ou contes d’halluciné, d’autre part les contes de puissance ou
contes de maître de la déduction, où Poe dresse de soi-même une
silhouette de grand Logicien».23
La fascination conduit à des hallucinations comparables à celles
produites par l’usage de drogues ou de spiritueux. Combien de
contes de Poe se réduisaient à des phénomènes hallucinatoires,
tels L’ange
du bizarre ou
Le sphinx.
La
déduction, qui est également un travail de l’esprit, conduit à
solutionner des problèmes à première vue insolubles : Double
assassinat dans la rue Morgue, Le mystère de Marie Rogêt, Le
scarabée d’or et
surtout La
lettre volée se
veulent des exemples de la
puissance de l’esprit. Lorsque
Freud parle de l’inhibition
rétablissant la logique des faits, et en montrant au
lecteur qu’il a toujours eu la solution sous les yeux sans la voir.
Sherlock Holmes et Hercule Poirot ne sont que les brillants disciples
de Dupin».22
Disons-le, c’est une fumisterie.
Elle
était pourtant essentielle au bon fonctionnement du roman policier.
Comme un magicien qui distrairait son public par le corps de Mlle
l’Espanaye fourré dans la cheminée, il sort du chapeau, non un
lapin mais un orang-outan. Entre l’hallucination et la déduction,
Poe posait l’alternative entre la faillite de l'esprit et sa
reprise en main. La fascination résultait de cet exercice
vertigineux : «Ses
héros se répartissent selon une hiérarchie, dont les degrés sont
ceux de l’initiation à la logique : au ciel l’archange de la
déduction; en enfer les possédés de l’hallucination.
[…] Ayant
démonté le mécanismes des choses, Poe se croit le maître du
monde. Il est rassuré.
[…] C’est
pourtant à ces mécanismes de déduction que Poe tient le plus. Il a
deux visages, et toujours insiste pour qu’on fasse part égale aux
deux profils de son œuvre : d’une part les contes d’impuissance,
ou contes d’halluciné, d’autre part les contes de puissance ou
contes de maître de la déduction, où Poe dresse de soi-même une
silhouette de grand Logicien».23
La fascination conduit à des hallucinations comparables à celles
produites par l’usage de drogues ou de spiritueux. Combien de
contes de Poe se réduisaient à des phénomènes hallucinatoires,
tels L’ange
du bizarre ou
Le sphinx.
La
déduction, qui est également un travail de l’esprit, conduit à
solutionner des problèmes à première vue insolubles : Double
assassinat dans la rue Morgue, Le mystère de Marie Rogêt, Le
scarabée d’or et
surtout La
lettre volée se
veulent des exemples de la
puissance de l’esprit. Lorsque
Freud parle de l’inhibition  de l’éros par l'activité cérébrale
ou que Pascal, avant lui, mentionnait la libido
sciendi, il
y a, chez Poe, une sublimation comparable de l’hallucination à la
déduction, bien différente de ce que peut en tirer un fonctionnaire
qui ne voit un crime que comme une affaire à classer pour rassurer
la population. Cette «sagesse
du préfet “est tout en tête et n’a pas de corps”. C’est
donc que la sagesse de Dupin, elle, en a, du corps. Qu’est-ce à
dire? Comme toujours chez Poe, la fin du conte s’éclaire de son
début. Le premier paragraphe s’ouvre sur la difficulté de savoir
comment analyser les facultés analytiques. La solution, oblique,
consiste à apprécier leur effet sur celui qui les exerce. Or cet
effet, c’est le plaisir. Les synonymes se bousculent, portés par
une comparaison avec le plaisir physique de l’athlète : l’analyse
offre “une source de jubilation des plus vives”, l’analyste “se
réjouit”, “exulte”, “triomphe”, “tire du plaisir”,
“raffole”. Le plaisir chez Dupin est tout entier cérébral, ce
qui ne signifie pas que Dupin est un pur cerveau mais que toutes ses
énergies vitales se sont là concentrées, voire réfugiées; son
intelligence est “surexcitée, malade peut-être”. D’où le
voyeurisme de ses déambulations nocturnes dans la “populeuse cité”
: elles lui donnent non pas “ces innombrables excitations
spirituelles que l’étude paisible ne peut pas donner” comme
Baudelaire continue à le faire croire à d’innocents lecteurs,
mais bien “ces innombrables excitations
mentales
que peut
offrir l’observation
tranquille”.
Instincts, affects, passions, tout est là, mis à distance de
regard, d’intellection. Le corps est tranquille, comme vide, le
cerveau “a du corps”».24
de l’éros par l'activité cérébrale
ou que Pascal, avant lui, mentionnait la libido
sciendi, il
y a, chez Poe, une sublimation comparable de l’hallucination à la
déduction, bien différente de ce que peut en tirer un fonctionnaire
qui ne voit un crime que comme une affaire à classer pour rassurer
la population. Cette «sagesse
du préfet “est tout en tête et n’a pas de corps”. C’est
donc que la sagesse de Dupin, elle, en a, du corps. Qu’est-ce à
dire? Comme toujours chez Poe, la fin du conte s’éclaire de son
début. Le premier paragraphe s’ouvre sur la difficulté de savoir
comment analyser les facultés analytiques. La solution, oblique,
consiste à apprécier leur effet sur celui qui les exerce. Or cet
effet, c’est le plaisir. Les synonymes se bousculent, portés par
une comparaison avec le plaisir physique de l’athlète : l’analyse
offre “une source de jubilation des plus vives”, l’analyste “se
réjouit”, “exulte”, “triomphe”, “tire du plaisir”,
“raffole”. Le plaisir chez Dupin est tout entier cérébral, ce
qui ne signifie pas que Dupin est un pur cerveau mais que toutes ses
énergies vitales se sont là concentrées, voire réfugiées; son
intelligence est “surexcitée, malade peut-être”. D’où le
voyeurisme de ses déambulations nocturnes dans la “populeuse cité”
: elles lui donnent non pas “ces innombrables excitations
spirituelles que l’étude paisible ne peut pas donner” comme
Baudelaire continue à le faire croire à d’innocents lecteurs,
mais bien “ces innombrables excitations
mentales
que peut
offrir l’observation
tranquille”.
Instincts, affects, passions, tout est là, mis à distance de
regard, d’intellection. Le corps est tranquille, comme vide, le
cerveau “a du corps”».24
L’intellection
des pulsions fut une des grandes affaires du siècle.
L’historiographie cherchait les motivations des gestes historiques,
dans les décisions politiques et les plans de bataille. La
psychanalyse cherchait, elle, les motivations au meurtre du Père.
Déjà, on se rapprochait de la structure du roman policier. Freud
dénonçait la phratrie comme étant la criminelle et la Mère comme
objet du butin à se partager. Les historiens, plutôt, cherchaient
dans l’appétit du pouvoir, la protection  et l’expansion du
territoire national ou de l’économie de marché. Dans un sens,
chacun parvenait à la solution sans s’apercevoir qu’il
s’agissait du même crime et des mêmes coupables. Le roman
policier devait aboutir à des réponses similaires : les
victimes sont généralement des gens de la haute – on ne
s’intéresse pas à un voyou tué au fond d’une ruelle -, il y a
soit des affaires d’héritage, de dot, de dettes ou de chantage
derrière les mobiles du crime. De la jalousie aussi. Les héritiers
de Dupin suivirent la voie tracée par Poe. «Lecoq…
fut créé par le romancier français Émile Gaboriau qui en 1873
mourut d’épuisement à l’âge de trente-neuf ans à peine et au
moment où, ayant été expulsé de plusieurs rédactions, il avait
déjà écrit vingt-neuf romans. Dans ses livres :
Le Dossier, Le Crime d’Orcival, Monsieur Lecoq
et Les
Esclaves de Paris,
tous conçus dans les années 1867-1869, Gaboriau tentait de trouver
les mobiles du délit et de définir les circonstances qui
l’accompagnaient. Bien que représentant l’école du raisonnement
logique et de la déduction, Lecoq était en même temps quelque
chose de plus. Il procédait à une inspection minutieuse du lieu du
crime, inspection qui lui fournissait des données servant ensuite à
échafauder des hypothèses formulées selon les principes de la
logique. Dans
Monsieur Lecoq,
le détective, accompagné de plusieurs amis, se rend sur le lieu du
méfait, une taverne située à côté des fortifications de Paris
qui à ce moment-là sont couvertes d’une épaisse couche de neige.
Lecoq arrête ses compagnons, leur interdisant de bouger afin de ne
pas effacer les traces, examine l’endroit, observe chaque détail,
renifle l’air, se couche par terre, aperçoit des pas dans la
neige, les suit pendant un moment, puis termine son enquête par ces
mots : “Maintenant je sais tout. Cette couche de neige est comme
une belle feuille de papier sur laquelle les hommes que nous
cherchons ont inscrit non seulement leurs actes et leur façon
d’agir, mais aussi leurs pensées secrètes, espérances,
angoisses. Ces traces ne vous disent rien. Pour moi, elles sont
vivantes…”».25
Une génération après Dupin, Lecoq avait fait progresser
l’idiosyncrasie du détective. Il ne se contentait plus seulement
de réfléchir dans la pénombre. Il se portait sur les lieux du
crime et avançait vers les criminels. Lorsque le roman policier perd
toute logique et régresse vers les effets du conte gothique, il perd
de sa substance, ce qui en coûta à «l’auteur
de Varney
[attribué
tantôt à James Malcolm Rymer, tantôt à Thomas Pecket Prest,
et l’expansion du
territoire national ou de l’économie de marché. Dans un sens,
chacun parvenait à la solution sans s’apercevoir qu’il
s’agissait du même crime et des mêmes coupables. Le roman
policier devait aboutir à des réponses similaires : les
victimes sont généralement des gens de la haute – on ne
s’intéresse pas à un voyou tué au fond d’une ruelle -, il y a
soit des affaires d’héritage, de dot, de dettes ou de chantage
derrière les mobiles du crime. De la jalousie aussi. Les héritiers
de Dupin suivirent la voie tracée par Poe. «Lecoq…
fut créé par le romancier français Émile Gaboriau qui en 1873
mourut d’épuisement à l’âge de trente-neuf ans à peine et au
moment où, ayant été expulsé de plusieurs rédactions, il avait
déjà écrit vingt-neuf romans. Dans ses livres :
Le Dossier, Le Crime d’Orcival, Monsieur Lecoq
et Les
Esclaves de Paris,
tous conçus dans les années 1867-1869, Gaboriau tentait de trouver
les mobiles du délit et de définir les circonstances qui
l’accompagnaient. Bien que représentant l’école du raisonnement
logique et de la déduction, Lecoq était en même temps quelque
chose de plus. Il procédait à une inspection minutieuse du lieu du
crime, inspection qui lui fournissait des données servant ensuite à
échafauder des hypothèses formulées selon les principes de la
logique. Dans
Monsieur Lecoq,
le détective, accompagné de plusieurs amis, se rend sur le lieu du
méfait, une taverne située à côté des fortifications de Paris
qui à ce moment-là sont couvertes d’une épaisse couche de neige.
Lecoq arrête ses compagnons, leur interdisant de bouger afin de ne
pas effacer les traces, examine l’endroit, observe chaque détail,
renifle l’air, se couche par terre, aperçoit des pas dans la
neige, les suit pendant un moment, puis termine son enquête par ces
mots : “Maintenant je sais tout. Cette couche de neige est comme
une belle feuille de papier sur laquelle les hommes que nous
cherchons ont inscrit non seulement leurs actes et leur façon
d’agir, mais aussi leurs pensées secrètes, espérances,
angoisses. Ces traces ne vous disent rien. Pour moi, elles sont
vivantes…”».25
Une génération après Dupin, Lecoq avait fait progresser
l’idiosyncrasie du détective. Il ne se contentait plus seulement
de réfléchir dans la pénombre. Il se portait sur les lieux du
crime et avançait vers les criminels. Lorsque le roman policier perd
toute logique et régresse vers les effets du conte gothique, il perd
de sa substance, ce qui en coûta à «l’auteur
de Varney
[attribué
tantôt à James Malcolm Rymer, tantôt à Thomas Pecket Prest,  qui]
a besoin,
lui, de 868 pages à doubles colonnes, représentant 220 chapitres.
Le roman connut réédition en 1853, en feuilleton populaire.
Varney ne
se targue d’aucune prétention littéraire : c’est une histoire
crépitante, qui se répète de temps à autre dans ses grandes
lignes. L’action, située dans les années 1730, campe un certain
sir Varney dont les exploits permettent de le désigner comme le
principal précurseur littéraire de Dracula. Les ingrédients que
Bram Stoker reprendra plus tard comprennent : l’initiation sexuelle
et les réactions ambiguës des jeunes filles, les racines
vampiriques en Europe Centrale, les méthodes quasi-scientifiques
pour la destruction du vampire et la chasse à l’ennemi dans un
style “policier privé”. Varney inclut aussi des victimes
somnambules et un traître en manteau noir qui descend le long d’un
mur de château, puis arrive en Angleterre à bord d’un navire -
lequel fait naufrage au milieu d’une tempête».26
Pour un auteur de roman policier qui respectait son genre, l’occulte
n’intervenait que comme une mystification prenant part à la
commission du crime ou comme diversion pour égarer les soupçons.
Ainsi, Father Brown, personnage de G. K. Chesterton : «Jamais
il n’est montré seul, livré à lui-même. Il n’existe qu’à
travers le besoin d’aide que son prochain éprouve. Donc
personnalité discrète, révélée de façon fragmentaire, au hasard
des relations sociales, à travers le regard d’autrui. Érudition
et culture - acquises Dieu sait où - ne lui font pas défaut. Une
aisance à déceler l’imposture ou la fabrication de certaines
légendes et malédictions familiales dénote la possession de
solides notions historico-sociales. On l’a même entendu parler
“d’histoire naturelle en faisant montre de connaissances
approfondies et plutôt surprenantes”
(les Naufrages des Pandragon)».27
qui]
a besoin,
lui, de 868 pages à doubles colonnes, représentant 220 chapitres.
Le roman connut réédition en 1853, en feuilleton populaire.
Varney ne
se targue d’aucune prétention littéraire : c’est une histoire
crépitante, qui se répète de temps à autre dans ses grandes
lignes. L’action, située dans les années 1730, campe un certain
sir Varney dont les exploits permettent de le désigner comme le
principal précurseur littéraire de Dracula. Les ingrédients que
Bram Stoker reprendra plus tard comprennent : l’initiation sexuelle
et les réactions ambiguës des jeunes filles, les racines
vampiriques en Europe Centrale, les méthodes quasi-scientifiques
pour la destruction du vampire et la chasse à l’ennemi dans un
style “policier privé”. Varney inclut aussi des victimes
somnambules et un traître en manteau noir qui descend le long d’un
mur de château, puis arrive en Angleterre à bord d’un navire -
lequel fait naufrage au milieu d’une tempête».26
Pour un auteur de roman policier qui respectait son genre, l’occulte
n’intervenait que comme une mystification prenant part à la
commission du crime ou comme diversion pour égarer les soupçons.
Ainsi, Father Brown, personnage de G. K. Chesterton : «Jamais
il n’est montré seul, livré à lui-même. Il n’existe qu’à
travers le besoin d’aide que son prochain éprouve. Donc
personnalité discrète, révélée de façon fragmentaire, au hasard
des relations sociales, à travers le regard d’autrui. Érudition
et culture - acquises Dieu sait où - ne lui font pas défaut. Une
aisance à déceler l’imposture ou la fabrication de certaines
légendes et malédictions familiales dénote la possession de
solides notions historico-sociales. On l’a même entendu parler
“d’histoire naturelle en faisant montre de connaissances
approfondies et plutôt surprenantes”
(les Naufrages des Pandragon)».27
 et l’expansion du
territoire national ou de l’économie de marché. Dans un sens,
chacun parvenait à la solution sans s’apercevoir qu’il
s’agissait du même crime et des mêmes coupables. Le roman
policier devait aboutir à des réponses similaires : les
victimes sont généralement des gens de la haute – on ne
s’intéresse pas à un voyou tué au fond d’une ruelle -, il y a
soit des affaires d’héritage, de dot, de dettes ou de chantage
derrière les mobiles du crime. De la jalousie aussi. Les héritiers
de Dupin suivirent la voie tracée par Poe. «Lecoq…
fut créé par le romancier français Émile Gaboriau qui en 1873
mourut d’épuisement à l’âge de trente-neuf ans à peine et au
moment où, ayant été expulsé de plusieurs rédactions, il avait
déjà écrit vingt-neuf romans. Dans ses livres :
Le Dossier, Le Crime d’Orcival, Monsieur Lecoq
et Les
Esclaves de Paris,
tous conçus dans les années 1867-1869, Gaboriau tentait de trouver
les mobiles du délit et de définir les circonstances qui
l’accompagnaient. Bien que représentant l’école du raisonnement
logique et de la déduction, Lecoq était en même temps quelque
chose de plus. Il procédait à une inspection minutieuse du lieu du
crime, inspection qui lui fournissait des données servant ensuite à
échafauder des hypothèses formulées selon les principes de la
logique. Dans
Monsieur Lecoq,
le détective, accompagné de plusieurs amis, se rend sur le lieu du
méfait, une taverne située à côté des fortifications de Paris
qui à ce moment-là sont couvertes d’une épaisse couche de neige.
Lecoq arrête ses compagnons, leur interdisant de bouger afin de ne
pas effacer les traces, examine l’endroit, observe chaque détail,
renifle l’air, se couche par terre, aperçoit des pas dans la
neige, les suit pendant un moment, puis termine son enquête par ces
mots : “Maintenant je sais tout. Cette couche de neige est comme
une belle feuille de papier sur laquelle les hommes que nous
cherchons ont inscrit non seulement leurs actes et leur façon
d’agir, mais aussi leurs pensées secrètes, espérances,
angoisses. Ces traces ne vous disent rien. Pour moi, elles sont
vivantes…”».25
Une génération après Dupin, Lecoq avait fait progresser
l’idiosyncrasie du détective. Il ne se contentait plus seulement
de réfléchir dans la pénombre. Il se portait sur les lieux du
crime et avançait vers les criminels. Lorsque le roman policier perd
toute logique et régresse vers les effets du conte gothique, il perd
de sa substance, ce qui en coûta à «l’auteur
de Varney
[attribué
tantôt à James Malcolm Rymer, tantôt à Thomas Pecket Prest,
et l’expansion du
territoire national ou de l’économie de marché. Dans un sens,
chacun parvenait à la solution sans s’apercevoir qu’il
s’agissait du même crime et des mêmes coupables. Le roman
policier devait aboutir à des réponses similaires : les
victimes sont généralement des gens de la haute – on ne
s’intéresse pas à un voyou tué au fond d’une ruelle -, il y a
soit des affaires d’héritage, de dot, de dettes ou de chantage
derrière les mobiles du crime. De la jalousie aussi. Les héritiers
de Dupin suivirent la voie tracée par Poe. «Lecoq…
fut créé par le romancier français Émile Gaboriau qui en 1873
mourut d’épuisement à l’âge de trente-neuf ans à peine et au
moment où, ayant été expulsé de plusieurs rédactions, il avait
déjà écrit vingt-neuf romans. Dans ses livres :
Le Dossier, Le Crime d’Orcival, Monsieur Lecoq
et Les
Esclaves de Paris,
tous conçus dans les années 1867-1869, Gaboriau tentait de trouver
les mobiles du délit et de définir les circonstances qui
l’accompagnaient. Bien que représentant l’école du raisonnement
logique et de la déduction, Lecoq était en même temps quelque
chose de plus. Il procédait à une inspection minutieuse du lieu du
crime, inspection qui lui fournissait des données servant ensuite à
échafauder des hypothèses formulées selon les principes de la
logique. Dans
Monsieur Lecoq,
le détective, accompagné de plusieurs amis, se rend sur le lieu du
méfait, une taverne située à côté des fortifications de Paris
qui à ce moment-là sont couvertes d’une épaisse couche de neige.
Lecoq arrête ses compagnons, leur interdisant de bouger afin de ne
pas effacer les traces, examine l’endroit, observe chaque détail,
renifle l’air, se couche par terre, aperçoit des pas dans la
neige, les suit pendant un moment, puis termine son enquête par ces
mots : “Maintenant je sais tout. Cette couche de neige est comme
une belle feuille de papier sur laquelle les hommes que nous
cherchons ont inscrit non seulement leurs actes et leur façon
d’agir, mais aussi leurs pensées secrètes, espérances,
angoisses. Ces traces ne vous disent rien. Pour moi, elles sont
vivantes…”».25
Une génération après Dupin, Lecoq avait fait progresser
l’idiosyncrasie du détective. Il ne se contentait plus seulement
de réfléchir dans la pénombre. Il se portait sur les lieux du
crime et avançait vers les criminels. Lorsque le roman policier perd
toute logique et régresse vers les effets du conte gothique, il perd
de sa substance, ce qui en coûta à «l’auteur
de Varney
[attribué
tantôt à James Malcolm Rymer, tantôt à Thomas Pecket Prest,  qui]
a besoin,
lui, de 868 pages à doubles colonnes, représentant 220 chapitres.
Le roman connut réédition en 1853, en feuilleton populaire.
Varney ne
se targue d’aucune prétention littéraire : c’est une histoire
crépitante, qui se répète de temps à autre dans ses grandes
lignes. L’action, située dans les années 1730, campe un certain
sir Varney dont les exploits permettent de le désigner comme le
principal précurseur littéraire de Dracula. Les ingrédients que
Bram Stoker reprendra plus tard comprennent : l’initiation sexuelle
et les réactions ambiguës des jeunes filles, les racines
vampiriques en Europe Centrale, les méthodes quasi-scientifiques
pour la destruction du vampire et la chasse à l’ennemi dans un
style “policier privé”. Varney inclut aussi des victimes
somnambules et un traître en manteau noir qui descend le long d’un
mur de château, puis arrive en Angleterre à bord d’un navire -
lequel fait naufrage au milieu d’une tempête».26
Pour un auteur de roman policier qui respectait son genre, l’occulte
n’intervenait que comme une mystification prenant part à la
commission du crime ou comme diversion pour égarer les soupçons.
Ainsi, Father Brown, personnage de G. K. Chesterton : «Jamais
il n’est montré seul, livré à lui-même. Il n’existe qu’à
travers le besoin d’aide que son prochain éprouve. Donc
personnalité discrète, révélée de façon fragmentaire, au hasard
des relations sociales, à travers le regard d’autrui. Érudition
et culture - acquises Dieu sait où - ne lui font pas défaut. Une
aisance à déceler l’imposture ou la fabrication de certaines
légendes et malédictions familiales dénote la possession de
solides notions historico-sociales. On l’a même entendu parler
“d’histoire naturelle en faisant montre de connaissances
approfondies et plutôt surprenantes”
(les Naufrages des Pandragon)».27
qui]
a besoin,
lui, de 868 pages à doubles colonnes, représentant 220 chapitres.
Le roman connut réédition en 1853, en feuilleton populaire.
Varney ne
se targue d’aucune prétention littéraire : c’est une histoire
crépitante, qui se répète de temps à autre dans ses grandes
lignes. L’action, située dans les années 1730, campe un certain
sir Varney dont les exploits permettent de le désigner comme le
principal précurseur littéraire de Dracula. Les ingrédients que
Bram Stoker reprendra plus tard comprennent : l’initiation sexuelle
et les réactions ambiguës des jeunes filles, les racines
vampiriques en Europe Centrale, les méthodes quasi-scientifiques
pour la destruction du vampire et la chasse à l’ennemi dans un
style “policier privé”. Varney inclut aussi des victimes
somnambules et un traître en manteau noir qui descend le long d’un
mur de château, puis arrive en Angleterre à bord d’un navire -
lequel fait naufrage au milieu d’une tempête».26
Pour un auteur de roman policier qui respectait son genre, l’occulte
n’intervenait que comme une mystification prenant part à la
commission du crime ou comme diversion pour égarer les soupçons.
Ainsi, Father Brown, personnage de G. K. Chesterton : «Jamais
il n’est montré seul, livré à lui-même. Il n’existe qu’à
travers le besoin d’aide que son prochain éprouve. Donc
personnalité discrète, révélée de façon fragmentaire, au hasard
des relations sociales, à travers le regard d’autrui. Érudition
et culture - acquises Dieu sait où - ne lui font pas défaut. Une
aisance à déceler l’imposture ou la fabrication de certaines
légendes et malédictions familiales dénote la possession de
solides notions historico-sociales. On l’a même entendu parler
“d’histoire naturelle en faisant montre de connaissances
approfondies et plutôt surprenantes”
(les Naufrages des Pandragon)».27ROMANS DU VULGUM PECUS
 |
| Claude Monet. La gare de Saint-Lazare, Paris, 1877. |
terie, halluci-
nation, dé-
duction, dans tous les cas, on obtient la fasci-
nation autant des lecteurs que des auteurs qui ne produisirent, durant toute leur vie à quelques exceptions près, des romans du genre policier. Ce n’est que dans la mesure où on les associa aux journaux à sensations qu’ils devinrent des divertissements populaires et, par le fait même, chassés du paradis littéraire des Académiciens : «Edmund Wilson dans Mass Culture, [est] l’une des rares personnalités littéraires qui dit simplement que les romans policiers lui paraissant puants, que ceux qui les lisent régulièrement avec enthousiasme ne valent pas mieux et que lui, Wilson, n’a aucune intention de discuter plus longuement leurs qualités».28 Romans puants car c'étaient des romans de gare qui se lisaient le temps d’un trajet. Mais le fond des romans policiers était autrement représentatif des angoisses et des désirs coupables de la bourgeoisie fin-de-siècle. Ils demandaient aux spectacles comme aux littératures d'épater le bourgeois, et les auteurs classiques de romans policiers «ont très bien senti que l’effet de fascination que le fantastique exerce sur l’esprit était l’un des traits originaux du roman policier. Encore est-il qu’ils n’ont pas cherché à le rendre
 plus efficace».29
Car il ne s’agissait pas seulement d’une affaire de fascination.
L’auteur
de roman policier se gardait bien d’oublier que l’objet
fascinant, le fétiche
du roman,
restait un cadavre.
Que ce cadavre était là, dans la pensée de chacun et
particulièrement de manière obsessionnelle autant dans l’esprit
du détective que dans celui de l'assassin. Ils ne pensaient qu’à
lui. Et tout ce qui avait autour n’était, précisément, que de la
fumisterie :
«Le coup
de théâtre est la petite monnaie du roman policier, mais révèle,
précisément, ses profondes affinités avec le monde de la scène.
Et l’on peut se demander, ici, si le roman policier n’est pas,
d’une certaine manière, l’héritier du théâtre élisabéthain,
avec l’humour en plus et donc le drame en moins».30
On l'a dit, le roman policier qui sombre dans l’esthétique
du sang, comme
dans les films gores,
trahi la fonction première de ce type de roman pour lui donner une
autre forme qui ne lui correspond pas. Si les terreurs du XXe siècle
ont fait basculer le roman policier dans l’horreur, la
Weltanschauung
de
l’époque se satisfaisait du fantastique et de l’inquiétant :
«Avec ses
façades faussement rassurantes; sa foule d’honnêtes gens dont
chacun d’eux peut dissimuler un criminel; ses rues grandes ouvertes
à de folles poursuites; ses entrepôts massifs comme des
forteresses; ses palissades fermées sur le mystère ou le néant;
ses toits offerts au jugement de Dieu; ses lumières qui trouent la
nuit menaçante, elle est tout à la fois pour le détective : sa
complice, son adversaire et sa compagne. Elle est le symbole du
fantastique et de l’impossible tapis sous le masque du quotidien».31
Les enquêtes policières trop badigeonnées d’hémoglobine perdent
du mystère qui est présent tout au long des romans policiers. Toute
mystification cache un myste,
voire une
mystique si l’on en croit Kracauer. On reconnaîtra là le repas
cannibalesque. La dévoration du corps du Père (ou de la Mère) par
les Frères. Le roman policier fascinait car il racontait les
origines du meurtre du Père : «Le
vulgaire, qui se fie aux apparences simples, est sujet à l’erreur
et réclame des preuves matérielles mais la véritable connaissance
est vision de l’apparence fondamentale de l’être. Le roman
populaire, malgré sa typologie physique sommaire, ne propose pas
plus efficace».29
Car il ne s’agissait pas seulement d’une affaire de fascination.
L’auteur
de roman policier se gardait bien d’oublier que l’objet
fascinant, le fétiche
du roman,
restait un cadavre.
Que ce cadavre était là, dans la pensée de chacun et
particulièrement de manière obsessionnelle autant dans l’esprit
du détective que dans celui de l'assassin. Ils ne pensaient qu’à
lui. Et tout ce qui avait autour n’était, précisément, que de la
fumisterie :
«Le coup
de théâtre est la petite monnaie du roman policier, mais révèle,
précisément, ses profondes affinités avec le monde de la scène.
Et l’on peut se demander, ici, si le roman policier n’est pas,
d’une certaine manière, l’héritier du théâtre élisabéthain,
avec l’humour en plus et donc le drame en moins».30
On l'a dit, le roman policier qui sombre dans l’esthétique
du sang, comme
dans les films gores,
trahi la fonction première de ce type de roman pour lui donner une
autre forme qui ne lui correspond pas. Si les terreurs du XXe siècle
ont fait basculer le roman policier dans l’horreur, la
Weltanschauung
de
l’époque se satisfaisait du fantastique et de l’inquiétant :
«Avec ses
façades faussement rassurantes; sa foule d’honnêtes gens dont
chacun d’eux peut dissimuler un criminel; ses rues grandes ouvertes
à de folles poursuites; ses entrepôts massifs comme des
forteresses; ses palissades fermées sur le mystère ou le néant;
ses toits offerts au jugement de Dieu; ses lumières qui trouent la
nuit menaçante, elle est tout à la fois pour le détective : sa
complice, son adversaire et sa compagne. Elle est le symbole du
fantastique et de l’impossible tapis sous le masque du quotidien».31
Les enquêtes policières trop badigeonnées d’hémoglobine perdent
du mystère qui est présent tout au long des romans policiers. Toute
mystification cache un myste,
voire une
mystique si l’on en croit Kracauer. On reconnaîtra là le repas
cannibalesque. La dévoration du corps du Père (ou de la Mère) par
les Frères. Le roman policier fascinait car il racontait les
origines du meurtre du Père : «Le
vulgaire, qui se fie aux apparences simples, est sujet à l’erreur
et réclame des preuves matérielles mais la véritable connaissance
est vision de l’apparence fondamentale de l’être. Le roman
populaire, malgré sa typologie physique sommaire, ne propose pas  une
grille simple d’interprétation et de clas-sifica-
une
grille simple d’interprétation et de clas-sifica-tion : il montre au contrai-
re que seul un élan sponta-
né du cœur permet de savoir ce que sont les êtres. […] Le roman populaire privilégie toujours les modes irrationnels de la connaissance (et l’on peut même se demander s’il n’en va pas de même, malgré les apparences, dans le detective novel) : reflet d’une certaine représentation des rapports humains, ou commodité littéraire que s’octroie l’écrivain? Celui-ci peut ainsi jouer d’une fausse complicité avec le lecteur, qui partage tour à tour le point de vue des bons lecteurs d’âme romanesques et celui du vulgum pecus versatile et abusé, croyant aveuglément aux preuves matérielles et aux démonstrations logiques erronées. Cette alternance crée un constant effet de suspense. Devinant la méchanceté profonde de tel ou tel personnage, le lecteur en redoute les manifestations; convaincu de l’innocence de l’héroïne, il n’en attend pas moins avec impatience une éclatante réhabilitation sociale de la fausse coupable».32
 |
| Jacques Tourneur. Out of the past, 1947 |
 du thriller
plus hystérique avec ses agents secrets (lui aussi essentiellement
britannique), qui prit son essor à la même époque et était promis
à un bel avenir dans la seconde moitié du siècle».33
Certes, le Sherlock Holmes de Conan Doyle (1859-1930) y fut pour
beaucoup, ainsi que les crimes de Jack l’Éventreur (1888), mais le
fait, surtout, que Doyle avait fondé une tradition qui fut vite
relayée par Agatha Christie (1890-1976) : «Comme
tous les grands romanciers, ce qui la caractérise est la capacité
de créer une atmosphère à nulle autre pareille, néo-réalité qui
façonne comme un prisme la perception que l’on peut avoir d’un
hôtel londonien à l’heure du thé ou d’un petit village
anglais. Mais le propre un peu étrange de cette atmosphère est d’y
inclure des meurtres comme si leur production, cependant incongrue, y
était une chose parfaitement familière. Nul paradoxe en cela car la
familiarité en question nous la partageons bien comme l’infantile
qui est en nous et qu’elle nous raconte inlassablement».34
Comme Dupin, comme Holmes, chez Christie, «la
police est bien peu présente dans ces romans où les détectives
sont amateurs ou à la retraite».35
Miss
Marple et Hercule Poirot, en effet, montrent que des enquêteurs
dotés de fascinantes petites
cellules grises valent
les officiers plus prompts à la matraque qu’à l’analyse
logique. Nous n'y trouvons pas de poursuites, ni de mitrailles, ni
même de tueurs trop sadiques pour nuire au confort que donne la
solution finale du récit. Nous ne devons jamais perdre l’aspect
ludique du roman policier. Si grave que puisse paraître aux yeux du
psychanalyste le meurtre du Père, dans les romans policiers, il
n’est rien de plus qu’un (autre) cadavre : «Le
crime a eu lieu et il éclaire désormais le paysage mental où il
s’est produit, en
du thriller
plus hystérique avec ses agents secrets (lui aussi essentiellement
britannique), qui prit son essor à la même époque et était promis
à un bel avenir dans la seconde moitié du siècle».33
Certes, le Sherlock Holmes de Conan Doyle (1859-1930) y fut pour
beaucoup, ainsi que les crimes de Jack l’Éventreur (1888), mais le
fait, surtout, que Doyle avait fondé une tradition qui fut vite
relayée par Agatha Christie (1890-1976) : «Comme
tous les grands romanciers, ce qui la caractérise est la capacité
de créer une atmosphère à nulle autre pareille, néo-réalité qui
façonne comme un prisme la perception que l’on peut avoir d’un
hôtel londonien à l’heure du thé ou d’un petit village
anglais. Mais le propre un peu étrange de cette atmosphère est d’y
inclure des meurtres comme si leur production, cependant incongrue, y
était une chose parfaitement familière. Nul paradoxe en cela car la
familiarité en question nous la partageons bien comme l’infantile
qui est en nous et qu’elle nous raconte inlassablement».34
Comme Dupin, comme Holmes, chez Christie, «la
police est bien peu présente dans ces romans où les détectives
sont amateurs ou à la retraite».35
Miss
Marple et Hercule Poirot, en effet, montrent que des enquêteurs
dotés de fascinantes petites
cellules grises valent
les officiers plus prompts à la matraque qu’à l’analyse
logique. Nous n'y trouvons pas de poursuites, ni de mitrailles, ni
même de tueurs trop sadiques pour nuire au confort que donne la
solution finale du récit. Nous ne devons jamais perdre l’aspect
ludique du roman policier. Si grave que puisse paraître aux yeux du
psychanalyste le meurtre du Père, dans les romans policiers, il
n’est rien de plus qu’un (autre) cadavre : «Le
crime a eu lieu et il éclaire désormais le paysage mental où il
s’est produit, en  nous donnant des éléments précieux pour
désigner, comme un détective lors de son enquête, les victimes,
l’assassin et ses complices, les mobiles et les armes du délit. Ce
“paradigme indiciaire” a été appliqué ici à l’analyse des
“traces” - d’une visibilité aveuglante - laissées par le
nazisme».36
Et pourquoi n’en serait-il pas ainsi? Un cadavre ou six millions,
on passe de l'assassinat à la statistique, si on veut pasticher
Staline : «On
sait que, tandis que les Français ou les Américains réussirent à
créer un modèle national de l’archétype de Conan Doyle, les
Allemands ont toujours conçu l’image d’un grand détective avec
toutes les caractéristiques d’un Anglais. Cela peut être expliqué
par la dépendance du détective classique de la démocratie
libérale. Lui, le fin limier solitaire qui oblige la raison à
détruire les toiles d’araignée des puissances irrationnelles et
qui fait triompher la décence sur les bas instincts, était le héros
prédestiné d’un monde civilisé qui croit en la bénédiction des
lumières et en la liberté individuelle. Ce n’est pas un hasard si
ce détective souverain disparaît dans les films d’aujourd’hui
au profit du “détective privé” : il semble que, temporairement,
les potentialités du libéralisme soient épuisées. Dans la mesure
où les Allemands n’ont jamais développé de régime démocratique,
ils n’étaient pas en mesure d’engendrer une version nationale de
Sherlock Holmes. Néanmoins, par leur sensibilité profonde envers
autrui, ils ont pu apprécier le joli mythe du détective anglais».37
nous donnant des éléments précieux pour
désigner, comme un détective lors de son enquête, les victimes,
l’assassin et ses complices, les mobiles et les armes du délit. Ce
“paradigme indiciaire” a été appliqué ici à l’analyse des
“traces” - d’une visibilité aveuglante - laissées par le
nazisme».36
Et pourquoi n’en serait-il pas ainsi? Un cadavre ou six millions,
on passe de l'assassinat à la statistique, si on veut pasticher
Staline : «On
sait que, tandis que les Français ou les Américains réussirent à
créer un modèle national de l’archétype de Conan Doyle, les
Allemands ont toujours conçu l’image d’un grand détective avec
toutes les caractéristiques d’un Anglais. Cela peut être expliqué
par la dépendance du détective classique de la démocratie
libérale. Lui, le fin limier solitaire qui oblige la raison à
détruire les toiles d’araignée des puissances irrationnelles et
qui fait triompher la décence sur les bas instincts, était le héros
prédestiné d’un monde civilisé qui croit en la bénédiction des
lumières et en la liberté individuelle. Ce n’est pas un hasard si
ce détective souverain disparaît dans les films d’aujourd’hui
au profit du “détective privé” : il semble que, temporairement,
les potentialités du libéralisme soient épuisées. Dans la mesure
où les Allemands n’ont jamais développé de régime démocratique,
ils n’étaient pas en mesure d’engendrer une version nationale de
Sherlock Holmes. Néanmoins, par leur sensibilité profonde envers
autrui, ils ont pu apprécier le joli mythe du détective anglais».37
Surtout
que durant l’entre-deux-guerres, le roman policier s’était
rapidement déplacé vers les écrans de cinéma. Avant la Grande
Guerre, avant que les Talkies
viennent
ajouter les déductions logiques des détectives, le film policier
était commandé par la technique cinématographique et non par la
thématique policière : «Une
autre forme populaire aide à découvrir les possibilités
d’expression que le cinéma détient dans son essence même : le
mouvement. C’est, avec
Les Aventures de Nick Carter
(1909)
Zigomar
(1911) et
Fantômas
(1913), la naissance du film policier qui, sur le plan dramatique,
multiplie aussi les poursuites, les péripéties rapides, imagine peu
à peu une action dynamique près de laquelle les tableaux
historiques du “Film d’Art” font bientôt figure d’archaïsme».38
Ces films marquèrent l’imagination des jeunes Français du début
du siècle. Une nouvelle génération de cinéastes apparue toutefois
assez vite pour développer le thème afin d’en faire des films
plus profonds. Est-ce pour des raisons politiques que les films
français du genre policier finirent par porter, avant tout, sur une
critique sociale ignorée par le roman britannique? Louis Aragon,
dans Le
Trésor des Jésuites, affirmait
que «c’est
dans Les
Mystères de New York
(Louis Gasnier), c’est dans
Les Vampires
qu’il faudra chercher la réalité de ce siècle, au-delà de la
mode, au-delà des goûts…».39
Tradition qui s’imposa avec les films de Marcel Carné et de Jean
Renoir et où Jacques Prévert se montrait merveilleux scénariste :
«l’ascendant
du “fantastique social” de Feuillade sur l’univers
ciné-matographique des Prévert n’en reste pas moins très net.
Pourquoi, par exemple, ne pas voir dans les banlieues poussiéreuses
et tristes, grises et poétiques, nullement réalistes mais au
contraire romantiques et chimériques, oui, pourquoi, dans ces
banlieues qui encombrent la plupart des films prévertiens, ne pas
voir des réminiscences des banlieues dans lesquelles les Vampires
cherchent les traces de Fantômas…? Pourquoi aussi ce besoin qu’a
toujours eu Jacques Prévert d’inscrire dans un décor, dans un
quai, un réverbère, une façade de maison, les sentiments des
personnages, de rendre lisible ce qu’ils pensent et ressentent par
l’aspect extérieur des objets, des choses inanimées, en un mot
des décors, oui pourquoi ce besoin n’aurait-il pas pris naissance
dans la contemplation du “réalisme fantastique” de Feuillade, ce
“réalisme” que Francis Lacassin a justement situé entre le
“réalisme sans chaleur” de Lumière et le “fantastique sans
postérité” de Méliès?».40
Dans une tout autre veine, les surréalistes non plus ne crachèrent
pas sur le genre policier. «The
Paris Surrealists of the twenties, in their manifestos, pamphlets,
and explications, discussed murders, the love life of Charlie
Chaplin, the Marquis de Sade, and Nosferatu (the German Dracula),
Jack the Ripper and a sex murderer named Haarman were in vogue (sex
murders were favored picture subjects for Otto Dix and George Grosz,
for instance). Magritte, in his early years, wrote detective stories
(no longer extant), and he liked reading Poe and Stevenson, Nick
Carter and Nat Pinkerton, Rex Stout, and Dashiell Hammett. He went to
the movies mainly to see films by Chaplin or Fritz Lang. He liked a
series of novels written between 1912 and 1914 by Pierre Souvestre
and Marcel Allain called
Fantômas,
and a film serial of the same name by Louis Feuillades (1913). In
1928 Magritte published a description of the pursuit of Fantômas by
an inspector of the Sûreté and, that same year, he painted
The Savage,
which contained published a grotesque, laconic description of a day
in the life of Nat Pinkerton».41
Si les films de Buñuel et de Dalí portaient sur des violences
aberrantes, le tableau de Magritte, L’Assassin
menacé, est
de 1926 : «Suzi
Gablik, in her monograph on Magritte, points out the kinship that
exists between Fantômas and the central figure in Lautréamont’s
Les
Chants de Maldoror -
a figure much revered by the Surrealists. Both are personifications
of the diabolic, of evil. Fantômas is a lowbrow version of Maldoror.
Both are valued by the Surrealists for their eccentricity, which
flies in the face of the middle-class system. Suzi Gablik assumes
that The
Menaced Assassin is
based on an episode from Fantômas».42
Tout en s’imprégnant d’une atmosphère lourde d’angoisse et
d’inquiétudes, le roman policier demeurait fidèle à sa
structure : fascination, crime originel, âme coincée entre
hallucinations et déductions.
 |
| Louis Feuillade, Fantômas, 1913 |
 |
| Marcel Carné. Quai des brumes, 1938. |
 |
| René Magritte. L'assassin menacé, 1927. |
L'OMBRE DES ORIGINES
Bien des facteurs contribuèrent à développer le goût pour le roman policier et le darwinisme n’en fut sûrement pas le moins important. Si l’enquête apparaissait pratiquement toujours la même (Whodunits?), c’est que le cadavre sublimé restait un ersatz de la figure du Père assassinée. Le détective devait donc procéder par une enquête à rebours comme le supposait d’Alembert pour l’histoire, méthode appliquée entre autres par Hume puis par Marx : partir des indices actuelles pour remonter jusqu’à l’origine où fut conçu le crime. La paléontologie et la paléanthropologie étant dans leur enfance,43
 |
| Robert Wiene. Les mains d'Orlac, 1924. |
 darwinisme à la science, la science au matérialisme, et ce dernier
à l’immoralité, ils composèrent une vaste galerie d’étonnants
criminels libérés des contraintes de la morale chrétienne. Ces
gens, qui subissaient tout autant les conséquences de leurs actes
que leurs propres victimes, tenaient la religion pour un tissu de
sottises, prêchaient la suprématie de
la lutte pour l’existence
et prétendaient n’avoir pour maître que leur seul bon vouloir.
Désespérés, il leur arrivait de se suicider ou, pire, d’assassiner
leur épouse afin de rencontrer de nouvelles partenaires sexuelles
plus attirantes».44
Ce goût pour la méthode empirique (l’enquête et l’observation)
et les connaissances nouvelles propres à la seconde Révolution
industrielle exigeaient, comme nous l’avons vu, une certaine
déontologie
des auteurs. Au départ, on peut avancer, comme le fait Narcejac, que
le roman policier «ne
fut jamais ni vraiment scientifique, ni vraiment romanesque. Il fut,
il est, autre chose, que ni Edgar Poe ni ses épigones n’avaient
prévu et que j’appelle une “machine à lire”».45
L’idée est assez juste, d’autant plus que depuis un siècle, le
mélodrame et le vaudeville tenaient également à un même esprit
machinique. Mais, «dès
la fin du XIXe siècle, il paraissait évident et, jusqu’en 1940,
il fut admis comme démontré, que le roman policier était bien,
dans son essence, un récit scientifique par sa fin et ses procédés.
Cette conviction était partagée à ce point par tous que toutes les
définitions du roman policier qui ont été proposées mettent en
relief ce trait, jugé fondamental».46
De fait, «s’il
rompait avec le roman traditionnel, c’était pour enrichir la
littérature au contact de la science, en maîtrisant l’inspiration,
en la domestiquant, en la faisant travailler à la demande,
exactement comme on commençait à faire travailler l’électricité».47
Cette approbation inconditionnelle de la science pouvait toutefois
amener les auteurs à s’abandonner à ce qui n’était,
précisément pas, de la science.
darwinisme à la science, la science au matérialisme, et ce dernier
à l’immoralité, ils composèrent une vaste galerie d’étonnants
criminels libérés des contraintes de la morale chrétienne. Ces
gens, qui subissaient tout autant les conséquences de leurs actes
que leurs propres victimes, tenaient la religion pour un tissu de
sottises, prêchaient la suprématie de
la lutte pour l’existence
et prétendaient n’avoir pour maître que leur seul bon vouloir.
Désespérés, il leur arrivait de se suicider ou, pire, d’assassiner
leur épouse afin de rencontrer de nouvelles partenaires sexuelles
plus attirantes».44
Ce goût pour la méthode empirique (l’enquête et l’observation)
et les connaissances nouvelles propres à la seconde Révolution
industrielle exigeaient, comme nous l’avons vu, une certaine
déontologie
des auteurs. Au départ, on peut avancer, comme le fait Narcejac, que
le roman policier «ne
fut jamais ni vraiment scientifique, ni vraiment romanesque. Il fut,
il est, autre chose, que ni Edgar Poe ni ses épigones n’avaient
prévu et que j’appelle une “machine à lire”».45
L’idée est assez juste, d’autant plus que depuis un siècle, le
mélodrame et le vaudeville tenaient également à un même esprit
machinique. Mais, «dès
la fin du XIXe siècle, il paraissait évident et, jusqu’en 1940,
il fut admis comme démontré, que le roman policier était bien,
dans son essence, un récit scientifique par sa fin et ses procédés.
Cette conviction était partagée à ce point par tous que toutes les
définitions du roman policier qui ont été proposées mettent en
relief ce trait, jugé fondamental».46
De fait, «s’il
rompait avec le roman traditionnel, c’était pour enrichir la
littérature au contact de la science, en maîtrisant l’inspiration,
en la domestiquant, en la faisant travailler à la demande,
exactement comme on commençait à faire travailler l’électricité».47
Cette approbation inconditionnelle de la science pouvait toutefois
amener les auteurs à s’abandonner à ce qui n’était,
précisément pas, de la science.
Bien
sûr, il s’agissait de l’occultisme, dont on a vu que
l’importance prise par la ratio
chassait
du roman policier autrement qu’afin de servir d’artifice et
diversion. Le roman policier resta donc en marge de la nouvelle
littérature gothique associée au courant symboliste, qui marqua les
esprits à la fin du XIXe siècle : histoires de fantômes, de
vampires, de loups-garous : «D’autres
exemples de  pseudo-science victorienne apparaissent lorsque Van Helsing développe sa “philosophie du crime” (D. : XXV). Les
criminels, affirme-t-il, se ressemblent tous. Ils sont nécessairement
déséquilibrés, puérils et incapables de briser leurs habitudes :
“[…]
dans tous
les pays, à toutes les époques, le criminel répète sans cesse un
crime unique.” Pour Mina, “le comte est un criminel de type
classique” (D. : XXV). Et Stoker de s’appuyer sur les théories
de docteurs ou de criminologues contemporains pour développer son
argument.
Degeneration
(1893), l’ouvrage controversé de Max Nordau, cherche à établir
la corrélation entre génie et dégénérescence morale. De son
côté, Cesare Lombroso, père de la criminologie moderne, ne doutait
pas des rapports unissant physiognomonie et crime. Selon lui, les
“criminels nés” sont physiologiquement liés à leurs ancêtres
primordiaux. Dans
L’homme criminel,
il affirme que les prédispositions à enfreindre la loi sont
provoquées par la sensualité, la paresse, l’impulsivité du
caractère et la vanité. Quand il décrit les caractéristiques
visibles du criminel, le parallélisme avec Dracula ne fait aucun
doute…».48
Les criminels des romans policiers n'appartenaient pas à cette
catégorie privilégiée par la rhétorique pseudo-darwinienne. Il
existait, certes, ici et là, mais les Jacques Lantier se faisaient
plutôt rares. Tout au plus la dégénérescence ajoutait d’avantage
à la problématique de fond plutôt qu’elle servait elle-même de
problématique. Elle découlait du crime originel mais n’en était
pas la cause. «Tout
ce que l’on peut affirmer, c’est que le roman policier sera
scientifique quant à la forme, mais ne le sera pas quant au
contenu»,49
rappelle Narcejac. Et comme la forme détermine les conditions du
contenu et que cette forme se voyait définie par la Weltanschauung
bourgeoise,
le roman policier machine
à lire devint
une machine (bien) huilée : «Plus
le monde se rationalise, plus il ressemble à la construction par
laquelle le détective s’opposait à son chaos, et plus il doit
s’éloigner du légal pour maintenir l’autonomie de son processus
de connaissance. Il découvre alors la légitimité relative de
l’illégal en face d’une légalité figée et dépourvue de
“fondement” extrajuridique, et la signification de sa propre
autonomie : d’être une forme dégradée du médiateur supralégal
de figures telles que le Christ ou le prince
pseudo-science victorienne apparaissent lorsque Van Helsing développe sa “philosophie du crime” (D. : XXV). Les
criminels, affirme-t-il, se ressemblent tous. Ils sont nécessairement
déséquilibrés, puérils et incapables de briser leurs habitudes :
“[…]
dans tous
les pays, à toutes les époques, le criminel répète sans cesse un
crime unique.” Pour Mina, “le comte est un criminel de type
classique” (D. : XXV). Et Stoker de s’appuyer sur les théories
de docteurs ou de criminologues contemporains pour développer son
argument.
Degeneration
(1893), l’ouvrage controversé de Max Nordau, cherche à établir
la corrélation entre génie et dégénérescence morale. De son
côté, Cesare Lombroso, père de la criminologie moderne, ne doutait
pas des rapports unissant physiognomonie et crime. Selon lui, les
“criminels nés” sont physiologiquement liés à leurs ancêtres
primordiaux. Dans
L’homme criminel,
il affirme que les prédispositions à enfreindre la loi sont
provoquées par la sensualité, la paresse, l’impulsivité du
caractère et la vanité. Quand il décrit les caractéristiques
visibles du criminel, le parallélisme avec Dracula ne fait aucun
doute…».48
Les criminels des romans policiers n'appartenaient pas à cette
catégorie privilégiée par la rhétorique pseudo-darwinienne. Il
existait, certes, ici et là, mais les Jacques Lantier se faisaient
plutôt rares. Tout au plus la dégénérescence ajoutait d’avantage
à la problématique de fond plutôt qu’elle servait elle-même de
problématique. Elle découlait du crime originel mais n’en était
pas la cause. «Tout
ce que l’on peut affirmer, c’est que le roman policier sera
scientifique quant à la forme, mais ne le sera pas quant au
contenu»,49
rappelle Narcejac. Et comme la forme détermine les conditions du
contenu et que cette forme se voyait définie par la Weltanschauung
bourgeoise,
le roman policier machine
à lire devint
une machine (bien) huilée : «Plus
le monde se rationalise, plus il ressemble à la construction par
laquelle le détective s’opposait à son chaos, et plus il doit
s’éloigner du légal pour maintenir l’autonomie de son processus
de connaissance. Il découvre alors la légitimité relative de
l’illégal en face d’une légalité figée et dépourvue de
“fondement” extrajuridique, et la signification de sa propre
autonomie : d’être une forme dégradée du médiateur supralégal
de figures telles que le Christ ou le prince  Muich-
Muich-
kine».50 À la forme hyper-rationnel du roman policier on versa un contenu essen-
tielle-
ment moral. Le chaos vaincu et le cosmos restauré par le détective terminaient le roman sur une note apaisante. On découvrait le criminel auteur du forfait et rarement appartenait-il à une classe autre que l’ancienne noblesse ou la grande bourgeoisie. «Le détective du roman policier n’aime que les “beaux crimes”. Sa réputation est au-dessus du fait divers banal, du règlement de comptes vulgaire».51 Les enquêtes ne se déroulent pas dans les ruelles sombres de Whitechapell ou de la rue Morgue, mais dans les vieilles résidences patriarcales, les châteaux, les résidences cossues conforment à l'art déco. Comme le remarque M. Chastaing : «Son enquête a pour objectif : là, le retour à l’ordre mental par la vérité; ici, le retour à l’ordre social par la justice»;52 D’abord, dissoudre l’hallucination, ensuite restaurer la primauté de la déduction. Et le critique de développer son observation : «Incapables de prouver légalement la culpabilité d’un criminel - que leur intelligence accuse -, se placent au-dessus de la loi et se font eux-mêmes justiciers. Ils font aussi régner leur justice, lorsqu’ils justifient un malfaiteur que la justice de leur pays condamnerait et lui permettent par suite d’échapper à celle-là. Ils apparaissent ainsi comme des “héros moraux” et moralistes, capables de se battre, au nom de la “morale ouverte”, contre la “morale close”, ou, au nom du Good, contre le Right».53
 pseudo-science victorienne apparaissent lorsque Van Helsing développe sa “philosophie du crime” (D. : XXV). Les
criminels, affirme-t-il, se ressemblent tous. Ils sont nécessairement
déséquilibrés, puérils et incapables de briser leurs habitudes :
“[…]
dans tous
les pays, à toutes les époques, le criminel répète sans cesse un
crime unique.” Pour Mina, “le comte est un criminel de type
classique” (D. : XXV). Et Stoker de s’appuyer sur les théories
de docteurs ou de criminologues contemporains pour développer son
argument.
Degeneration
(1893), l’ouvrage controversé de Max Nordau, cherche à établir
la corrélation entre génie et dégénérescence morale. De son
côté, Cesare Lombroso, père de la criminologie moderne, ne doutait
pas des rapports unissant physiognomonie et crime. Selon lui, les
“criminels nés” sont physiologiquement liés à leurs ancêtres
primordiaux. Dans
L’homme criminel,
il affirme que les prédispositions à enfreindre la loi sont
provoquées par la sensualité, la paresse, l’impulsivité du
caractère et la vanité. Quand il décrit les caractéristiques
visibles du criminel, le parallélisme avec Dracula ne fait aucun
doute…».48
Les criminels des romans policiers n'appartenaient pas à cette
catégorie privilégiée par la rhétorique pseudo-darwinienne. Il
existait, certes, ici et là, mais les Jacques Lantier se faisaient
plutôt rares. Tout au plus la dégénérescence ajoutait d’avantage
à la problématique de fond plutôt qu’elle servait elle-même de
problématique. Elle découlait du crime originel mais n’en était
pas la cause. «Tout
ce que l’on peut affirmer, c’est que le roman policier sera
scientifique quant à la forme, mais ne le sera pas quant au
contenu»,49
rappelle Narcejac. Et comme la forme détermine les conditions du
contenu et que cette forme se voyait définie par la Weltanschauung
bourgeoise,
le roman policier machine
à lire devint
une machine (bien) huilée : «Plus
le monde se rationalise, plus il ressemble à la construction par
laquelle le détective s’opposait à son chaos, et plus il doit
s’éloigner du légal pour maintenir l’autonomie de son processus
de connaissance. Il découvre alors la légitimité relative de
l’illégal en face d’une légalité figée et dépourvue de
“fondement” extrajuridique, et la signification de sa propre
autonomie : d’être une forme dégradée du médiateur supralégal
de figures telles que le Christ ou le prince
pseudo-science victorienne apparaissent lorsque Van Helsing développe sa “philosophie du crime” (D. : XXV). Les
criminels, affirme-t-il, se ressemblent tous. Ils sont nécessairement
déséquilibrés, puérils et incapables de briser leurs habitudes :
“[…]
dans tous
les pays, à toutes les époques, le criminel répète sans cesse un
crime unique.” Pour Mina, “le comte est un criminel de type
classique” (D. : XXV). Et Stoker de s’appuyer sur les théories
de docteurs ou de criminologues contemporains pour développer son
argument.
Degeneration
(1893), l’ouvrage controversé de Max Nordau, cherche à établir
la corrélation entre génie et dégénérescence morale. De son
côté, Cesare Lombroso, père de la criminologie moderne, ne doutait
pas des rapports unissant physiognomonie et crime. Selon lui, les
“criminels nés” sont physiologiquement liés à leurs ancêtres
primordiaux. Dans
L’homme criminel,
il affirme que les prédispositions à enfreindre la loi sont
provoquées par la sensualité, la paresse, l’impulsivité du
caractère et la vanité. Quand il décrit les caractéristiques
visibles du criminel, le parallélisme avec Dracula ne fait aucun
doute…».48
Les criminels des romans policiers n'appartenaient pas à cette
catégorie privilégiée par la rhétorique pseudo-darwinienne. Il
existait, certes, ici et là, mais les Jacques Lantier se faisaient
plutôt rares. Tout au plus la dégénérescence ajoutait d’avantage
à la problématique de fond plutôt qu’elle servait elle-même de
problématique. Elle découlait du crime originel mais n’en était
pas la cause. «Tout
ce que l’on peut affirmer, c’est que le roman policier sera
scientifique quant à la forme, mais ne le sera pas quant au
contenu»,49
rappelle Narcejac. Et comme la forme détermine les conditions du
contenu et que cette forme se voyait définie par la Weltanschauung
bourgeoise,
le roman policier machine
à lire devint
une machine (bien) huilée : «Plus
le monde se rationalise, plus il ressemble à la construction par
laquelle le détective s’opposait à son chaos, et plus il doit
s’éloigner du légal pour maintenir l’autonomie de son processus
de connaissance. Il découvre alors la légitimité relative de
l’illégal en face d’une légalité figée et dépourvue de
“fondement” extrajuridique, et la signification de sa propre
autonomie : d’être une forme dégradée du médiateur supralégal
de figures telles que le Christ ou le prince  Muich-
Muich-kine».50 À la forme hyper-rationnel du roman policier on versa un contenu essen-
tielle-
ment moral. Le chaos vaincu et le cosmos restauré par le détective terminaient le roman sur une note apaisante. On découvrait le criminel auteur du forfait et rarement appartenait-il à une classe autre que l’ancienne noblesse ou la grande bourgeoisie. «Le détective du roman policier n’aime que les “beaux crimes”. Sa réputation est au-dessus du fait divers banal, du règlement de comptes vulgaire».51 Les enquêtes ne se déroulent pas dans les ruelles sombres de Whitechapell ou de la rue Morgue, mais dans les vieilles résidences patriarcales, les châteaux, les résidences cossues conforment à l'art déco. Comme le remarque M. Chastaing : «Son enquête a pour objectif : là, le retour à l’ordre mental par la vérité; ici, le retour à l’ordre social par la justice»;52 D’abord, dissoudre l’hallucination, ensuite restaurer la primauté de la déduction. Et le critique de développer son observation : «Incapables de prouver légalement la culpabilité d’un criminel - que leur intelligence accuse -, se placent au-dessus de la loi et se font eux-mêmes justiciers. Ils font aussi régner leur justice, lorsqu’ils justifient un malfaiteur que la justice de leur pays condamnerait et lui permettent par suite d’échapper à celle-là. Ils apparaissent ainsi comme des “héros moraux” et moralistes, capables de se battre, au nom de la “morale ouverte”, contre la “morale close”, ou, au nom du Good, contre le Right».53
La
raison et la morale étant les deux moteurs du roman policier, ce qui
accentua son aspect mécanique, le rendit propre à un divertissement
s'apparentant aux jeux de sociétés (Clue).
En fait, tout ce qui relevait de l’ordre des affects y était
exclu. Comme l’inconscient en psychanalyse et la cause moniste en
historiographie, on ne s’embarrassait pas de ce que Descartes
appelait le
Malin  Génie; les
affects. Et en particulier l’amour. Malgré les adaptations
romancées au cinéma, les romans policiers étaient aux antipodes
des romans d’amour : «Leur
idéal a été de chasser du roman-problème toute affectivité. Au
fond de leur esthétique, il y a un dualisme qui sépare radicalement
le sensible et l’intellectuel, le physique et le cérébral. Et
toute la signification du roman policier classique est là. Nos
auteurs, d’ailleurs, ont eu pleinement conscience de ce qu’ils
faisaient. Ils ont compris que le roman-problème était une sorte de
purification, et avait une valeur éthique. Ont-ils raison, ou bien
la nature secrète du roman policier leur échappe-t-elle encore, au
moment où ils croient la saisir?».54
L’interdit avait même été codifié dans la règle # 3 de Van Dine, établie en 1928 : «Le
véritable roman policier doit être exempt de toute intrigue
amoureuse. Y introduire de l’amour serait, en effet, déranger le
mécanisme du problème purement intellectuel».55
En conséquence, les personnages, criminels comme détectives,
perdirent beaucoup de la profondeur des caractères habituels des
romans traditionnels. «Ces
personnages sont sans
profondeur, puisqu’ils
ne tirent leur réalité, leur être, que du plan qu’ils sont en
train de concevoir ou de déjouer, mais parce qu’ils sont
semblables à des causes produisant des effets à long terme, la
distance, en quelque sorte, qui sépare l’effet de la cause leur
confère une
épaisseur,
une densité qu’on peut aisément prendre pour de la profondeur.
Tout se passe dans un monde à deux dimensions, car l’épaisseur et
la densité ne sont que des trompe-l’œil, et naissent d’une
certaine façon d’appuyer le trait. La troisième dimension du
roman, c’est la dimension de la souffrance, du doute, ou de
l’espoir, celle de l’affectivité, si l’on veut, et elle manque
toujours plus ou moins au roman policier, dont les protagonistes ne
sont que des silhouettes, des profils, des ombres chinoises. C’est
pourquoi l’amour, qui est l’amorce de la troisième dimension, ne
réussit jamais à se développer, dans les romans de Freeman. Il
n’apparaît que dans sa convention la plus mièvre. Il est plaqué
sur le récit, comme un ornement. Il est un trompe-cœur. On tremble
à la pensée qu’un des personnages des
Hauts de Hurlevent
pourrait faire
Génie; les
affects. Et en particulier l’amour. Malgré les adaptations
romancées au cinéma, les romans policiers étaient aux antipodes
des romans d’amour : «Leur
idéal a été de chasser du roman-problème toute affectivité. Au
fond de leur esthétique, il y a un dualisme qui sépare radicalement
le sensible et l’intellectuel, le physique et le cérébral. Et
toute la signification du roman policier classique est là. Nos
auteurs, d’ailleurs, ont eu pleinement conscience de ce qu’ils
faisaient. Ils ont compris que le roman-problème était une sorte de
purification, et avait une valeur éthique. Ont-ils raison, ou bien
la nature secrète du roman policier leur échappe-t-elle encore, au
moment où ils croient la saisir?».54
L’interdit avait même été codifié dans la règle # 3 de Van Dine, établie en 1928 : «Le
véritable roman policier doit être exempt de toute intrigue
amoureuse. Y introduire de l’amour serait, en effet, déranger le
mécanisme du problème purement intellectuel».55
En conséquence, les personnages, criminels comme détectives,
perdirent beaucoup de la profondeur des caractères habituels des
romans traditionnels. «Ces
personnages sont sans
profondeur, puisqu’ils
ne tirent leur réalité, leur être, que du plan qu’ils sont en
train de concevoir ou de déjouer, mais parce qu’ils sont
semblables à des causes produisant des effets à long terme, la
distance, en quelque sorte, qui sépare l’effet de la cause leur
confère une
épaisseur,
une densité qu’on peut aisément prendre pour de la profondeur.
Tout se passe dans un monde à deux dimensions, car l’épaisseur et
la densité ne sont que des trompe-l’œil, et naissent d’une
certaine façon d’appuyer le trait. La troisième dimension du
roman, c’est la dimension de la souffrance, du doute, ou de
l’espoir, celle de l’affectivité, si l’on veut, et elle manque
toujours plus ou moins au roman policier, dont les protagonistes ne
sont que des silhouettes, des profils, des ombres chinoises. C’est
pourquoi l’amour, qui est l’amorce de la troisième dimension, ne
réussit jamais à se développer, dans les romans de Freeman. Il
n’apparaît que dans sa convention la plus mièvre. Il est plaqué
sur le récit, comme un ornement. Il est un trompe-cœur. On tremble
à la pensée qu’un des personnages des
Hauts de Hurlevent
pourrait faire  irruption dans un roman policier! Quel saccage! C’est
que l’amour est désordre et ne se laisse pas enfermer dans un
“planning”. En revanche, assassin et détective ne manquent pas
d’intensité,
puisqu’ils sont violemment projetés vers l’avenir qui décidera
de leur succès ou de leur échec».56
Pour n'en donner qu'un exemple de la façon dont le roman policier
traitait l'amour, pensons à un roman tardif d'Agatha Christie, The endless night (1967),
où
le narrateur, Michael Rogers, un jeune homme dans la vingtaine, beau
et séduisant mais ambitieux et inconstant, rencontre la fille d'un
riche millionnaire américain, Ellie. Celle-ci achète un terrain en
pleine forêt convoité par le jeune homme. C'est l'histoire d'amour
classique. On croirait s'engager dans un roman d'amour-tragique tant
le destin de la jeune femme est prévisible. Mais c'est pour
apprendre, à la fin, que c'est Michael l'assassin et qu'il a tué
ainsi deux autres femmes et un jeune homme dont il convoitait la
montre bracelet. Michael
irruption dans un roman policier! Quel saccage! C’est
que l’amour est désordre et ne se laisse pas enfermer dans un
“planning”. En revanche, assassin et détective ne manquent pas
d’intensité,
puisqu’ils sont violemment projetés vers l’avenir qui décidera
de leur succès ou de leur échec».56
Pour n'en donner qu'un exemple de la façon dont le roman policier
traitait l'amour, pensons à un roman tardif d'Agatha Christie, The endless night (1967),
où
le narrateur, Michael Rogers, un jeune homme dans la vingtaine, beau
et séduisant mais ambitieux et inconstant, rencontre la fille d'un
riche millionnaire américain, Ellie. Celle-ci achète un terrain en
pleine forêt convoité par le jeune homme. C'est l'histoire d'amour
classique. On croirait s'engager dans un roman d'amour-tragique tant
le destin de la jeune femme est prévisible. Mais c'est pour
apprendre, à la fin, que c'est Michael l'assassin et qu'il a tué
ainsi deux autres femmes et un jeune homme dont il convoitait la
montre bracelet. Michael  est frustré de l'amour maternel et chaque
femme qu'il tue et contri-
est frustré de l'amour maternel et chaque
femme qu'il tue et contri-
bue à accen-
tuer son mal-
heur est une sorte de cri d'amour adressé à sa mère. Lors-
qu'il enserre la gorge de Miss Marple, celle-ci n'a qu'à lui lancer que s'il l'étrangle, c'est comme s'il étranglait sa mère, le meurtrier la libère. Sa narration est sa confession : En ma fin est mon commencement. C'est ainsi que les auteurs de romans policiers concevaient l'amour. Par contre, les liens interpersonnels étaient souvent empreints d’homosexualité. Les couples du genre Holmes/Watson ou Poirot/Hastings, dualité qui remontait à Dupin et à son narrateur, sublimaient le lien qui liait un éraste (le détective) à son éromène (le naïf toujours ébahi devant la démonstration du maître). Les femmes dans le roman policier, à l’origine, ne sont bonnes que pour être victimes ou meurtrières. Les détectives ne cessaient, jalousement, de mettre leur associé en garde contre l’insertion de la femme dans leur intimité : «Ignorant encore les projets matrimoniaux de [Watson], Holmes l’a mis en garde contre sa future épouse. “On ne peut jamais faire totalement confiance aux femmes; pas même aux meilleures d’entre elles.” Ailleurs, il assure - est-il bien placé pour les critiquer sur ce point? - “Elles sont naturellement cachotières et aiment à pratiquer elles-mêmes leur manie.” Au mieux, il considère la femme avec la même objectivité qu’un insecte ou un oiseau migrateur».57 Mais si l’amour ne faisait pas partie du roman policier, la haine n’y tenait pas non plus le premier rôle : «L’intérêt est… le mobile premier du meurtre, la haine est secondaire, tout au plus s’aperçoit-on après coup que la victime n’est guère regrettée, voire que sa disparition offre un soulagement à la plupart».58 Ce qui nous en apprend beaucoup d’une figure de Père jalousée certes, mais non haie puisque la phratrie finissait toujours par la reconduire. Par contre, l’intérêt, en ce qu’il représentait l’ensemble des péchés capitaux – convoitise, jalousie, orgueil, paresse, concupiscence, etc. -, révélait davantage les motivations du meurtre primitif. C’est ainsi que la bourgeoisie a délogé la noblesse et la démocratie remplacée l’autoritarisme.
 Génie; les
affects. Et en particulier l’amour. Malgré les adaptations
romancées au cinéma, les romans policiers étaient aux antipodes
des romans d’amour : «Leur
idéal a été de chasser du roman-problème toute affectivité. Au
fond de leur esthétique, il y a un dualisme qui sépare radicalement
le sensible et l’intellectuel, le physique et le cérébral. Et
toute la signification du roman policier classique est là. Nos
auteurs, d’ailleurs, ont eu pleinement conscience de ce qu’ils
faisaient. Ils ont compris que le roman-problème était une sorte de
purification, et avait une valeur éthique. Ont-ils raison, ou bien
la nature secrète du roman policier leur échappe-t-elle encore, au
moment où ils croient la saisir?».54
L’interdit avait même été codifié dans la règle # 3 de Van Dine, établie en 1928 : «Le
véritable roman policier doit être exempt de toute intrigue
amoureuse. Y introduire de l’amour serait, en effet, déranger le
mécanisme du problème purement intellectuel».55
En conséquence, les personnages, criminels comme détectives,
perdirent beaucoup de la profondeur des caractères habituels des
romans traditionnels. «Ces
personnages sont sans
profondeur, puisqu’ils
ne tirent leur réalité, leur être, que du plan qu’ils sont en
train de concevoir ou de déjouer, mais parce qu’ils sont
semblables à des causes produisant des effets à long terme, la
distance, en quelque sorte, qui sépare l’effet de la cause leur
confère une
épaisseur,
une densité qu’on peut aisément prendre pour de la profondeur.
Tout se passe dans un monde à deux dimensions, car l’épaisseur et
la densité ne sont que des trompe-l’œil, et naissent d’une
certaine façon d’appuyer le trait. La troisième dimension du
roman, c’est la dimension de la souffrance, du doute, ou de
l’espoir, celle de l’affectivité, si l’on veut, et elle manque
toujours plus ou moins au roman policier, dont les protagonistes ne
sont que des silhouettes, des profils, des ombres chinoises. C’est
pourquoi l’amour, qui est l’amorce de la troisième dimension, ne
réussit jamais à se développer, dans les romans de Freeman. Il
n’apparaît que dans sa convention la plus mièvre. Il est plaqué
sur le récit, comme un ornement. Il est un trompe-cœur. On tremble
à la pensée qu’un des personnages des
Hauts de Hurlevent
pourrait faire
Génie; les
affects. Et en particulier l’amour. Malgré les adaptations
romancées au cinéma, les romans policiers étaient aux antipodes
des romans d’amour : «Leur
idéal a été de chasser du roman-problème toute affectivité. Au
fond de leur esthétique, il y a un dualisme qui sépare radicalement
le sensible et l’intellectuel, le physique et le cérébral. Et
toute la signification du roman policier classique est là. Nos
auteurs, d’ailleurs, ont eu pleinement conscience de ce qu’ils
faisaient. Ils ont compris que le roman-problème était une sorte de
purification, et avait une valeur éthique. Ont-ils raison, ou bien
la nature secrète du roman policier leur échappe-t-elle encore, au
moment où ils croient la saisir?».54
L’interdit avait même été codifié dans la règle # 3 de Van Dine, établie en 1928 : «Le
véritable roman policier doit être exempt de toute intrigue
amoureuse. Y introduire de l’amour serait, en effet, déranger le
mécanisme du problème purement intellectuel».55
En conséquence, les personnages, criminels comme détectives,
perdirent beaucoup de la profondeur des caractères habituels des
romans traditionnels. «Ces
personnages sont sans
profondeur, puisqu’ils
ne tirent leur réalité, leur être, que du plan qu’ils sont en
train de concevoir ou de déjouer, mais parce qu’ils sont
semblables à des causes produisant des effets à long terme, la
distance, en quelque sorte, qui sépare l’effet de la cause leur
confère une
épaisseur,
une densité qu’on peut aisément prendre pour de la profondeur.
Tout se passe dans un monde à deux dimensions, car l’épaisseur et
la densité ne sont que des trompe-l’œil, et naissent d’une
certaine façon d’appuyer le trait. La troisième dimension du
roman, c’est la dimension de la souffrance, du doute, ou de
l’espoir, celle de l’affectivité, si l’on veut, et elle manque
toujours plus ou moins au roman policier, dont les protagonistes ne
sont que des silhouettes, des profils, des ombres chinoises. C’est
pourquoi l’amour, qui est l’amorce de la troisième dimension, ne
réussit jamais à se développer, dans les romans de Freeman. Il
n’apparaît que dans sa convention la plus mièvre. Il est plaqué
sur le récit, comme un ornement. Il est un trompe-cœur. On tremble
à la pensée qu’un des personnages des
Hauts de Hurlevent
pourrait faire  irruption dans un roman policier! Quel saccage! C’est
que l’amour est désordre et ne se laisse pas enfermer dans un
“planning”. En revanche, assassin et détective ne manquent pas
d’intensité,
puisqu’ils sont violemment projetés vers l’avenir qui décidera
de leur succès ou de leur échec».56
Pour n'en donner qu'un exemple de la façon dont le roman policier
traitait l'amour, pensons à un roman tardif d'Agatha Christie, The endless night (1967),
où
le narrateur, Michael Rogers, un jeune homme dans la vingtaine, beau
et séduisant mais ambitieux et inconstant, rencontre la fille d'un
riche millionnaire américain, Ellie. Celle-ci achète un terrain en
pleine forêt convoité par le jeune homme. C'est l'histoire d'amour
classique. On croirait s'engager dans un roman d'amour-tragique tant
le destin de la jeune femme est prévisible. Mais c'est pour
apprendre, à la fin, que c'est Michael l'assassin et qu'il a tué
ainsi deux autres femmes et un jeune homme dont il convoitait la
montre bracelet. Michael
irruption dans un roman policier! Quel saccage! C’est
que l’amour est désordre et ne se laisse pas enfermer dans un
“planning”. En revanche, assassin et détective ne manquent pas
d’intensité,
puisqu’ils sont violemment projetés vers l’avenir qui décidera
de leur succès ou de leur échec».56
Pour n'en donner qu'un exemple de la façon dont le roman policier
traitait l'amour, pensons à un roman tardif d'Agatha Christie, The endless night (1967),
où
le narrateur, Michael Rogers, un jeune homme dans la vingtaine, beau
et séduisant mais ambitieux et inconstant, rencontre la fille d'un
riche millionnaire américain, Ellie. Celle-ci achète un terrain en
pleine forêt convoité par le jeune homme. C'est l'histoire d'amour
classique. On croirait s'engager dans un roman d'amour-tragique tant
le destin de la jeune femme est prévisible. Mais c'est pour
apprendre, à la fin, que c'est Michael l'assassin et qu'il a tué
ainsi deux autres femmes et un jeune homme dont il convoitait la
montre bracelet. Michael  est frustré de l'amour maternel et chaque
femme qu'il tue et contri-
est frustré de l'amour maternel et chaque
femme qu'il tue et contri-bue à accen-
tuer son mal-
heur est une sorte de cri d'amour adressé à sa mère. Lors-
qu'il enserre la gorge de Miss Marple, celle-ci n'a qu'à lui lancer que s'il l'étrangle, c'est comme s'il étranglait sa mère, le meurtrier la libère. Sa narration est sa confession : En ma fin est mon commencement. C'est ainsi que les auteurs de romans policiers concevaient l'amour. Par contre, les liens interpersonnels étaient souvent empreints d’homosexualité. Les couples du genre Holmes/Watson ou Poirot/Hastings, dualité qui remontait à Dupin et à son narrateur, sublimaient le lien qui liait un éraste (le détective) à son éromène (le naïf toujours ébahi devant la démonstration du maître). Les femmes dans le roman policier, à l’origine, ne sont bonnes que pour être victimes ou meurtrières. Les détectives ne cessaient, jalousement, de mettre leur associé en garde contre l’insertion de la femme dans leur intimité : «Ignorant encore les projets matrimoniaux de [Watson], Holmes l’a mis en garde contre sa future épouse. “On ne peut jamais faire totalement confiance aux femmes; pas même aux meilleures d’entre elles.” Ailleurs, il assure - est-il bien placé pour les critiquer sur ce point? - “Elles sont naturellement cachotières et aiment à pratiquer elles-mêmes leur manie.” Au mieux, il considère la femme avec la même objectivité qu’un insecte ou un oiseau migrateur».57 Mais si l’amour ne faisait pas partie du roman policier, la haine n’y tenait pas non plus le premier rôle : «L’intérêt est… le mobile premier du meurtre, la haine est secondaire, tout au plus s’aperçoit-on après coup que la victime n’est guère regrettée, voire que sa disparition offre un soulagement à la plupart».58 Ce qui nous en apprend beaucoup d’une figure de Père jalousée certes, mais non haie puisque la phratrie finissait toujours par la reconduire. Par contre, l’intérêt, en ce qu’il représentait l’ensemble des péchés capitaux – convoitise, jalousie, orgueil, paresse, concupiscence, etc. -, révélait davantage les motivations du meurtre primitif. C’est ainsi que la bourgeoisie a délogé la noblesse et la démocratie remplacée l’autoritarisme.
UN ROMAN EXTRAIT DU SOCIUS
C’est un autre de ces non-dits que «l’exercice de la raison bourgeoise dans le roman policier occulte la production sociale du crime».59 Ainsi, «le règne du roman-problème affirme la solidité des valeurs de la démocratie libérale qui assure la protection de la vie et des biens de chacun, leur confirmant qu’ils “naissent libres et égaux en droit”».60 Le roman policier était également là pour dire que le darwinisme n’était pas la fin de la déduction. Qu’il procédait surtout par induction et qu’on ne pouvait dégager de l’espèce le comportement de chaque individu, autrement nous serions condamnés à vivre dans un enfer totalitaire : «La politique totalitaire qui en vint à suivre les recettes des idéologies a dévoilé la véritable nature de ces mouvements dans la mesure où elle a clairement montré qu’il ne pouvait y avoir de terme à ce processus. Si c’est la loi de la Nature d’éliminer tout ce qui est sans défense et inapte à vivre, ce serait la fin de la Nature elle-même si l’on ne pouvait trouver de nouvelles catégories de gens sans défense et inaptes à vivre. Si c’est la loi de l’Histoire que dans une lutte des classes certaines classes “dépérissent”, ce serait la fin de l’Histoire humaine elle-même si ne se formaient de nouvelles classes qui puissent à leur tour “dépérir” sous les doigts des
 diri-
diri-geants totali-
taires. En d’autres termes, la loi du meurtre, par laquelle les mou-
vements totali-
taires prennent et exercent le pouvoir, demeurerait une loi du mouvement, même s’ils réussissaient un jour à soumettre l’humanité tout entière à leur domination».61 Le communisme faisait partie de l’hallucination de bien des personnages secondaires des romans d’Agatha Christie, bien qu’ils ne furent jamais les pires criminels dont le génie s’élève au-dessus des hallucinations. Pour se dégager des visions sombres du socialisme qui ne pouvaient que conduire à des carnages comme la Commune de Paris ou la Révolution bolchevique, il fallait que les détectives viennent à bout du mal. En l’affirmant de façon répétitive, les détectives finissaient par faire douter du bon droit associé à la propriété des biens. Narcejac remarque comment le roman policier «est merveilleusement adroit pour truquer les apparences et faire mentir les choses; en revanche, il est aussi peu humain que possible. À l’extérieur, il manipule les indice en illusionniste consommé; à l’intérieur, il est sec et pauvre. Et, finalement, la faiblesse du roman policier est là! À l’extrême originalité de la mise en scène correspond l’extrême banalité de la motivation. L’assassin ne peut manquer, en fin de compte, de décevoir».62 Car le crime ne datait pas des origines, quoiqu’en dise Freud. C’était bien le crime de la bourgeoisie à l’égard de la société d’Ancien Régime, crime qui se déroulait tous les jours sous ses yeux, jusqu’à la fin de la Grande Guerre et que les Occidentaux continuèrent d’expier jusqu’en 1945. Son ambition, poussée
 par la cupidité maquillée par les idéologies, se
retrouvait dans chaque cri-
par la cupidité maquillée par les idéologies, se
retrouvait dans chaque cri-minel : «L’as-
sassin, poussé par un mobile très puis-
sant, a été acculé au crime; il n’a pas pu faire autrement que de tuer. C’est pour conserver une femme, une position sociale, qu’il a dû tuer. L’assassin de roman policier (même s’il n’a pas prémédité son crime) est un conservateur, un homme (ou une femme) qui refuse de toutes ses forces un changement radical de son existence (pauvreté, divorce, déshonneur), un joueur qui refuse de perdre. La même raison qui l’a poussé à tuer le force donc à rester sur les lieux du crime, toujours menacé, toujours prêt à la riposte : fuir serait perdre tout ce pour quoi il a tué».63 Il y avait des situations analogues «au genre policier qu’Ibsen a cultivé dans ses drames. Ses personnages ont, presque sans exception, commis dans le passé des actes qui exigent une enquête pénale et morale. Ils essaient presque tous d’atteindre le but qu’ils se sont assigné - ou, plus métaphysiquement, le but qui leur a été assigné d’une façon ou d’une autre : “marqués au front du sceau divin”. Ils maintiennent le cap d’un bout à l’autre de l’action, jusqu’à la conclusion atroce et logique…».64 Et lorsque les maîtres sont assassinés pour expier ces crimes lointains, c'est ensuite au tour des domestiques d'y passer. À près d’un siècle de la Révolution française, la Commune de Paris, nettoyée comme on nettoie une ethnie, subissait à son tour la cruauté des maîtres. C’est comme si la littérature régressait par-delà le roman policier pour rejoindre les
 aventures
criminelles légendaires de l’Ancien Régime. Ainsi, l'image des
«plus
fréquen-
aventures
criminelles légendaires de l’Ancien Régime. Ainsi, l'image des
«plus
fréquen-te est celle des bri-
gands. On la trouve entre autres chez le brillant critique littéraire Paul de Saint-Victor, ami de Barbey d’Aurevilly, de Gautier, des Goncourt et de Flaubert : “Une troupe d’êtres inconnus, révélés pour la première fois par l’affiche qui portait leurs noms, rappelant, tant ils étaient obscurs, ces bandits masqués ou barbouillés de noir qui escaladent la nuit la maison qu’ils vont mettre à sac, s’emparent de Paris. Leurs sombres bandes s’ébranlent derrière eux; elles envahissent la ville désarmée. […] Paris pris de stupeur, ne résista pas. […] La Commune s’installa sur le cadavre de cette ville inerte. Quand elle voulut se réveiller, quelques jours après, il était trop tard”».65 Entendons bien ici que le cadavre sur lequel la Commune s’installait était bien celui du Paris bourgeois, celui de Thermidor. Il a tenu à l’échec de l’utopie
 communarde que ceux qui, au départ la
célébrant comme la reprise de 1789, la rabattissent dans la
catégorie du brigandage : «Catulle Mendès utilisera le mot “révolution” pour caractériser la
Commune jusqu’au mois d’avril, mois à partir duquel il emploiera
le mot “émeute”. Sa vision a alors totalement changé. Il écrit
sous le titre “Paris se repent” : “Ah! nous ouvrons les yeux
enfin.
[…] Vous
n’aviez endossé nos opinions que pour nous tromper, comme des
escrocs revêtent la livrée d’une maison pour entrer dans la
chambre du maître et lui voler son argent. Nous vous voyons tels que
vous êtes.
[…] Vous
n’êtes que des émeutiers, et des émeutiers dont le but principal
est de piller et de saccager à la faveur du trouble et de la
nuit”».66
Aussi, les meurtres de domestiques ou d’ouvriers dans les romans
policiers ne comptent-ils pas pour eux-mêmes et n’ont d’intérêt
que dans la mesure où ils conduisent à découvrir le meurtrier du
maître qui est sûrement l'un de ses frères.
Il ne peut y avoir deux morales
sociales dans
la littérature, et surtout dans le roman policier, celle des maîtres
bourgeois et celle des serviteurs prolétaires : «Cette
recherche des faits de conscience aux dépens des gestes, a écrit
Régis Michaud, cette casuistique morale qui à l’intrigue
substitue la recherche des motifs et des mobiles, cette disette
d’imagination sexuelle, tant de passion latente tournée en pure
curiosité, tout cela nous [rend]
étranger».67
communarde que ceux qui, au départ la
célébrant comme la reprise de 1789, la rabattissent dans la
catégorie du brigandage : «Catulle Mendès utilisera le mot “révolution” pour caractériser la
Commune jusqu’au mois d’avril, mois à partir duquel il emploiera
le mot “émeute”. Sa vision a alors totalement changé. Il écrit
sous le titre “Paris se repent” : “Ah! nous ouvrons les yeux
enfin.
[…] Vous
n’aviez endossé nos opinions que pour nous tromper, comme des
escrocs revêtent la livrée d’une maison pour entrer dans la
chambre du maître et lui voler son argent. Nous vous voyons tels que
vous êtes.
[…] Vous
n’êtes que des émeutiers, et des émeutiers dont le but principal
est de piller et de saccager à la faveur du trouble et de la
nuit”».66
Aussi, les meurtres de domestiques ou d’ouvriers dans les romans
policiers ne comptent-ils pas pour eux-mêmes et n’ont d’intérêt
que dans la mesure où ils conduisent à découvrir le meurtrier du
maître qui est sûrement l'un de ses frères.
Il ne peut y avoir deux morales
sociales dans
la littérature, et surtout dans le roman policier, celle des maîtres
bourgeois et celle des serviteurs prolétaires : «Cette
recherche des faits de conscience aux dépens des gestes, a écrit
Régis Michaud, cette casuistique morale qui à l’intrigue
substitue la recherche des motifs et des mobiles, cette disette
d’imagination sexuelle, tant de passion latente tournée en pure
curiosité, tout cela nous [rend]
étranger».67
Les
limites du roman policier apparaissent étroites. Entre les
hallucinations qui trompent (les idéologies) et les déductions qui
révèlent (la mystification), les lecteurs perdaient la vérité à
force de trop vouloir la chercher. En polarisant le criminel et le
détective, ils remarquaient qu’ils appartenaient tous deux à une
sphère ontologique qui dépassait la moyenne des individus qui les
observaient, ébahis par leurs tours
de force. L’auteur
plaçait ses lecteurs devant un effet de doppelgänger
sur
lequel nous aurons à revenir : «L’identification
avec l’adversaire ne fait-elle pas partie de sa méthode? Dupin est
apte à rêver l’orang-outan. La part sombre du détective nous
invite à comprendre que le grand singe fait ce que Dupin a toujours
rêvé de faire, a toujours fait en rêve, ce  que, flâneur nocturne,
il a toujours flairé dans les bas-fonds de la capitale».68
Pour dissimuler ce doublet ou cette correspondance, l’auteur se
gardait de trop brouiller les pistes, de trop amplifier des
hallucinations, de trop multiplier de faux indices ou le nombre des
suspects ayant des motifs pour assassiner la victime. «Plus
que tout autre genre, le roman policier est organisé en labyrinthe,
l’enquêteur allant peu à peu vers le coupable caché en un
centre, afin de le ramener au plein jour».69
Et comme dans la mystification de la
Lettre volée, le
lecteur brûlait
de ne pas s'apercevoir que l'objet du litige était là, devant lui.
Cela prenait plus qu’un officier de police – toujours le premier
leurré -, mais un Être dont l’exceptionnel équivalait à celui
du criminel pour dégager la vue des présomptions du lecteur. Voilà
pourquoi, s’il y a un lien interpersonnel de nature homosexuelle
entre le détective et son acolyte, c’est avec le criminel
qu’existe un véritable lien naturel. À Sherlock Holmes, il faut
Moriarty; à Hercule Poirot, A.B.C., etc. Une fois l’égal en vertu
déductive trouvé, le second peut disparaître, comme Watson et
Hastings, relégués à la plus plate des existences, celle de petits
couples bourgeois. Pourtant, les criminels apparaissent souvent mieux
doués que les détectives qui les affrontent. À part de
s’abandonner à l’abstraction mathématique, Sherlock Holmes
avait une personnalité plutôt médiocre : «Mémorialiste
vigilant et méthodique, le docteur
[Watson] note
donc sur son carnet que les connaissances de son ami en littérature,
en astronomie et en
que, flâneur nocturne,
il a toujours flairé dans les bas-fonds de la capitale».68
Pour dissimuler ce doublet ou cette correspondance, l’auteur se
gardait de trop brouiller les pistes, de trop amplifier des
hallucinations, de trop multiplier de faux indices ou le nombre des
suspects ayant des motifs pour assassiner la victime. «Plus
que tout autre genre, le roman policier est organisé en labyrinthe,
l’enquêteur allant peu à peu vers le coupable caché en un
centre, afin de le ramener au plein jour».69
Et comme dans la mystification de la
Lettre volée, le
lecteur brûlait
de ne pas s'apercevoir que l'objet du litige était là, devant lui.
Cela prenait plus qu’un officier de police – toujours le premier
leurré -, mais un Être dont l’exceptionnel équivalait à celui
du criminel pour dégager la vue des présomptions du lecteur. Voilà
pourquoi, s’il y a un lien interpersonnel de nature homosexuelle
entre le détective et son acolyte, c’est avec le criminel
qu’existe un véritable lien naturel. À Sherlock Holmes, il faut
Moriarty; à Hercule Poirot, A.B.C., etc. Une fois l’égal en vertu
déductive trouvé, le second peut disparaître, comme Watson et
Hastings, relégués à la plus plate des existences, celle de petits
couples bourgeois. Pourtant, les criminels apparaissent souvent mieux
doués que les détectives qui les affrontent. À part de
s’abandonner à l’abstraction mathématique, Sherlock Holmes
avait une personnalité plutôt médiocre : «Mémorialiste
vigilant et méthodique, le docteur
[Watson] note
donc sur son carnet que les connaissances de son ami en littérature,
en astronomie et en  philosophie sont nulles. En politique : faibles.
En anatomie, “exactes, mais sans système”. En chimie,
“appro-
philosophie sont nulles. En politique : faibles.
En anatomie, “exactes, mais sans système”. En chimie,
“appro-
fondies mais excentri-
ques”. À propos de la botanique, il note que le sujet ne connaît rien au jardinage, mais se montre “calé sur la belladone, l’opium, tous les poisons en général”. Il juge ses connaissances en géologie “pratiques mais restreintes”. Elles consistent surtout à distinguer les principales espèces de terrain afin de déceler l’origine des traces de boue - bas de pantalons, chaussures - dans un rayon de 80 kilomètres autour de Londres. Il le reconnaît bien informé de la législation anglaise et lui accorde un certain talent pour l’usage du violon, de la canne, de l’escrime… et de la boxe!…».70 Peut-être fallait-il cette médiocrité intellectuelle pour mieux associer le lecteur à la démonstration? Tout le monde, a priori, pourrait être en mesure de résoudre l’énigme et sortir vainqueur du labyrinthe. Ce qui restait de Holmes c'était un esprit éclectique, perdu dans un savoir encyclopédique désordonné : «Watson, lui-même, se montre souvent fasciné par une conversation évoquant avec passion des sujets rares : proverbes persans, “mistères” du Moyen Âge, mérites respectifs des violons de Stradivarius et de Cremone, bouddhisme à Ceylan, les navires de guerre dans l’avenir, la musique et la poterie médiévales, la permanence de racines chaldéennes dans l’ancienne langue de Cornouailles…».71 On pourrait en dire autant des détectives français des illustrés. Holmes était à l’image d’un H. G. Wells. C’était l’optimisme du Siècle des Lumières, des Encyclopédistes, des Idéologues que méprisaient tant Napoléon. «Par sa personnalité sécurisante, Sherlock Holmes est en lui-même la projection idéale d’une Angleterre victorienne régnant sur les mers et les cœurs, fière de ses institutions, sûre d’elle-même. Si d’aventure la machinerie se détraquait, Holmes n’a-t-il pas démontré qu’il serait là tel un recours suprême? On est aux antipodes de l’univers auto-accusateur, freudien et désespéré qu’exprimera le roman noir américain [après la Seconde Guerre mondiale]».72
 que, flâneur nocturne,
il a toujours flairé dans les bas-fonds de la capitale».68
Pour dissimuler ce doublet ou cette correspondance, l’auteur se
gardait de trop brouiller les pistes, de trop amplifier des
hallucinations, de trop multiplier de faux indices ou le nombre des
suspects ayant des motifs pour assassiner la victime. «Plus
que tout autre genre, le roman policier est organisé en labyrinthe,
l’enquêteur allant peu à peu vers le coupable caché en un
centre, afin de le ramener au plein jour».69
Et comme dans la mystification de la
Lettre volée, le
lecteur brûlait
de ne pas s'apercevoir que l'objet du litige était là, devant lui.
Cela prenait plus qu’un officier de police – toujours le premier
leurré -, mais un Être dont l’exceptionnel équivalait à celui
du criminel pour dégager la vue des présomptions du lecteur. Voilà
pourquoi, s’il y a un lien interpersonnel de nature homosexuelle
entre le détective et son acolyte, c’est avec le criminel
qu’existe un véritable lien naturel. À Sherlock Holmes, il faut
Moriarty; à Hercule Poirot, A.B.C., etc. Une fois l’égal en vertu
déductive trouvé, le second peut disparaître, comme Watson et
Hastings, relégués à la plus plate des existences, celle de petits
couples bourgeois. Pourtant, les criminels apparaissent souvent mieux
doués que les détectives qui les affrontent. À part de
s’abandonner à l’abstraction mathématique, Sherlock Holmes
avait une personnalité plutôt médiocre : «Mémorialiste
vigilant et méthodique, le docteur
[Watson] note
donc sur son carnet que les connaissances de son ami en littérature,
en astronomie et en
que, flâneur nocturne,
il a toujours flairé dans les bas-fonds de la capitale».68
Pour dissimuler ce doublet ou cette correspondance, l’auteur se
gardait de trop brouiller les pistes, de trop amplifier des
hallucinations, de trop multiplier de faux indices ou le nombre des
suspects ayant des motifs pour assassiner la victime. «Plus
que tout autre genre, le roman policier est organisé en labyrinthe,
l’enquêteur allant peu à peu vers le coupable caché en un
centre, afin de le ramener au plein jour».69
Et comme dans la mystification de la
Lettre volée, le
lecteur brûlait
de ne pas s'apercevoir que l'objet du litige était là, devant lui.
Cela prenait plus qu’un officier de police – toujours le premier
leurré -, mais un Être dont l’exceptionnel équivalait à celui
du criminel pour dégager la vue des présomptions du lecteur. Voilà
pourquoi, s’il y a un lien interpersonnel de nature homosexuelle
entre le détective et son acolyte, c’est avec le criminel
qu’existe un véritable lien naturel. À Sherlock Holmes, il faut
Moriarty; à Hercule Poirot, A.B.C., etc. Une fois l’égal en vertu
déductive trouvé, le second peut disparaître, comme Watson et
Hastings, relégués à la plus plate des existences, celle de petits
couples bourgeois. Pourtant, les criminels apparaissent souvent mieux
doués que les détectives qui les affrontent. À part de
s’abandonner à l’abstraction mathématique, Sherlock Holmes
avait une personnalité plutôt médiocre : «Mémorialiste
vigilant et méthodique, le docteur
[Watson] note
donc sur son carnet que les connaissances de son ami en littérature,
en astronomie et en  philosophie sont nulles. En politique : faibles.
En anatomie, “exactes, mais sans système”. En chimie,
“appro-
philosophie sont nulles. En politique : faibles.
En anatomie, “exactes, mais sans système”. En chimie,
“appro-fondies mais excentri-
ques”. À propos de la botanique, il note que le sujet ne connaît rien au jardinage, mais se montre “calé sur la belladone, l’opium, tous les poisons en général”. Il juge ses connaissances en géologie “pratiques mais restreintes”. Elles consistent surtout à distinguer les principales espèces de terrain afin de déceler l’origine des traces de boue - bas de pantalons, chaussures - dans un rayon de 80 kilomètres autour de Londres. Il le reconnaît bien informé de la législation anglaise et lui accorde un certain talent pour l’usage du violon, de la canne, de l’escrime… et de la boxe!…».70 Peut-être fallait-il cette médiocrité intellectuelle pour mieux associer le lecteur à la démonstration? Tout le monde, a priori, pourrait être en mesure de résoudre l’énigme et sortir vainqueur du labyrinthe. Ce qui restait de Holmes c'était un esprit éclectique, perdu dans un savoir encyclopédique désordonné : «Watson, lui-même, se montre souvent fasciné par une conversation évoquant avec passion des sujets rares : proverbes persans, “mistères” du Moyen Âge, mérites respectifs des violons de Stradivarius et de Cremone, bouddhisme à Ceylan, les navires de guerre dans l’avenir, la musique et la poterie médiévales, la permanence de racines chaldéennes dans l’ancienne langue de Cornouailles…».71 On pourrait en dire autant des détectives français des illustrés. Holmes était à l’image d’un H. G. Wells. C’était l’optimisme du Siècle des Lumières, des Encyclopédistes, des Idéologues que méprisaient tant Napoléon. «Par sa personnalité sécurisante, Sherlock Holmes est en lui-même la projection idéale d’une Angleterre victorienne régnant sur les mers et les cœurs, fière de ses institutions, sûre d’elle-même. Si d’aventure la machinerie se détraquait, Holmes n’a-t-il pas démontré qu’il serait là tel un recours suprême? On est aux antipodes de l’univers auto-accusateur, freudien et désespéré qu’exprimera le roman noir américain [après la Seconde Guerre mondiale]».72
Il
en allait de même pour Agatha Christie qui sut maintenir, tout au
long du XXe siècle, l’esprit de Doyle et de Holmes à travers une
multitude de nouvelles et de romans policiers. Comme tout bon auteur
de roman policier depuis Poe, elle chérissait les lieux fermés, les
chambres closes – comme la chambre jaune de Gaston Leroux. Mais
aussi des lieux mouvants : «On
connaît la place particulière qu’auront pour elle les trains,
précisément parce qu’ils réunissent les caractères opposés
d’un espace clos et familier avec l’aventure illimitée et la
découverte de l’inconnu. On y range avec soin sa mallette à
bijoux et l’on s’y fait assassiner sauvagement à la faveur d’un
jeu de passe-passe entre les compartiments».73
Le crime en situation de claustration resta toujours un défi
intéressant à relever : cabines de passager sur un navire
remontant le Nil ou de l’Orient-Express, véritable foire du crime,
L’express
de Plymouth, Le train bleu, Le train de 16 h. 50 de
Paddington appartiennent aux crimes les  plus sanglants d’Agatha
Christie. Pourtant, «il
n’y a jamais de mons-
plus sanglants d’Agatha
Christie. Pourtant, «il
n’y a jamais de mons-
tres sangui-
naires, incom-
préhen-
sibles chez Agatha Christie, les crimes les plus abjects s’expliquent très facilement et, quant à la folie, si elle déconcerte un moment, c’est faute d’avoir suffisamment réfléchi».74 Parce que le crime, en soi, y est déjà assez monstrueux. Les bourgeois du XIXe siècle étaient trop cultivés, trop intelligents, bref supérieurs pour s’adonner à des massacres à la tronçonneuse. Il fallait appartenir aux basses classes, à la pègre, pour commettre des crimes aussi sanglants que celui de l’Express de Plymouth où la bonne et un receleur de diamants conspirent et assassinent une brave jeune femme à la veille de son mariage pour lui dérober ses bijoux. Mais «le cas le plus troublant est bien sûr celui où le jeune homme en question exploite ainsi sa mère qui avait caché sa naissance illégitime et qui, dans un mélange d’amour et de culpabilité, lui prépare la voie vers le crime. Cas d’autant plus difficilement décelable que rien, hormis cette faute ancienne inconnue, ne vient ternir la réputation de cette mère, assurée de ce fait de la confiance de tous jusques et y compris de celle du lecteur».75 L’idiosyncrasie des criminels varie, mais «le héros christien est à peu de chose près identique d’un roman à l’autre et se formule ainsi : “On découvre un cadavre.” […] Le tableau ainsi posé a une caractéristique principale : l’élément majeur et actif, le meurtrier, est manquant».76 Bref, des crimes bourgeois, comme l’exécution de Louis XVI ou celle des Romanov. Devant les images pitoyables que Louis XVI et Nicolas II nous ont laissé d’eux-mêmes, la froideur d’un Robespierre comme celle d’un Lénine évoquerait l’inhumanité de Holmes et de Poirot.
 plus sanglants d’Agatha
Christie. Pourtant, «il
n’y a jamais de mons-
plus sanglants d’Agatha
Christie. Pourtant, «il
n’y a jamais de mons-tres sangui-
naires, incom-
préhen-
sibles chez Agatha Christie, les crimes les plus abjects s’expliquent très facilement et, quant à la folie, si elle déconcerte un moment, c’est faute d’avoir suffisamment réfléchi».74 Parce que le crime, en soi, y est déjà assez monstrueux. Les bourgeois du XIXe siècle étaient trop cultivés, trop intelligents, bref supérieurs pour s’adonner à des massacres à la tronçonneuse. Il fallait appartenir aux basses classes, à la pègre, pour commettre des crimes aussi sanglants que celui de l’Express de Plymouth où la bonne et un receleur de diamants conspirent et assassinent une brave jeune femme à la veille de son mariage pour lui dérober ses bijoux. Mais «le cas le plus troublant est bien sûr celui où le jeune homme en question exploite ainsi sa mère qui avait caché sa naissance illégitime et qui, dans un mélange d’amour et de culpabilité, lui prépare la voie vers le crime. Cas d’autant plus difficilement décelable que rien, hormis cette faute ancienne inconnue, ne vient ternir la réputation de cette mère, assurée de ce fait de la confiance de tous jusques et y compris de celle du lecteur».75 L’idiosyncrasie des criminels varie, mais «le héros christien est à peu de chose près identique d’un roman à l’autre et se formule ainsi : “On découvre un cadavre.” […] Le tableau ainsi posé a une caractéristique principale : l’élément majeur et actif, le meurtrier, est manquant».76 Bref, des crimes bourgeois, comme l’exécution de Louis XVI ou celle des Romanov. Devant les images pitoyables que Louis XVI et Nicolas II nous ont laissé d’eux-mêmes, la froideur d’un Robespierre comme celle d’un Lénine évoquerait l’inhumanité de Holmes et de Poirot.
Ce
type de romans policiers toucha très vite à sa fin et si ce n’eût
été du cinéma puis de la télévision, il serait resté à l’état
de mythologie.
C’est
d’Amérique que vînt la relève, avant même la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Les nouveaux auteurs de romans policiers
ressemblaient drôlement, d’ailleurs, aux personnages des romans
antérieurs, ainsi de Dashell Hammett, aux goûts «très
éclectiques. Beaucoup plus cultivé que ses personnages, élégant
d’allure, il ne leur ressemblait guère, si ce n’est par la
passion des femmes… et de la boisson. Si l’on en croit Lillian
Hellmann, sa compagne de 1933 à 1961, il adorait disserter sur des
sujets aussi hétéroclites que le judaïsme,  l’architecture de la
Nouvelle-Orléans, la physique du plasma, la polli-
l’architecture de la
Nouvelle-Orléans, la physique du plasma, la polli-
nisation croisée du maïs, la rétine de l’œil, les théories de Marx et Engels, les fabricants de fusils en Allemagne au XVIIe siècle. Son érudition historique transparaît dans le Faucon maltais où l’un des bandits énumère divers ouvrages sur l’ordre de Malte. Il se montre familier de l’histoire des Rose-Croix dans la nouvelle On demande Spade. Coquetterie d’érudit, il a reproduit dans Tulip une de ses anciennes notes de lecture relative à “la Fraternité des Rose-Croix”».77 C’est le début du roman noir, roman policier qui a perdu son regard optimiste sur les capacités de la déduction et pour qui le criminel sera toujours plus intéressant que son prédateur qui, lui, s’enfonce dans l’alcool et la drogue, les petites femmes et les causes minables : «La rénovation du roman policier entreprise par l’auteur du Faucon maltais a inspiré à Raymond Chandler un mot célèbre : “Hammett a sorti le crime de son vase vénitien et l’a flanqué dans le ruisseau.” Il ajoute : “On n’est pas obligé de l’y laisser à jamais, mais l’idée me paraissait pas mauvaise de l’éloigner autant que faire se pouvait des conceptions petit-bourgeoises sur le grignotage des ailes de poulet par les jeunes filles du grand monde. […] Hammett a remis l’assassinat entre les mains des gens qui le commettent pour des raisons solides et non pour fournir un cadavre à l’auteur. Qui le commettent avec les moyens du bord et non avec des pistolets de duel ciselés à la main, du curare ou des poisons tropicaux. Il colla ces gens sur le papier tels qu’ils sont dans la vie et il leur donna le style et les réactions qui sont habituellement les leurs, dans des circonstances données”».78
Si le darwinisme et la paléoanthropologie ont influencé par la bande le développement de ce genre romanesque, il faut leur ajouter un troisième larron, l’hygiénisme. Il n’y avait pas que les tares héréditaires qui pouvaient exiger une enquête sur les origines des individus, il y avait aussi la quête des infiniment petits. Ce qui contribuait à la dégénérescence, c’était l’action des virus et des bactéries. Ces maladies comme l’hérédosyphilis et l’hérédotuberculose ajoutaient à l’enquête policière. On a vu son effet sur les romans d’Émile Zola ou le théâtre d’Henrik Ibsen. Une maladie héréditaire ou un virus pouvait également se faufiler dans l’intrigue policière. Dans Le miroir se brisa d’Agatha Christie, l’actrice Marina Gregg, reconnue pour sa beauté et les rôles tragiques qu’elle interprète au cinéma, est appelée à commettre deux meurtres et un suicide parce qu’ayant contracté la rubéole alors qu’elle était enceinte, a mis au monde un enfant lourdement handicapé qu’elle cache aux paparazzi de la presse hollywoodienne. Le rythme de l’action suit un tercet de Tennyson :
 l’architecture de la
Nouvelle-Orléans, la physique du plasma, la polli-
l’architecture de la
Nouvelle-Orléans, la physique du plasma, la polli-nisation croisée du maïs, la rétine de l’œil, les théories de Marx et Engels, les fabricants de fusils en Allemagne au XVIIe siècle. Son érudition historique transparaît dans le Faucon maltais où l’un des bandits énumère divers ouvrages sur l’ordre de Malte. Il se montre familier de l’histoire des Rose-Croix dans la nouvelle On demande Spade. Coquetterie d’érudit, il a reproduit dans Tulip une de ses anciennes notes de lecture relative à “la Fraternité des Rose-Croix”».77 C’est le début du roman noir, roman policier qui a perdu son regard optimiste sur les capacités de la déduction et pour qui le criminel sera toujours plus intéressant que son prédateur qui, lui, s’enfonce dans l’alcool et la drogue, les petites femmes et les causes minables : «La rénovation du roman policier entreprise par l’auteur du Faucon maltais a inspiré à Raymond Chandler un mot célèbre : “Hammett a sorti le crime de son vase vénitien et l’a flanqué dans le ruisseau.” Il ajoute : “On n’est pas obligé de l’y laisser à jamais, mais l’idée me paraissait pas mauvaise de l’éloigner autant que faire se pouvait des conceptions petit-bourgeoises sur le grignotage des ailes de poulet par les jeunes filles du grand monde. […] Hammett a remis l’assassinat entre les mains des gens qui le commettent pour des raisons solides et non pour fournir un cadavre à l’auteur. Qui le commettent avec les moyens du bord et non avec des pistolets de duel ciselés à la main, du curare ou des poisons tropicaux. Il colla ces gens sur le papier tels qu’ils sont dans la vie et il leur donna le style et les réactions qui sont habituellement les leurs, dans des circonstances données”».78
L'HYGIÉNISME MORAL DU ROMAN POLICIER
Si le darwinisme et la paléoanthropologie ont influencé par la bande le développement de ce genre romanesque, il faut leur ajouter un troisième larron, l’hygiénisme. Il n’y avait pas que les tares héréditaires qui pouvaient exiger une enquête sur les origines des individus, il y avait aussi la quête des infiniment petits. Ce qui contribuait à la dégénérescence, c’était l’action des virus et des bactéries. Ces maladies comme l’hérédosyphilis et l’hérédotuberculose ajoutaient à l’enquête policière. On a vu son effet sur les romans d’Émile Zola ou le théâtre d’Henrik Ibsen. Une maladie héréditaire ou un virus pouvait également se faufiler dans l’intrigue policière. Dans Le miroir se brisa d’Agatha Christie, l’actrice Marina Gregg, reconnue pour sa beauté et les rôles tragiques qu’elle interprète au cinéma, est appelée à commettre deux meurtres et un suicide parce qu’ayant contracté la rubéole alors qu’elle était enceinte, a mis au monde un enfant lourdement handicapé qu’elle cache aux paparazzi de la presse hollywoodienne. Le rythme de l’action suit un tercet de Tennyson :
The
mirror carck’d from side to side
“The
curse is come upon me”, cried
The
Lady of Shalott.
 Ce
qui étonne les témoins, c’est l’aspect somnambu-
Ce
qui étonne les témoins, c’est l’aspect somnambu-lesque que prend Marina Gregg lorsqu’elle se trouve placée devant un tableau montrant une Vierge à l’enfant. Le moment où le miroir se fend d’un bord à l’autre. Devant son drame intérieur refoulé, Marina Gregg se révèle prisonnière de son intérieur où se dissimule un funeste secret. Cette intériorité nous ramène à la chambre close de l’intérieur, celle qui, d’Edgar Poe à Gaston Leroux en passant par Conan Doyle, servait de métaphore à l’inconscient du criminel comme du détective. Le vieux rêve du cercueil aménagé de L’enterrement prématuré de la première période de la littérature gothique, lors de la Révolution industrielle, s’était métamorphosé en appartement où les couches d’ornementation équivalaient à des efforts sans cesse répétés de refoulement. Dans Paris, capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin fait l’observation suivante : «L’intérieur est non seulement l’univers, mais aussi l’étui de l’homme privé. Habiter signifie laisser des traces. Dans l’intérieur l’accent est mis sur elles. On imagine en masse des housses et des taies, des gaines et des étuis, où les objets d’usage quotidien
 impriment leur trace. Elles aussi, les traces de l’habitant
s’impriment sur son intérieur. De là naît le roman policier qui
est à l’affût de ces traces. La “philosophie du mobilier”
autant que ses nouvelles policières révèlent en Poe le premier
physionomiste de l’intérieur. Les criminels des premiers romans
policiers ne sont ni des gentlemen ni des apaches, mais des hommes
privés appartenant à la bourgeoisie».79
Le rapport entre l’inconscient et l’environnement intérieur, en
étroite symbiose, jouait des hallucinations, comme celle de Marina
Gregg devant la peinture ou lorsqu’elle simule une tentative
d’empoisonnement. Prisonnière de son inconscient comme de son
manoir qu’elle vient d’acheter avec son jeune époux, elle sombre
et se noie peu à peu en elle-même. Alors que le policier cherche
les indices dans l’environnement de l’actrice, Miss
Marple découvre très vite que le drame est purement intérieur :
«Benjamin
découvre le rapport entre le roman policier et l’“intérieur”
bourgeois, l’appartement comme champ de traces et de pièces à
conviction (Sens
unique,
1928). Ce n’est pas un hasard si Edgar Poe est aussi l’auteur
d’une “philosophie du mobilier”. L’appartement bourgeois
surchargé est le cadre prédestiné du roman policier : “Sur ce
sofa Tante ne peut être qu’assassinée”. Selon Benjamin, “le
contenu social initial du récit policier est l’effacement des
traces de l’individu dans la foule de la grande ville”».80
C’est ainsi que le roman policier devint également un roman
médical
ou
plutôt, hygiéniste.
impriment leur trace. Elles aussi, les traces de l’habitant
s’impriment sur son intérieur. De là naît le roman policier qui
est à l’affût de ces traces. La “philosophie du mobilier”
autant que ses nouvelles policières révèlent en Poe le premier
physionomiste de l’intérieur. Les criminels des premiers romans
policiers ne sont ni des gentlemen ni des apaches, mais des hommes
privés appartenant à la bourgeoisie».79
Le rapport entre l’inconscient et l’environnement intérieur, en
étroite symbiose, jouait des hallucinations, comme celle de Marina
Gregg devant la peinture ou lorsqu’elle simule une tentative
d’empoisonnement. Prisonnière de son inconscient comme de son
manoir qu’elle vient d’acheter avec son jeune époux, elle sombre
et se noie peu à peu en elle-même. Alors que le policier cherche
les indices dans l’environnement de l’actrice, Miss
Marple découvre très vite que le drame est purement intérieur :
«Benjamin
découvre le rapport entre le roman policier et l’“intérieur”
bourgeois, l’appartement comme champ de traces et de pièces à
conviction (Sens
unique,
1928). Ce n’est pas un hasard si Edgar Poe est aussi l’auteur
d’une “philosophie du mobilier”. L’appartement bourgeois
surchargé est le cadre prédestiné du roman policier : “Sur ce
sofa Tante ne peut être qu’assassinée”. Selon Benjamin, “le
contenu social initial du récit policier est l’effacement des
traces de l’individu dans la foule de la grande ville”».80
C’est ainsi que le roman policier devint également un roman
médical
ou
plutôt, hygiéniste.
Métaphorique
à première vue, «lorsque
la médecine ira chercher dans une observation intensive et
minutieuse des excréments l’indice visible de la santé de ses
patients, elle ne fera jamais que penser les formes, couleurs et
autres qualités de la merde comme reflet tangible renvoyant
immédiatement en miroir les qualités du corps :
[le parcours du médecin,] comme
celui d’une police chargée de scruter pour mettre au jour leur
vérité des traces, des indices, des empreintes de suspects».81
Nous nous confrontons à l’idée que le roman policier n'est au
fond qu'un type de  littérature sadique-anal, l’inconscient ou le
refoulé des criminels, comme des témoins ou des complices, sont
autant de matières
fécales dans
lesquelles le détective est contraint de mettre le nez. Et,
effectivement, ce qu’on y trouve ne sent jamais la rose. Il n’en
va pas seulement des secrets coupables que le détective doit
exhumer, mais également des tares dues à des maladies fatales :
«Un des
premiers soucis de la lutte antituberculeuse, de 1920 à 1930
environ, fut de neutraliser le “porteur de bacilles”, en
l’identifiant d’abord, puis en l’isolant pour l’empêcher de
contaminer son milieu par la suite. Depuis qu’il sait la
tuberculose contagieuse, “l’hygiéniste a laissé de côté son
détachement de savant pour prendre des allures d’enquêteur de
police : ce ne sont plus des lois naturelles que l’on s’efforce
de découvrir, mais des suspects”. Les réflexes policiers,
abandonnés après 1930, refont pourtant surface de temps à autre
dans le discours des médecins engagés dans la lutte».82
La similitude entre l’enquête médicale et l’enquête policière
n’est pas une invention du docteur House,
au nom si
bien choisi. Pour l'hygiéniste, sonder les corps concouraient à une
expérience esthétique morbide. Par contre, pour Edgar Poe, un fin
raisonnement aussi relevait d'une expérience esthétique. Expérience
comparable à la beauté d’une femme suprêmement intelligente et
immaculée mais morte de phtisie (Ligeia,
Lenore,
Annabel
Lee,
etc.). Une femme dont le corps était dépouillé de toute vie
susceptible de la corrompre, comme chez Marina Gregg. Chez Poe, il
n’y avait de chair sinon peut-être que dans l’obsession
névropathe : les dents de Bérénice,
les corps lacérés et démembrés des femmes Lespanaye, le cadavre
gonflé et tuméfié de Marie Rogêt, le spectre vaporeux de Madeline
Usher : le ver conquérant… Gordon
Pym raconte
la lente dérive dans cet océan d’où émergent tant d’écueils
de chairs pourrissantes : de la
littérature sadique-anal, l’inconscient ou le
refoulé des criminels, comme des témoins ou des complices, sont
autant de matières
fécales dans
lesquelles le détective est contraint de mettre le nez. Et,
effectivement, ce qu’on y trouve ne sent jamais la rose. Il n’en
va pas seulement des secrets coupables que le détective doit
exhumer, mais également des tares dues à des maladies fatales :
«Un des
premiers soucis de la lutte antituberculeuse, de 1920 à 1930
environ, fut de neutraliser le “porteur de bacilles”, en
l’identifiant d’abord, puis en l’isolant pour l’empêcher de
contaminer son milieu par la suite. Depuis qu’il sait la
tuberculose contagieuse, “l’hygiéniste a laissé de côté son
détachement de savant pour prendre des allures d’enquêteur de
police : ce ne sont plus des lois naturelles que l’on s’efforce
de découvrir, mais des suspects”. Les réflexes policiers,
abandonnés après 1930, refont pourtant surface de temps à autre
dans le discours des médecins engagés dans la lutte».82
La similitude entre l’enquête médicale et l’enquête policière
n’est pas une invention du docteur House,
au nom si
bien choisi. Pour l'hygiéniste, sonder les corps concouraient à une
expérience esthétique morbide. Par contre, pour Edgar Poe, un fin
raisonnement aussi relevait d'une expérience esthétique. Expérience
comparable à la beauté d’une femme suprêmement intelligente et
immaculée mais morte de phtisie (Ligeia,
Lenore,
Annabel
Lee,
etc.). Une femme dont le corps était dépouillé de toute vie
susceptible de la corrompre, comme chez Marina Gregg. Chez Poe, il
n’y avait de chair sinon peut-être que dans l’obsession
névropathe : les dents de Bérénice,
les corps lacérés et démembrés des femmes Lespanaye, le cadavre
gonflé et tuméfié de Marie Rogêt, le spectre vaporeux de Madeline
Usher : le ver conquérant… Gordon
Pym raconte
la lente dérive dans cet océan d’où émergent tant d’écueils
de chairs pourrissantes : de la  gangrène qui ronge la jambe
d’Auguste aux créatures polaires velues et noirâtres en passant
par le cadavre ballotté au gré des flots sur le navire dérivant
porteur de la peste. Ces irruptions de chairs putréfiées affleurent
de cet océan incommensurable, faisant dévier tout raisonnement
comme expérience esthétique. C’est le seuil des hallucinations
qui fait dévier les déductions de Dupin et de Legrand en
fascinations morbides chez Usher et Ægus; fascinations d’un poète
qui aurait enfin le contrôle parfait de son refoulé. Telles
agissaient également ces idéologies suppurées par la fonction
débridée (et déviée) de l’Idéologique depuis le milieu du XIXe
siècle, la fonction du roman policier consistant à dresser une
métaphore métaphysique de la vérité et de l’erreur qui
émergeaient de ce que de Maistre appelait si justement la
raison raisonnante.
Nous sommes bien là à l’origine de ce que Nathalie Sarraute
appellera l’ère
du soupçon.
En ce sens, le roman policier exerçait une fonction cathartique
de la culpabilité du meurtre de la figure du Père et de tout ce que
ce geste entraînait dans l’angoisse existentielle des Occidentaux.
gangrène qui ronge la jambe
d’Auguste aux créatures polaires velues et noirâtres en passant
par le cadavre ballotté au gré des flots sur le navire dérivant
porteur de la peste. Ces irruptions de chairs putréfiées affleurent
de cet océan incommensurable, faisant dévier tout raisonnement
comme expérience esthétique. C’est le seuil des hallucinations
qui fait dévier les déductions de Dupin et de Legrand en
fascinations morbides chez Usher et Ægus; fascinations d’un poète
qui aurait enfin le contrôle parfait de son refoulé. Telles
agissaient également ces idéologies suppurées par la fonction
débridée (et déviée) de l’Idéologique depuis le milieu du XIXe
siècle, la fonction du roman policier consistant à dresser une
métaphore métaphysique de la vérité et de l’erreur qui
émergeaient de ce que de Maistre appelait si justement la
raison raisonnante.
Nous sommes bien là à l’origine de ce que Nathalie Sarraute
appellera l’ère
du soupçon.
En ce sens, le roman policier exerçait une fonction cathartique
de la culpabilité du meurtre de la figure du Père et de tout ce que
ce geste entraînait dans l’angoisse existentielle des Occidentaux.
«La passion du public pour les romans noirs et les romans policiers était-elle une manière de compenser la docilité grandissante de ses mœurs?»,83 Moins une compensation qu’une thérapie. «Le caractère le plus étonnant de notre situation culturelle-morale est sans doute l’avidité insatiable de la conscience moderne de lire des histoires policières. Ces histoires, à mon sens, font partie, elles aussi, des
institutions morales d’aération et de ventilation d’une
civilisation condamnée à vivre avec un trop grand mélange de
normes, d’ambiguïtés et d’éthiques contraires. Le genre dans
son ensemble apparaît en rapport avec l’éthique collective comme
le médium institutionnalisé de l’aveu. Chaque histoire policière
est de nouveau une sortie pour un amoralisme expérimental. Elle met,
dans la fiction, le “bonheur dans le crime” (Barbey d’Aurevilly)
à la portée de tous. Dans les mouvements de la pensée des
histoires policières modernes, depuis Poe jusqu’à l’époque
actuelle, ceux d’une analyse du cynisme sont in
nuce
faits d’avance. Car les bonnes histoires policières travaillent
sans exception à la relativisation du crime individuel. Si le
détective est le représentant de l’Aufklärung,
le criminel serait celui de l’immoralité, la victime celui de la
morale. Cependant ce rapport est régulièrement ébranlé quand
l’investigation sur la culpabilité parvient là où les victimes -
qui du point de vue de la dramaturgie sont d’abord victimes
“innocentes” - perdent elles-mêmes leur innocence, où elles
sont plongées dans la pénombre et ne sont séparées du criminel
portant la main sur elles, que par une ligne juridique extrêmement
fine; celle-ci sépare les immoralismes cyniques et impunis et les
délits proprement dits. Dans le cas extrême c’est le criminel qui
- quasiment comme un penseur de l’Aufklärung
que l’on provoque - ne fait qu’exécuter sur sa victime
l’amoralité propre de celle-ci. “Ce n’est pas l’assassin qui
est coupable mais l’assassiné.” (Werfel) Ce sont les films où à
la fin le
des
institutions morales d’aération et de ventilation d’une
civilisation condamnée à vivre avec un trop grand mélange de
normes, d’ambiguïtés et d’éthiques contraires. Le genre dans
son ensemble apparaît en rapport avec l’éthique collective comme
le médium institutionnalisé de l’aveu. Chaque histoire policière
est de nouveau une sortie pour un amoralisme expérimental. Elle met,
dans la fiction, le “bonheur dans le crime” (Barbey d’Aurevilly)
à la portée de tous. Dans les mouvements de la pensée des
histoires policières modernes, depuis Poe jusqu’à l’époque
actuelle, ceux d’une analyse du cynisme sont in
nuce
faits d’avance. Car les bonnes histoires policières travaillent
sans exception à la relativisation du crime individuel. Si le
détective est le représentant de l’Aufklärung,
le criminel serait celui de l’immoralité, la victime celui de la
morale. Cependant ce rapport est régulièrement ébranlé quand
l’investigation sur la culpabilité parvient là où les victimes -
qui du point de vue de la dramaturgie sont d’abord victimes
“innocentes” - perdent elles-mêmes leur innocence, où elles
sont plongées dans la pénombre et ne sont séparées du criminel
portant la main sur elles, que par une ligne juridique extrêmement
fine; celle-ci sépare les immoralismes cyniques et impunis et les
délits proprement dits. Dans le cas extrême c’est le criminel qui
- quasiment comme un penseur de l’Aufklärung
que l’on provoque - ne fait qu’exécuter sur sa victime
l’amoralité propre de celle-ci. “Ce n’est pas l’assassin qui
est coupable mais l’assassiné.” (Werfel) Ce sont les films où à
la fin le  commissaire descend la rue tout pensif, l’air d’être
désolé d’avoir résolu aussi cette énig-me».84
Une finale à la Quai des orfèvres de
Stee-
commissaire descend la rue tout pensif, l’air d’être
désolé d’avoir résolu aussi cette énig-me».84
Une finale à la Quai des orfèvres de
Stee-
man. Comme l’énonce la règle # 3 de Van Dine, il est préférable de fermer «les yeux, au lieu de les ouvrir tout grands. Fiez-vous aux yeux de l’esprit et non à ceux du corps. Faites fonctionner les petites cellules grises de votre cerveau…»,85 comme le conseille Hercule Poirot dans La mort dans les nuages. Le roman policier appartiendrait donc à l’hygiène morale propre à l’âge de l’Anus Mundi : «Qu’est-ce qui fait problème dans une histoire policière? Un meurtre? Pas nécessairement. Nous ne trouvons, en effet, que quatre meurtres dans les douze nouvelles des Aventures de Sherlock Holmes […]. En fait, nous rencontrons parfois, dans les nouvelles et dans les romans policiers, en guise de problèmes, des vols, des incendies, des chantages, des lettres anonymes, de mauvaises farces… Parfois aussi nous rencontrons des assassinats. Ceux-ci ont donc, littérairement, même fonction que des cambriolages ou des fraudes. Un assassinat a, dans Ten days’wonder d’E. Queen, même fonction qu’un larcin, un blasphème, un adultère ou un faux témoignage. Quelle fonction? La fonction d’un méfait. D’une action qui nous paraît mauvaise parce qu’elle viole les règles de la collectivité humaine où vit l’acteur. Donc d’un dérèglement social, mais d’un dérèglement que la société punit. C’est-à-dire : d’un crime. Or, les crimes provoquent normalement cette administration, chargée de garder les règlements, que nous nommons “police”…».86 C’est ainsi que l’hygiène morale finissait par découler du nécessaire refoulement du mal ou de l'ostracisation des malfaiteurs qui rendent possible la vie en collectivité.
Dans la façon de présenter les reportages sur les grands crimes et les romans policiers, l’organisation éditoriale des journaux confirmait cette demande hygiéniste qui, exigeait un surplus de moralité. «Tenues à plus de précautions, la Presse et la Patrie compensaient les nouvelles et les images scabreuses par les annonces et les photos religieuses. […] Mgr Bruchési condamna une fois de plus l’exploitation des curiosités morbides, la publication des photos et récits “de drames sanglants et démoralisateurs”. En pareil cas, la Presse et la Patrie s’amendaient pendant quelque temps, puis recommençaient peu à
peu».87
Récits et photos revenaient car elles étaient indispensables à
l'action du refoulement : associer la valeur de l'expiation à
l'énormité de la transgression. L’hygiène morale, comme nous le
verrons, ne peut être efficace que si le désordre refoulé n’est
pas ramené d’une manière ou d’une autre à la conscience.
Bertillon lui-même, le grand criminaliste français imbu du
positivisme et des dossiers classifiés, ne comprenait pas davantage
l’opération médiatique des crimes : «Le
sang du policier français ne fit qu’un tour lorsqu’il aperçut
dans la presse parisienne des caricatures qui le dépeignaient en
homme toujours à l’affût des traces de mains; une colère froide
le saisit en découvrant dans le journal L’Assiette au beurre
un dessin qui le montrait observant, une grosse loupe à la main, les
marques de doigts sales laissées dans une quelconque sinistre
toilette».88
Il faut le rappeler. Le crime est la dé-chié,
non seulement du criminel mais de la société entière :
bijoux, maison ravagée par un incendie, vol de banque, cadavres peu
importe, le délinquant semble convoiter les rapines de la société
bourgeoise : extraction de minerais précieux; propriétés
ostentatoires; voûte des richesses accumulées et extorquées;
victimes des prédations coloniales. Dans les romans christiens,
l'énigme commence souvent dans une colonie britannique, en Afrique
ou de préférence en Inde. Il arrive que la victime ait elle-même
commis un forfait dans les possessions coloniales de l'Empire. Toutes
ces richesses sont en fait des produits abjects et le détective sait
qu'ils contaminent pathologiquement les esprits : «Ce
détective se distinguait d’ailleurs de Lecoq par un détail
significatif : ses doigts et ses mains étaient couverts de brûlures
occasionnées par divers acides. Sherlock Holmes était un chimiste
et un
temps, puis recommençaient peu à
peu».87
Récits et photos revenaient car elles étaient indispensables à
l'action du refoulement : associer la valeur de l'expiation à
l'énormité de la transgression. L’hygiène morale, comme nous le
verrons, ne peut être efficace que si le désordre refoulé n’est
pas ramené d’une manière ou d’une autre à la conscience.
Bertillon lui-même, le grand criminaliste français imbu du
positivisme et des dossiers classifiés, ne comprenait pas davantage
l’opération médiatique des crimes : «Le
sang du policier français ne fit qu’un tour lorsqu’il aperçut
dans la presse parisienne des caricatures qui le dépeignaient en
homme toujours à l’affût des traces de mains; une colère froide
le saisit en découvrant dans le journal L’Assiette au beurre
un dessin qui le montrait observant, une grosse loupe à la main, les
marques de doigts sales laissées dans une quelconque sinistre
toilette».88
Il faut le rappeler. Le crime est la dé-chié,
non seulement du criminel mais de la société entière :
bijoux, maison ravagée par un incendie, vol de banque, cadavres peu
importe, le délinquant semble convoiter les rapines de la société
bourgeoise : extraction de minerais précieux; propriétés
ostentatoires; voûte des richesses accumulées et extorquées;
victimes des prédations coloniales. Dans les romans christiens,
l'énigme commence souvent dans une colonie britannique, en Afrique
ou de préférence en Inde. Il arrive que la victime ait elle-même
commis un forfait dans les possessions coloniales de l'Empire. Toutes
ces richesses sont en fait des produits abjects et le détective sait
qu'ils contaminent pathologiquement les esprits : «Ce
détective se distinguait d’ailleurs de Lecoq par un détail
significatif : ses doigts et ses mains étaient couverts de brûlures
occasionnées par divers acides. Sherlock Holmes était un chimiste
et un  physicien qui, pour dépister les traces du criminel, non
seulement mettait en branle ses facultés intellectuelles et
employait la loupe, mais aussi appliquait des procédés chimiques».89
D’où l’apparition des gants de plastiques immanquables dans les
films et séries actuels. Tout se passe d’ailleurs dans un
environnement malsain, pollué, centre des miasmes les plus
abominables : «La
ville, oui, mais précisons encore : la ville industrielle, avec son
cortège de miséreux, de déracinés, prêts à devenir des hommes
de main. Il y a toujours eu des cours des miracles, des “milieux”,
des pègres. Mais c’étaient les éléments lourds d’une société
très hiérarchisée. Ils coulaient d’eux-mêmes dans les
bas-fonds. Avec l’apparition des “affaires”, tout change. Il se
produit un brassage qui déplace les individus».90
Sur une échelle plus large encore, ce n’est pas un hasard si le
régime fasciste de Mussolini mena une guerre sans précédent contre
la mafia et les sociétés secrètes criminelles italiennes, cette
lutte relevait la valeur morale du régime despotique. Deux types de
criminalité se confrontaient dans un rapport de la modernité au
primitif : «L’aventure
du Ventennio*
était-elle vraiment réductible à une action dramatique entre le
personnage de Mussolini et son auteur, le peuple? L’explication du
fascisme était-elle vraiment toute dans le corps du Duce décrit
dans des termes que n’aurait pas reniés Cesare Lombroso, le
fondateur de l’école italienne de criminologie - “torse massif
sur jambes courtes et minces, délinquance manifeste au coin de l’œil
et dans la disproportion des mâchoires”?».91
physicien qui, pour dépister les traces du criminel, non
seulement mettait en branle ses facultés intellectuelles et
employait la loupe, mais aussi appliquait des procédés chimiques».89
D’où l’apparition des gants de plastiques immanquables dans les
films et séries actuels. Tout se passe d’ailleurs dans un
environnement malsain, pollué, centre des miasmes les plus
abominables : «La
ville, oui, mais précisons encore : la ville industrielle, avec son
cortège de miséreux, de déracinés, prêts à devenir des hommes
de main. Il y a toujours eu des cours des miracles, des “milieux”,
des pègres. Mais c’étaient les éléments lourds d’une société
très hiérarchisée. Ils coulaient d’eux-mêmes dans les
bas-fonds. Avec l’apparition des “affaires”, tout change. Il se
produit un brassage qui déplace les individus».90
Sur une échelle plus large encore, ce n’est pas un hasard si le
régime fasciste de Mussolini mena une guerre sans précédent contre
la mafia et les sociétés secrètes criminelles italiennes, cette
lutte relevait la valeur morale du régime despotique. Deux types de
criminalité se confrontaient dans un rapport de la modernité au
primitif : «L’aventure
du Ventennio*
était-elle vraiment réductible à une action dramatique entre le
personnage de Mussolini et son auteur, le peuple? L’explication du
fascisme était-elle vraiment toute dans le corps du Duce décrit
dans des termes que n’aurait pas reniés Cesare Lombroso, le
fondateur de l’école italienne de criminologie - “torse massif
sur jambes courtes et minces, délinquance manifeste au coin de l’œil
et dans la disproportion des mâchoires”?».91
 littérature sadique-anal, l’inconscient ou le
refoulé des criminels, comme des témoins ou des complices, sont
autant de matières
fécales dans
lesquelles le détective est contraint de mettre le nez. Et,
effectivement, ce qu’on y trouve ne sent jamais la rose. Il n’en
va pas seulement des secrets coupables que le détective doit
exhumer, mais également des tares dues à des maladies fatales :
«Un des
premiers soucis de la lutte antituberculeuse, de 1920 à 1930
environ, fut de neutraliser le “porteur de bacilles”, en
l’identifiant d’abord, puis en l’isolant pour l’empêcher de
contaminer son milieu par la suite. Depuis qu’il sait la
tuberculose contagieuse, “l’hygiéniste a laissé de côté son
détachement de savant pour prendre des allures d’enquêteur de
police : ce ne sont plus des lois naturelles que l’on s’efforce
de découvrir, mais des suspects”. Les réflexes policiers,
abandonnés après 1930, refont pourtant surface de temps à autre
dans le discours des médecins engagés dans la lutte».82
La similitude entre l’enquête médicale et l’enquête policière
n’est pas une invention du docteur House,
au nom si
bien choisi. Pour l'hygiéniste, sonder les corps concouraient à une
expérience esthétique morbide. Par contre, pour Edgar Poe, un fin
raisonnement aussi relevait d'une expérience esthétique. Expérience
comparable à la beauté d’une femme suprêmement intelligente et
immaculée mais morte de phtisie (Ligeia,
Lenore,
Annabel
Lee,
etc.). Une femme dont le corps était dépouillé de toute vie
susceptible de la corrompre, comme chez Marina Gregg. Chez Poe, il
n’y avait de chair sinon peut-être que dans l’obsession
névropathe : les dents de Bérénice,
les corps lacérés et démembrés des femmes Lespanaye, le cadavre
gonflé et tuméfié de Marie Rogêt, le spectre vaporeux de Madeline
Usher : le ver conquérant… Gordon
Pym raconte
la lente dérive dans cet océan d’où émergent tant d’écueils
de chairs pourrissantes : de la
littérature sadique-anal, l’inconscient ou le
refoulé des criminels, comme des témoins ou des complices, sont
autant de matières
fécales dans
lesquelles le détective est contraint de mettre le nez. Et,
effectivement, ce qu’on y trouve ne sent jamais la rose. Il n’en
va pas seulement des secrets coupables que le détective doit
exhumer, mais également des tares dues à des maladies fatales :
«Un des
premiers soucis de la lutte antituberculeuse, de 1920 à 1930
environ, fut de neutraliser le “porteur de bacilles”, en
l’identifiant d’abord, puis en l’isolant pour l’empêcher de
contaminer son milieu par la suite. Depuis qu’il sait la
tuberculose contagieuse, “l’hygiéniste a laissé de côté son
détachement de savant pour prendre des allures d’enquêteur de
police : ce ne sont plus des lois naturelles que l’on s’efforce
de découvrir, mais des suspects”. Les réflexes policiers,
abandonnés après 1930, refont pourtant surface de temps à autre
dans le discours des médecins engagés dans la lutte».82
La similitude entre l’enquête médicale et l’enquête policière
n’est pas une invention du docteur House,
au nom si
bien choisi. Pour l'hygiéniste, sonder les corps concouraient à une
expérience esthétique morbide. Par contre, pour Edgar Poe, un fin
raisonnement aussi relevait d'une expérience esthétique. Expérience
comparable à la beauté d’une femme suprêmement intelligente et
immaculée mais morte de phtisie (Ligeia,
Lenore,
Annabel
Lee,
etc.). Une femme dont le corps était dépouillé de toute vie
susceptible de la corrompre, comme chez Marina Gregg. Chez Poe, il
n’y avait de chair sinon peut-être que dans l’obsession
névropathe : les dents de Bérénice,
les corps lacérés et démembrés des femmes Lespanaye, le cadavre
gonflé et tuméfié de Marie Rogêt, le spectre vaporeux de Madeline
Usher : le ver conquérant… Gordon
Pym raconte
la lente dérive dans cet océan d’où émergent tant d’écueils
de chairs pourrissantes : de la  gangrène qui ronge la jambe
d’Auguste aux créatures polaires velues et noirâtres en passant
par le cadavre ballotté au gré des flots sur le navire dérivant
porteur de la peste. Ces irruptions de chairs putréfiées affleurent
de cet océan incommensurable, faisant dévier tout raisonnement
comme expérience esthétique. C’est le seuil des hallucinations
qui fait dévier les déductions de Dupin et de Legrand en
fascinations morbides chez Usher et Ægus; fascinations d’un poète
qui aurait enfin le contrôle parfait de son refoulé. Telles
agissaient également ces idéologies suppurées par la fonction
débridée (et déviée) de l’Idéologique depuis le milieu du XIXe
siècle, la fonction du roman policier consistant à dresser une
métaphore métaphysique de la vérité et de l’erreur qui
émergeaient de ce que de Maistre appelait si justement la
raison raisonnante.
Nous sommes bien là à l’origine de ce que Nathalie Sarraute
appellera l’ère
du soupçon.
En ce sens, le roman policier exerçait une fonction cathartique
de la culpabilité du meurtre de la figure du Père et de tout ce que
ce geste entraînait dans l’angoisse existentielle des Occidentaux.
gangrène qui ronge la jambe
d’Auguste aux créatures polaires velues et noirâtres en passant
par le cadavre ballotté au gré des flots sur le navire dérivant
porteur de la peste. Ces irruptions de chairs putréfiées affleurent
de cet océan incommensurable, faisant dévier tout raisonnement
comme expérience esthétique. C’est le seuil des hallucinations
qui fait dévier les déductions de Dupin et de Legrand en
fascinations morbides chez Usher et Ægus; fascinations d’un poète
qui aurait enfin le contrôle parfait de son refoulé. Telles
agissaient également ces idéologies suppurées par la fonction
débridée (et déviée) de l’Idéologique depuis le milieu du XIXe
siècle, la fonction du roman policier consistant à dresser une
métaphore métaphysique de la vérité et de l’erreur qui
émergeaient de ce que de Maistre appelait si justement la
raison raisonnante.
Nous sommes bien là à l’origine de ce que Nathalie Sarraute
appellera l’ère
du soupçon.
En ce sens, le roman policier exerçait une fonction cathartique
de la culpabilité du meurtre de la figure du Père et de tout ce que
ce geste entraînait dans l’angoisse existentielle des Occidentaux.«La passion du public pour les romans noirs et les romans policiers était-elle une manière de compenser la docilité grandissante de ses mœurs?»,83 Moins une compensation qu’une thérapie. «Le caractère le plus étonnant de notre situation culturelle-morale est sans doute l’avidité insatiable de la conscience moderne de lire des histoires policières. Ces histoires, à mon sens, font partie, elles aussi,
 des
institutions morales d’aération et de ventilation d’une
civilisation condamnée à vivre avec un trop grand mélange de
normes, d’ambiguïtés et d’éthiques contraires. Le genre dans
son ensemble apparaît en rapport avec l’éthique collective comme
le médium institutionnalisé de l’aveu. Chaque histoire policière
est de nouveau une sortie pour un amoralisme expérimental. Elle met,
dans la fiction, le “bonheur dans le crime” (Barbey d’Aurevilly)
à la portée de tous. Dans les mouvements de la pensée des
histoires policières modernes, depuis Poe jusqu’à l’époque
actuelle, ceux d’une analyse du cynisme sont in
nuce
faits d’avance. Car les bonnes histoires policières travaillent
sans exception à la relativisation du crime individuel. Si le
détective est le représentant de l’Aufklärung,
le criminel serait celui de l’immoralité, la victime celui de la
morale. Cependant ce rapport est régulièrement ébranlé quand
l’investigation sur la culpabilité parvient là où les victimes -
qui du point de vue de la dramaturgie sont d’abord victimes
“innocentes” - perdent elles-mêmes leur innocence, où elles
sont plongées dans la pénombre et ne sont séparées du criminel
portant la main sur elles, que par une ligne juridique extrêmement
fine; celle-ci sépare les immoralismes cyniques et impunis et les
délits proprement dits. Dans le cas extrême c’est le criminel qui
- quasiment comme un penseur de l’Aufklärung
que l’on provoque - ne fait qu’exécuter sur sa victime
l’amoralité propre de celle-ci. “Ce n’est pas l’assassin qui
est coupable mais l’assassiné.” (Werfel) Ce sont les films où à
la fin le
des
institutions morales d’aération et de ventilation d’une
civilisation condamnée à vivre avec un trop grand mélange de
normes, d’ambiguïtés et d’éthiques contraires. Le genre dans
son ensemble apparaît en rapport avec l’éthique collective comme
le médium institutionnalisé de l’aveu. Chaque histoire policière
est de nouveau une sortie pour un amoralisme expérimental. Elle met,
dans la fiction, le “bonheur dans le crime” (Barbey d’Aurevilly)
à la portée de tous. Dans les mouvements de la pensée des
histoires policières modernes, depuis Poe jusqu’à l’époque
actuelle, ceux d’une analyse du cynisme sont in
nuce
faits d’avance. Car les bonnes histoires policières travaillent
sans exception à la relativisation du crime individuel. Si le
détective est le représentant de l’Aufklärung,
le criminel serait celui de l’immoralité, la victime celui de la
morale. Cependant ce rapport est régulièrement ébranlé quand
l’investigation sur la culpabilité parvient là où les victimes -
qui du point de vue de la dramaturgie sont d’abord victimes
“innocentes” - perdent elles-mêmes leur innocence, où elles
sont plongées dans la pénombre et ne sont séparées du criminel
portant la main sur elles, que par une ligne juridique extrêmement
fine; celle-ci sépare les immoralismes cyniques et impunis et les
délits proprement dits. Dans le cas extrême c’est le criminel qui
- quasiment comme un penseur de l’Aufklärung
que l’on provoque - ne fait qu’exécuter sur sa victime
l’amoralité propre de celle-ci. “Ce n’est pas l’assassin qui
est coupable mais l’assassiné.” (Werfel) Ce sont les films où à
la fin le  commissaire descend la rue tout pensif, l’air d’être
désolé d’avoir résolu aussi cette énig-me».84
Une finale à la Quai des orfèvres de
Stee-
commissaire descend la rue tout pensif, l’air d’être
désolé d’avoir résolu aussi cette énig-me».84
Une finale à la Quai des orfèvres de
Stee-man. Comme l’énonce la règle # 3 de Van Dine, il est préférable de fermer «les yeux, au lieu de les ouvrir tout grands. Fiez-vous aux yeux de l’esprit et non à ceux du corps. Faites fonctionner les petites cellules grises de votre cerveau…»,85 comme le conseille Hercule Poirot dans La mort dans les nuages. Le roman policier appartiendrait donc à l’hygiène morale propre à l’âge de l’Anus Mundi : «Qu’est-ce qui fait problème dans une histoire policière? Un meurtre? Pas nécessairement. Nous ne trouvons, en effet, que quatre meurtres dans les douze nouvelles des Aventures de Sherlock Holmes […]. En fait, nous rencontrons parfois, dans les nouvelles et dans les romans policiers, en guise de problèmes, des vols, des incendies, des chantages, des lettres anonymes, de mauvaises farces… Parfois aussi nous rencontrons des assassinats. Ceux-ci ont donc, littérairement, même fonction que des cambriolages ou des fraudes. Un assassinat a, dans Ten days’wonder d’E. Queen, même fonction qu’un larcin, un blasphème, un adultère ou un faux témoignage. Quelle fonction? La fonction d’un méfait. D’une action qui nous paraît mauvaise parce qu’elle viole les règles de la collectivité humaine où vit l’acteur. Donc d’un dérèglement social, mais d’un dérèglement que la société punit. C’est-à-dire : d’un crime. Or, les crimes provoquent normalement cette administration, chargée de garder les règlements, que nous nommons “police”…».86 C’est ainsi que l’hygiène morale finissait par découler du nécessaire refoulement du mal ou de l'ostracisation des malfaiteurs qui rendent possible la vie en collectivité.
Dans la façon de présenter les reportages sur les grands crimes et les romans policiers, l’organisation éditoriale des journaux confirmait cette demande hygiéniste qui, exigeait un surplus de moralité. «Tenues à plus de précautions, la Presse et la Patrie compensaient les nouvelles et les images scabreuses par les annonces et les photos religieuses. […] Mgr Bruchési condamna une fois de plus l’exploitation des curiosités morbides, la publication des photos et récits “de drames sanglants et démoralisateurs”. En pareil cas, la Presse et la Patrie s’amendaient pendant quelque
 temps, puis recommençaient peu à
peu».87
Récits et photos revenaient car elles étaient indispensables à
l'action du refoulement : associer la valeur de l'expiation à
l'énormité de la transgression. L’hygiène morale, comme nous le
verrons, ne peut être efficace que si le désordre refoulé n’est
pas ramené d’une manière ou d’une autre à la conscience.
Bertillon lui-même, le grand criminaliste français imbu du
positivisme et des dossiers classifiés, ne comprenait pas davantage
l’opération médiatique des crimes : «Le
sang du policier français ne fit qu’un tour lorsqu’il aperçut
dans la presse parisienne des caricatures qui le dépeignaient en
homme toujours à l’affût des traces de mains; une colère froide
le saisit en découvrant dans le journal L’Assiette au beurre
un dessin qui le montrait observant, une grosse loupe à la main, les
marques de doigts sales laissées dans une quelconque sinistre
toilette».88
Il faut le rappeler. Le crime est la dé-chié,
non seulement du criminel mais de la société entière :
bijoux, maison ravagée par un incendie, vol de banque, cadavres peu
importe, le délinquant semble convoiter les rapines de la société
bourgeoise : extraction de minerais précieux; propriétés
ostentatoires; voûte des richesses accumulées et extorquées;
victimes des prédations coloniales. Dans les romans christiens,
l'énigme commence souvent dans une colonie britannique, en Afrique
ou de préférence en Inde. Il arrive que la victime ait elle-même
commis un forfait dans les possessions coloniales de l'Empire. Toutes
ces richesses sont en fait des produits abjects et le détective sait
qu'ils contaminent pathologiquement les esprits : «Ce
détective se distinguait d’ailleurs de Lecoq par un détail
significatif : ses doigts et ses mains étaient couverts de brûlures
occasionnées par divers acides. Sherlock Holmes était un chimiste
et un
temps, puis recommençaient peu à
peu».87
Récits et photos revenaient car elles étaient indispensables à
l'action du refoulement : associer la valeur de l'expiation à
l'énormité de la transgression. L’hygiène morale, comme nous le
verrons, ne peut être efficace que si le désordre refoulé n’est
pas ramené d’une manière ou d’une autre à la conscience.
Bertillon lui-même, le grand criminaliste français imbu du
positivisme et des dossiers classifiés, ne comprenait pas davantage
l’opération médiatique des crimes : «Le
sang du policier français ne fit qu’un tour lorsqu’il aperçut
dans la presse parisienne des caricatures qui le dépeignaient en
homme toujours à l’affût des traces de mains; une colère froide
le saisit en découvrant dans le journal L’Assiette au beurre
un dessin qui le montrait observant, une grosse loupe à la main, les
marques de doigts sales laissées dans une quelconque sinistre
toilette».88
Il faut le rappeler. Le crime est la dé-chié,
non seulement du criminel mais de la société entière :
bijoux, maison ravagée par un incendie, vol de banque, cadavres peu
importe, le délinquant semble convoiter les rapines de la société
bourgeoise : extraction de minerais précieux; propriétés
ostentatoires; voûte des richesses accumulées et extorquées;
victimes des prédations coloniales. Dans les romans christiens,
l'énigme commence souvent dans une colonie britannique, en Afrique
ou de préférence en Inde. Il arrive que la victime ait elle-même
commis un forfait dans les possessions coloniales de l'Empire. Toutes
ces richesses sont en fait des produits abjects et le détective sait
qu'ils contaminent pathologiquement les esprits : «Ce
détective se distinguait d’ailleurs de Lecoq par un détail
significatif : ses doigts et ses mains étaient couverts de brûlures
occasionnées par divers acides. Sherlock Holmes était un chimiste
et un  physicien qui, pour dépister les traces du criminel, non
seulement mettait en branle ses facultés intellectuelles et
employait la loupe, mais aussi appliquait des procédés chimiques».89
D’où l’apparition des gants de plastiques immanquables dans les
films et séries actuels. Tout se passe d’ailleurs dans un
environnement malsain, pollué, centre des miasmes les plus
abominables : «La
ville, oui, mais précisons encore : la ville industrielle, avec son
cortège de miséreux, de déracinés, prêts à devenir des hommes
de main. Il y a toujours eu des cours des miracles, des “milieux”,
des pègres. Mais c’étaient les éléments lourds d’une société
très hiérarchisée. Ils coulaient d’eux-mêmes dans les
bas-fonds. Avec l’apparition des “affaires”, tout change. Il se
produit un brassage qui déplace les individus».90
Sur une échelle plus large encore, ce n’est pas un hasard si le
régime fasciste de Mussolini mena une guerre sans précédent contre
la mafia et les sociétés secrètes criminelles italiennes, cette
lutte relevait la valeur morale du régime despotique. Deux types de
criminalité se confrontaient dans un rapport de la modernité au
primitif : «L’aventure
du Ventennio*
était-elle vraiment réductible à une action dramatique entre le
personnage de Mussolini et son auteur, le peuple? L’explication du
fascisme était-elle vraiment toute dans le corps du Duce décrit
dans des termes que n’aurait pas reniés Cesare Lombroso, le
fondateur de l’école italienne de criminologie - “torse massif
sur jambes courtes et minces, délinquance manifeste au coin de l’œil
et dans la disproportion des mâchoires”?».91
physicien qui, pour dépister les traces du criminel, non
seulement mettait en branle ses facultés intellectuelles et
employait la loupe, mais aussi appliquait des procédés chimiques».89
D’où l’apparition des gants de plastiques immanquables dans les
films et séries actuels. Tout se passe d’ailleurs dans un
environnement malsain, pollué, centre des miasmes les plus
abominables : «La
ville, oui, mais précisons encore : la ville industrielle, avec son
cortège de miséreux, de déracinés, prêts à devenir des hommes
de main. Il y a toujours eu des cours des miracles, des “milieux”,
des pègres. Mais c’étaient les éléments lourds d’une société
très hiérarchisée. Ils coulaient d’eux-mêmes dans les
bas-fonds. Avec l’apparition des “affaires”, tout change. Il se
produit un brassage qui déplace les individus».90
Sur une échelle plus large encore, ce n’est pas un hasard si le
régime fasciste de Mussolini mena une guerre sans précédent contre
la mafia et les sociétés secrètes criminelles italiennes, cette
lutte relevait la valeur morale du régime despotique. Deux types de
criminalité se confrontaient dans un rapport de la modernité au
primitif : «L’aventure
du Ventennio*
était-elle vraiment réductible à une action dramatique entre le
personnage de Mussolini et son auteur, le peuple? L’explication du
fascisme était-elle vraiment toute dans le corps du Duce décrit
dans des termes que n’aurait pas reniés Cesare Lombroso, le
fondateur de l’école italienne de criminologie - “torse massif
sur jambes courtes et minces, délinquance manifeste au coin de l’œil
et dans la disproportion des mâchoires”?».91
En
définitive, il est permis de penser que la fonction hygiéniste ou
thérapeutique du roman policier consistait à exhumer le refoulé
afin de mieux le soumettre à la maîtrise de la ratio.
Triomphe dérisoire de la conscience sur l'inconscient. Comme le dit
Thomas Narcejac, «un
roman policier est  un récit où le raison-
un récit où le raison-
nement crée la peur qu’il est chargé d’apai-
ser»,92 raison-
nement qui devait apparaî-
tre simple comme tout afin qu'il puisse être partagé par tous les lecteurs. On s’en servait, comme la famille tsariste en captivité à Tsarskoïe-Selo en 1917, afin d'apaiser les angoisses du lendemain et se conforter dans l’idée qu'on pourra les dominer : «Le soir, Alix brodait pendant que Nicky faisait la lecture - Le Comte de Monte-Cristo ou Une étude en rouge de Conan Doyle».93 Ainsi la vieille famille impériale et autocrate achevait-elle ses soirées dans un confort rassurant petit-bourgeois. Il en fut encore de même du royaliste Charles Maurras, emprisonné à la Libération : «En 1944, à soixante-dix-sept ans, quand Maurras fut mis en prison, il s’attela à écrire…, un “conte moral, magique et policier” (Le Mont de Saturne)…».94
 un récit où le raison-
un récit où le raison-nement crée la peur qu’il est chargé d’apai-
ser»,92 raison-
nement qui devait apparaî-
tre simple comme tout afin qu'il puisse être partagé par tous les lecteurs. On s’en servait, comme la famille tsariste en captivité à Tsarskoïe-Selo en 1917, afin d'apaiser les angoisses du lendemain et se conforter dans l’idée qu'on pourra les dominer : «Le soir, Alix brodait pendant que Nicky faisait la lecture - Le Comte de Monte-Cristo ou Une étude en rouge de Conan Doyle».93 Ainsi la vieille famille impériale et autocrate achevait-elle ses soirées dans un confort rassurant petit-bourgeois. Il en fut encore de même du royaliste Charles Maurras, emprisonné à la Libération : «En 1944, à soixante-dix-sept ans, quand Maurras fut mis en prison, il s’attela à écrire…, un “conte moral, magique et policier” (Le Mont de Saturne)…».94
LE MYSTÈRE DÉPECÉ
Sophie de Mijolla-Mellor rappelle, dans son étude sur Agatha Christie, que «le mystère constitue la chair que va dépecer la méthode, et Poirot doit, lui aussi, pour un temps, y croire afin de pouvoir le réduire et y prendre plaisir».95 Parce que le crime est la sublimation du meurtre de la figure du Père, le sadisme du détective ne peut s’exercer que par le dépeçage du mystère. De même, si le meurtre suscite nombre d’hallucinations macabres, la déduction est une opération sadique exercée par sublimation sur les témoins de tout ce qui entoure le crime : ses origines, les intentions,
 |
| George Wilhelm Pabst. Lulu, 1929. |
lations, les errances, les détourne-
ments, etc. Ce n’est pas
le cadavre qui intéresse tant la libido
sciendi mais
le myste, voire le numineux qui fait du roman policier, selon
Siegfried Kracauer, une expérience métaphysique. Si le XIXe siècle
put se vanter d’avoir supprimé Dieu, il n’était pas encore
parvenu à supprimer la mort. La
mort et son mystère, pour
reprendre un titre de Camille Flammarion, avait pris sur elle le
questionnement qui jadis concernait l’existence de la divinité :
«La mort
rôde, on la porte en soi, lancinante, comme elle nous attend au gré
d’une rencontre, ou au coin de la rue. Toute rencontre, fût-elle
amoureuse (surtout
amoureuse), est porteuse de mort, et le thème de la femme fatale,
autre héritage du romantisme, s’alourdit d’une dureté, qui ne
masque plus le poids d’une sexualité dévorante.
Lulu que
Wedekind fait naître alors, sème sur son passage la mort dont elle
est elle-même porteuse, et qu’elle recevra misérablement de Jack
l’Éventreur. Mort rôdeuse des nouveaux univers urbains? On a fait
remarquer comment le nouveau paladin fin de siècle, écho -
dirons-nous dérisoire?, en tout cas inattendu - des anciens
chevaliers de la Table ronde, devient le héros du roman policier.
Parsifal se métamorphose en Sherlock Holmes, il traque la mort au
coup 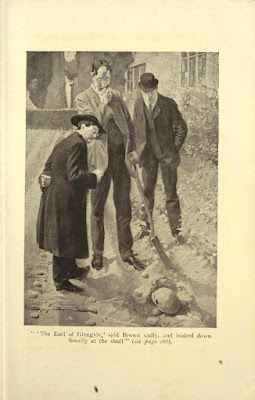 par coup, et, à défaut d’en percer le mystère global, il en
décrypte les énigmes une à une sous les traits du chevalier Dupin
d’Edgar Poe, puis du Sherlock Holmes de Conan Doyle, en attendant
que Chesterton propose le personnage de Father Brown dans les années
1900, préludant à la lignée des nouveaux héros…, quitte bien
sûr, à ce que ce héros positif secrète son double en contrepoint,
seigneur de la mort et du crime, de Fantômas, insaisissable et
invincible, au mystérieux docteur Cornélius et à ses acolytes,
personnages de l’ombre, dont Gustave Le Rouge nous fait suivre la
trace. C’est dans cette littérature populaire des
romans-feuilletons 1900 qu’ils donnent dans le policier ou le
fantastique (et souvent dans les deux) que l’on peut mesure à quel
point se diffuse un certain air du temps, et combien ce goût de mort
n’est point le privilège exclusif d’un petit cénacle
d’initiés».96
Si Condorcet annonçait, dans son Esquisse
d’un tableau des progrès de l’esprit humain (1794),
que la
mort serait un jour vaincue par le progrès, ce n’était pas encore
chose faite à la fin du XIXe siècle. Et la mort rôdait sous
différentes formes à cette époque. Si les épidémies
s’étiolaient, si les guerres mêmes semblaient de plus en plus
rares, la mort envahissait la quotidienneté, d’où l’importance
que le crime prenait dans les représentations sociales à partir
d’événements comme les meurtres de Jack l’Éventreur ou, après
la Grande Guerre, par le petit fourneau du sieur de Gambais, Landru.
Prophète génial qui aurait pu constater, en 1900, l’affirmation
qu’avança plus tard Wilhelm Reich, que «le
conte d’épouvante raconté dans la tendre enfance, les romans
policiers qui interviennent plus tard, l’atmosphère de mystère
qui règne à l’intérieur des églises, ne sont que les étapes
préparatoires de la mise en branle de l’appareil biopsychique par
les cérémonies militaires et patriotiques».97
Parce que la mort demeurait invaincue et qu’elle terrorisait autant
que jadis, la lecture d’un roman policier servait d’ersatz à
l’angoisse qu’elle suscitait chez le commun des
petits-bourgeois : «Cette
crainte devant l’inconnu, cet émerveillement produit par la
résolution de l’énigme, voilà les traits fondamentaux du roman
policier».98
par coup, et, à défaut d’en percer le mystère global, il en
décrypte les énigmes une à une sous les traits du chevalier Dupin
d’Edgar Poe, puis du Sherlock Holmes de Conan Doyle, en attendant
que Chesterton propose le personnage de Father Brown dans les années
1900, préludant à la lignée des nouveaux héros…, quitte bien
sûr, à ce que ce héros positif secrète son double en contrepoint,
seigneur de la mort et du crime, de Fantômas, insaisissable et
invincible, au mystérieux docteur Cornélius et à ses acolytes,
personnages de l’ombre, dont Gustave Le Rouge nous fait suivre la
trace. C’est dans cette littérature populaire des
romans-feuilletons 1900 qu’ils donnent dans le policier ou le
fantastique (et souvent dans les deux) que l’on peut mesure à quel
point se diffuse un certain air du temps, et combien ce goût de mort
n’est point le privilège exclusif d’un petit cénacle
d’initiés».96
Si Condorcet annonçait, dans son Esquisse
d’un tableau des progrès de l’esprit humain (1794),
que la
mort serait un jour vaincue par le progrès, ce n’était pas encore
chose faite à la fin du XIXe siècle. Et la mort rôdait sous
différentes formes à cette époque. Si les épidémies
s’étiolaient, si les guerres mêmes semblaient de plus en plus
rares, la mort envahissait la quotidienneté, d’où l’importance
que le crime prenait dans les représentations sociales à partir
d’événements comme les meurtres de Jack l’Éventreur ou, après
la Grande Guerre, par le petit fourneau du sieur de Gambais, Landru.
Prophète génial qui aurait pu constater, en 1900, l’affirmation
qu’avança plus tard Wilhelm Reich, que «le
conte d’épouvante raconté dans la tendre enfance, les romans
policiers qui interviennent plus tard, l’atmosphère de mystère
qui règne à l’intérieur des églises, ne sont que les étapes
préparatoires de la mise en branle de l’appareil biopsychique par
les cérémonies militaires et patriotiques».97
Parce que la mort demeurait invaincue et qu’elle terrorisait autant
que jadis, la lecture d’un roman policier servait d’ersatz à
l’angoisse qu’elle suscitait chez le commun des
petits-bourgeois : «Cette
crainte devant l’inconnu, cet émerveillement produit par la
résolution de l’énigme, voilà les traits fondamentaux du roman
policier».98
Mais la mort n’est qu’un mystère parmi d’autres. Le sexe posait également un mystère auquel la science prétendait s’emparer. La vie en elle-même se dépouillait de ses mystères. Les espaces infinis que révélaient l’astronomie et la toute nouvelle branche, l’astrophysique, semaient des questions problématiques non dénuées de certaines angoisses. Sommes-nous seuls dans l’univers? Les Occidentaux n’ont pas entendu la création des soucoupes volantes pour en poser l’hypothèse, voire la certitude. L’astronome Schiaparelli, observant la planète Mars, y affirmait avoir découvert que la surface de la planète était traversée de canaux chargés d’acheminer l’eau des pôles pour abreuver les martiens qui les avaient creusés. Bref, «le mystère est comme une coquille enfermant un noyau : le problème. […] Dès que l’esprit a su découper dans la masse du mystère deux éléments qui s’ajustent et amorcent un lien causal, dès qu’il a isolé une relation, le mystère se change en problème».99 Ce transit perdait de sa sacralité primitive pour ne plus devenir qu’une énigme mécaniciste, comme on l’a vue plus haut, que la raison et la science pouvaient enfin élucider. Le roman policier rappelait que la raison est plus forte que l’intuition et les superstitions. «Le roman policier est la maquette très perfectionnée de l’enquête scientifique».100 Boileau-Narcejac s’expliquent : «Par essence, le roman policier est un problème. Il est faux de penser - nous l’avons pourtant cru - que le roman policier a évolué, de ses origines à nos jours, comme si le roman problème avait engendré
le roman policier psychologique, puis le suspense, puis le roman
criminel, etc. En réalité, le roman policier contient en germe, à
dose homéopathique, donc inaperçue, tous les genres qui semblent
sortir de lui. Dans le
double crime de la rue Morgue, c’est
l’investigation scientifique qui vient au premier plan; mais les
dissertations de Dupin sur l’analyse des caractères annoncent les
subtilités psychologiques de Poirot; l’attente angoissée de la
solution (elle ne dure pas longtemps mais enfin elle existe,
inévitablement) est à la racine du suspense; la brutalité avec
laquelle les deux crimes ont été commis, la mutilation des corps,
le sang répandu, en un mot l’horreur de la scène nous rappellent
à temps que la violence est un élément constitutif du roman
policier. Inversement, un roman de Chandler, s’il insiste sur la
violence, fait fatalement sa part au raisonnement et le suspense est
là, à son tour. Veut-on faire appel à la psychologie la plus
alambiquée (Chesterton), on ne saurait se passer de la terreur et du
suspense. Désire-t-on, au contraire, à la manière de W. Irish, ne
jouer que du suspense, le problème reste posé à l’arrière-plan
du récit».101
Dans un cas comme dans l’autre, la problématique reposait sur
plusieurs variables et une seule méthode, souvent, ne suffit pas à
percer le mystère et révéler la solution. Dans les faits, les
solutions n'étaient jamais aussi satisfaisantes autant que le
laissait penser le roman policier : «comment,
se demande Thorwald,
souscrire à l’idée, aussi optimiste que fausse, que la
criminologie l’emportera sur la criminalité, qu’aucun crime ne
paie et que tout criminel sera châtié?».102
problème avait engendré
le roman policier psychologique, puis le suspense, puis le roman
criminel, etc. En réalité, le roman policier contient en germe, à
dose homéopathique, donc inaperçue, tous les genres qui semblent
sortir de lui. Dans le
double crime de la rue Morgue, c’est
l’investigation scientifique qui vient au premier plan; mais les
dissertations de Dupin sur l’analyse des caractères annoncent les
subtilités psychologiques de Poirot; l’attente angoissée de la
solution (elle ne dure pas longtemps mais enfin elle existe,
inévitablement) est à la racine du suspense; la brutalité avec
laquelle les deux crimes ont été commis, la mutilation des corps,
le sang répandu, en un mot l’horreur de la scène nous rappellent
à temps que la violence est un élément constitutif du roman
policier. Inversement, un roman de Chandler, s’il insiste sur la
violence, fait fatalement sa part au raisonnement et le suspense est
là, à son tour. Veut-on faire appel à la psychologie la plus
alambiquée (Chesterton), on ne saurait se passer de la terreur et du
suspense. Désire-t-on, au contraire, à la manière de W. Irish, ne
jouer que du suspense, le problème reste posé à l’arrière-plan
du récit».101
Dans un cas comme dans l’autre, la problématique reposait sur
plusieurs variables et une seule méthode, souvent, ne suffit pas à
percer le mystère et révéler la solution. Dans les faits, les
solutions n'étaient jamais aussi satisfaisantes autant que le
laissait penser le roman policier : «comment,
se demande Thorwald,
souscrire à l’idée, aussi optimiste que fausse, que la
criminologie l’emportera sur la criminalité, qu’aucun crime ne
paie et que tout criminel sera châtié?».102
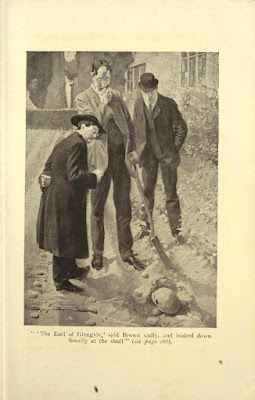 par coup, et, à défaut d’en percer le mystère global, il en
décrypte les énigmes une à une sous les traits du chevalier Dupin
d’Edgar Poe, puis du Sherlock Holmes de Conan Doyle, en attendant
que Chesterton propose le personnage de Father Brown dans les années
1900, préludant à la lignée des nouveaux héros…, quitte bien
sûr, à ce que ce héros positif secrète son double en contrepoint,
seigneur de la mort et du crime, de Fantômas, insaisissable et
invincible, au mystérieux docteur Cornélius et à ses acolytes,
personnages de l’ombre, dont Gustave Le Rouge nous fait suivre la
trace. C’est dans cette littérature populaire des
romans-feuilletons 1900 qu’ils donnent dans le policier ou le
fantastique (et souvent dans les deux) que l’on peut mesure à quel
point se diffuse un certain air du temps, et combien ce goût de mort
n’est point le privilège exclusif d’un petit cénacle
d’initiés».96
Si Condorcet annonçait, dans son Esquisse
d’un tableau des progrès de l’esprit humain (1794),
que la
mort serait un jour vaincue par le progrès, ce n’était pas encore
chose faite à la fin du XIXe siècle. Et la mort rôdait sous
différentes formes à cette époque. Si les épidémies
s’étiolaient, si les guerres mêmes semblaient de plus en plus
rares, la mort envahissait la quotidienneté, d’où l’importance
que le crime prenait dans les représentations sociales à partir
d’événements comme les meurtres de Jack l’Éventreur ou, après
la Grande Guerre, par le petit fourneau du sieur de Gambais, Landru.
Prophète génial qui aurait pu constater, en 1900, l’affirmation
qu’avança plus tard Wilhelm Reich, que «le
conte d’épouvante raconté dans la tendre enfance, les romans
policiers qui interviennent plus tard, l’atmosphère de mystère
qui règne à l’intérieur des églises, ne sont que les étapes
préparatoires de la mise en branle de l’appareil biopsychique par
les cérémonies militaires et patriotiques».97
Parce que la mort demeurait invaincue et qu’elle terrorisait autant
que jadis, la lecture d’un roman policier servait d’ersatz à
l’angoisse qu’elle suscitait chez le commun des
petits-bourgeois : «Cette
crainte devant l’inconnu, cet émerveillement produit par la
résolution de l’énigme, voilà les traits fondamentaux du roman
policier».98
par coup, et, à défaut d’en percer le mystère global, il en
décrypte les énigmes une à une sous les traits du chevalier Dupin
d’Edgar Poe, puis du Sherlock Holmes de Conan Doyle, en attendant
que Chesterton propose le personnage de Father Brown dans les années
1900, préludant à la lignée des nouveaux héros…, quitte bien
sûr, à ce que ce héros positif secrète son double en contrepoint,
seigneur de la mort et du crime, de Fantômas, insaisissable et
invincible, au mystérieux docteur Cornélius et à ses acolytes,
personnages de l’ombre, dont Gustave Le Rouge nous fait suivre la
trace. C’est dans cette littérature populaire des
romans-feuilletons 1900 qu’ils donnent dans le policier ou le
fantastique (et souvent dans les deux) que l’on peut mesure à quel
point se diffuse un certain air du temps, et combien ce goût de mort
n’est point le privilège exclusif d’un petit cénacle
d’initiés».96
Si Condorcet annonçait, dans son Esquisse
d’un tableau des progrès de l’esprit humain (1794),
que la
mort serait un jour vaincue par le progrès, ce n’était pas encore
chose faite à la fin du XIXe siècle. Et la mort rôdait sous
différentes formes à cette époque. Si les épidémies
s’étiolaient, si les guerres mêmes semblaient de plus en plus
rares, la mort envahissait la quotidienneté, d’où l’importance
que le crime prenait dans les représentations sociales à partir
d’événements comme les meurtres de Jack l’Éventreur ou, après
la Grande Guerre, par le petit fourneau du sieur de Gambais, Landru.
Prophète génial qui aurait pu constater, en 1900, l’affirmation
qu’avança plus tard Wilhelm Reich, que «le
conte d’épouvante raconté dans la tendre enfance, les romans
policiers qui interviennent plus tard, l’atmosphère de mystère
qui règne à l’intérieur des églises, ne sont que les étapes
préparatoires de la mise en branle de l’appareil biopsychique par
les cérémonies militaires et patriotiques».97
Parce que la mort demeurait invaincue et qu’elle terrorisait autant
que jadis, la lecture d’un roman policier servait d’ersatz à
l’angoisse qu’elle suscitait chez le commun des
petits-bourgeois : «Cette
crainte devant l’inconnu, cet émerveillement produit par la
résolution de l’énigme, voilà les traits fondamentaux du roman
policier».98Mais la mort n’est qu’un mystère parmi d’autres. Le sexe posait également un mystère auquel la science prétendait s’emparer. La vie en elle-même se dépouillait de ses mystères. Les espaces infinis que révélaient l’astronomie et la toute nouvelle branche, l’astrophysique, semaient des questions problématiques non dénuées de certaines angoisses. Sommes-nous seuls dans l’univers? Les Occidentaux n’ont pas entendu la création des soucoupes volantes pour en poser l’hypothèse, voire la certitude. L’astronome Schiaparelli, observant la planète Mars, y affirmait avoir découvert que la surface de la planète était traversée de canaux chargés d’acheminer l’eau des pôles pour abreuver les martiens qui les avaient creusés. Bref, «le mystère est comme une coquille enfermant un noyau : le problème. […] Dès que l’esprit a su découper dans la masse du mystère deux éléments qui s’ajustent et amorcent un lien causal, dès qu’il a isolé une relation, le mystère se change en problème».99 Ce transit perdait de sa sacralité primitive pour ne plus devenir qu’une énigme mécaniciste, comme on l’a vue plus haut, que la raison et la science pouvaient enfin élucider. Le roman policier rappelait que la raison est plus forte que l’intuition et les superstitions. «Le roman policier est la maquette très perfectionnée de l’enquête scientifique».100 Boileau-Narcejac s’expliquent : «Par essence, le roman policier est un problème. Il est faux de penser - nous l’avons pourtant cru - que le roman policier a évolué, de ses origines à nos jours, comme si le roman
 problème avait engendré
le roman policier psychologique, puis le suspense, puis le roman
criminel, etc. En réalité, le roman policier contient en germe, à
dose homéopathique, donc inaperçue, tous les genres qui semblent
sortir de lui. Dans le
double crime de la rue Morgue, c’est
l’investigation scientifique qui vient au premier plan; mais les
dissertations de Dupin sur l’analyse des caractères annoncent les
subtilités psychologiques de Poirot; l’attente angoissée de la
solution (elle ne dure pas longtemps mais enfin elle existe,
inévitablement) est à la racine du suspense; la brutalité avec
laquelle les deux crimes ont été commis, la mutilation des corps,
le sang répandu, en un mot l’horreur de la scène nous rappellent
à temps que la violence est un élément constitutif du roman
policier. Inversement, un roman de Chandler, s’il insiste sur la
violence, fait fatalement sa part au raisonnement et le suspense est
là, à son tour. Veut-on faire appel à la psychologie la plus
alambiquée (Chesterton), on ne saurait se passer de la terreur et du
suspense. Désire-t-on, au contraire, à la manière de W. Irish, ne
jouer que du suspense, le problème reste posé à l’arrière-plan
du récit».101
Dans un cas comme dans l’autre, la problématique reposait sur
plusieurs variables et une seule méthode, souvent, ne suffit pas à
percer le mystère et révéler la solution. Dans les faits, les
solutions n'étaient jamais aussi satisfaisantes autant que le
laissait penser le roman policier : «comment,
se demande Thorwald,
souscrire à l’idée, aussi optimiste que fausse, que la
criminologie l’emportera sur la criminalité, qu’aucun crime ne
paie et que tout criminel sera châtié?».102
problème avait engendré
le roman policier psychologique, puis le suspense, puis le roman
criminel, etc. En réalité, le roman policier contient en germe, à
dose homéopathique, donc inaperçue, tous les genres qui semblent
sortir de lui. Dans le
double crime de la rue Morgue, c’est
l’investigation scientifique qui vient au premier plan; mais les
dissertations de Dupin sur l’analyse des caractères annoncent les
subtilités psychologiques de Poirot; l’attente angoissée de la
solution (elle ne dure pas longtemps mais enfin elle existe,
inévitablement) est à la racine du suspense; la brutalité avec
laquelle les deux crimes ont été commis, la mutilation des corps,
le sang répandu, en un mot l’horreur de la scène nous rappellent
à temps que la violence est un élément constitutif du roman
policier. Inversement, un roman de Chandler, s’il insiste sur la
violence, fait fatalement sa part au raisonnement et le suspense est
là, à son tour. Veut-on faire appel à la psychologie la plus
alambiquée (Chesterton), on ne saurait se passer de la terreur et du
suspense. Désire-t-on, au contraire, à la manière de W. Irish, ne
jouer que du suspense, le problème reste posé à l’arrière-plan
du récit».101
Dans un cas comme dans l’autre, la problématique reposait sur
plusieurs variables et une seule méthode, souvent, ne suffit pas à
percer le mystère et révéler la solution. Dans les faits, les
solutions n'étaient jamais aussi satisfaisantes autant que le
laissait penser le roman policier : «comment,
se demande Thorwald,
souscrire à l’idée, aussi optimiste que fausse, que la
criminologie l’emportera sur la criminalité, qu’aucun crime ne
paie et que tout criminel sera châtié?».102
Devant
les limites de la criminologie, nous nous apercevons à quel point
les romans policiers jetaient de la poudre aux yeux, comment ils
n'étaient qu’un usage de la raison en vue de mystifier les
lecteurs. Edgar Poe le reconnaissait dans la Genèse
d’un poème :
«Pour
moi, la première de toutes les considérations, c’est celle d’un
effet à produire. Ayant toujours en vue l’originalité (car il est
traître envers lui-même, celui qui risque de se passer d’un moyen
d’intérêt aussi évident et aussi facile), je me dis avant tout :
Parmi les innombrables effets ou impressions que le cœur,
l’intelligence ou, pour parler plus généralement, l’âme est
susceptible de recevoir, quel est l’unique effet que je dois
choisir dans le cas présent?».103
Et il en allait de même autant de ses nouvelles que de sa poésie.
Parce que «le
domaine de l’imaginaire, qui est celui du roman, est illimité.
Mais le roman policier, parce qu’il se propose d’aller de
l’imaginaire au rationnel par le moyen de la logique, s’impose à
lui-même des limites qu’il ne peut franchir».104
Voilà pourquoi la mystification finit par jaillir d’une
manipulation savante de la poétique du récit : «En
un mot, la méthode du chevalier Dupin est hypothético-déductive,
comme on dit parfois. Elle va des faits à une théorie provisoire
qui lui permet de revenir  aux faits pour voir si elle les explique
tous. S’il en reste qui soient encore inexpli-
aux faits pour voir si elle les explique
tous. S’il en reste qui soient encore inexpli-
qués, elle subit une refonte et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle s’ajuste exactement au donné. Alors l’enquête est close et le coupable démasqué. Notons que cette méthode, qui est celle du détective, c’est-à-dire d’un personnage créé après coup, lorsque l’auteur est en possession de tous les éléments de son récit, suit forcément la marche inverse de celle du romancier composant son histoire. Elle vérifie, en quelque sorte, l’ingéniosité de l’intrigue».105 Cette mystification par la méthode remplaçait la vieille formule magique de l’univers paysan que la modernité transformait en énigme. Le mystère en sortait sans doute spirituellement appauvri, mais renforcé par son habileté technique, les effets se substituant à l’efficacité réelle de la méthode. Le roman policier retrouvait ainsi sa nature première, celle d’être un roman, une fiction, un essai dramatique : «Un crime nous donne un adversaire qui joue sa vie, ce qui fournit le meilleur sujet d’un traitement dramatique»,106 rappelle Austin Freeman. «Tel est bien l’Art poétique de Freeman : vérité, clarté. Et c’est bien pourquoi il place si haut le roman policier, œuvre de raison qui se donne, comme matière première, le mystère, toujours par quelque côté “monstrueux”, pour l’élucider, c’est-à-dire le pénétrer de lumière et le ranger finalement sous la loi de l’intelligence. Le non-figuratif, c’est le refus de l’ordre, de la logique, de la pensée claire, c’est le crime contre l’esprit, c’est quelque chose de vaguement démoniaque, parce que volontairement négatif. […] En réalité, Freeman n’ose le comprendre; l’art moderne c’est le Mal! Et si Freeman se fait le champion laborieux du roman policier, c’est parce que cette forme de littérature est le parfait antidote de ce poison qu’est le culte de l’informe! Il ne faut pas sous-estimer ce qu’il y a de militant dans l’attitude de Freeman! N’oublions pas qu’il a l’impression d’amener le genre policier à son point de perfection».107 Et nous passons à la source du mystère.
 aux faits pour voir si elle les explique
tous. S’il en reste qui soient encore inexpli-
aux faits pour voir si elle les explique
tous. S’il en reste qui soient encore inexpli-qués, elle subit une refonte et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle s’ajuste exactement au donné. Alors l’enquête est close et le coupable démasqué. Notons que cette méthode, qui est celle du détective, c’est-à-dire d’un personnage créé après coup, lorsque l’auteur est en possession de tous les éléments de son récit, suit forcément la marche inverse de celle du romancier composant son histoire. Elle vérifie, en quelque sorte, l’ingéniosité de l’intrigue».105 Cette mystification par la méthode remplaçait la vieille formule magique de l’univers paysan que la modernité transformait en énigme. Le mystère en sortait sans doute spirituellement appauvri, mais renforcé par son habileté technique, les effets se substituant à l’efficacité réelle de la méthode. Le roman policier retrouvait ainsi sa nature première, celle d’être un roman, une fiction, un essai dramatique : «Un crime nous donne un adversaire qui joue sa vie, ce qui fournit le meilleur sujet d’un traitement dramatique»,106 rappelle Austin Freeman. «Tel est bien l’Art poétique de Freeman : vérité, clarté. Et c’est bien pourquoi il place si haut le roman policier, œuvre de raison qui se donne, comme matière première, le mystère, toujours par quelque côté “monstrueux”, pour l’élucider, c’est-à-dire le pénétrer de lumière et le ranger finalement sous la loi de l’intelligence. Le non-figuratif, c’est le refus de l’ordre, de la logique, de la pensée claire, c’est le crime contre l’esprit, c’est quelque chose de vaguement démoniaque, parce que volontairement négatif. […] En réalité, Freeman n’ose le comprendre; l’art moderne c’est le Mal! Et si Freeman se fait le champion laborieux du roman policier, c’est parce que cette forme de littérature est le parfait antidote de ce poison qu’est le culte de l’informe! Il ne faut pas sous-estimer ce qu’il y a de militant dans l’attitude de Freeman! N’oublions pas qu’il a l’impression d’amener le genre policier à son point de perfection».107 Et nous passons à la source du mystère.
Nous
parlons ici de l’angoisse.
L’angoisse de la vie, l’angoisse de la mort, l’angoisse du sexe
et de la fécondation, l’angoisse de la création du monde qui
promet aussi sa fin et tant d’autres qui en découlent, hantera
toujours le genre initié par le roman policier. L'angoisse est une
force incontournable qui contre-balance celle du désir dans les
romans d’amour. Encore là, Boileau- Narcejac avertissent :
«rappe-
Narcejac avertissent :
«rappe-
lons-le, notre esprit est ainsi fait qu’il va du mystère à la vérité par l’an-
goisse. Il suffit qu’on se donne un détective pour que, du même mouvement, surgisse le crime dans la violence, et l’attente douloureuse et émerveillée d’un dénouement surprenant. Aucun autre genre littéraire ne présente au même degré ce caractère d’objet. Une épopée, une tragédie sont des genres malléables, modelables au gré du talent ou du génie. Pas le roman policier. Il est ce qu’il est. Ou bien on se conforme à ses lois ou bien on le détruit. Tombé dans le champ de la littérature comme un aérolithe, il semble défier non seulement les critiques mais les auteurs eux-mêmes. Paradoxal, il devait piquer à l’extrême la curiosité du public cultivé».108 Un roman policier qui ne parvient pas à résoudre l’énigme posé au départ nous déçoit autant, sinon plus, qu’un roman d’amour qui s’achève sur l’échec d’une relation amoureuse entre les deux personnages principaux. Il y a donc une exigence de réussite rattachée au roman policier, une efficacité, celle d’apaiser nos angoisses, et c’est sans doute pour apaiser les leurs que la famille Romanov lisait des romans policiers alors qu’elle résidait en détention dans son palais d’où s’étaient envolées les heures heureuses. Ce genre exerçait sur cette famille un déplacement de leur situation personnelle angoissante : «L’angoisse de mort se déplace dès lors sur l’angoisse de ne pas savoir. Il
faut savoir pour juguler le risque; mais savoir, et surtout faire
savoir que l’on sait, c’est aussi courir un danger maximum».109
Avec la prière, le roman policier était une thérapie essentielle
pour maintenir le moral des membres de cette famille déchue. Du
centre de leur palais désert, ils avaient ainsi l’impression de
recouvrer une part du pouvoir sur eux-mêmes qu’ils venaient de
perdre : «On
a décrit la technique d’Hercule Poirot comme celle du “armchair
solver”,
c’est-à-dire celui qui enquête et résout les énigmes dans son
fauteuil, par opposition à l’homme de terrain qui va à la quête
des vestiges : empreintes de pas, cendres de cigarettes. Poirot
lui-même affirme à maintes reprises que sa seule technique est la
psychologie
[…] mais,
s’il affirme avec tant de certitude l’inutilité des méthodes
“scientifiques” de l’investigation criminelle, c’est parce
qu’il se fonde sur la dimension humaine du crime et sur la
certitude que l’énigme est en fait un secret».110
Pour une famille tout entière abandonnée à la piété
chrétienne-orthodoxe, la rationalité mécanique du roman policier
en provenance de la civilisation occidentale complétait
l’idiosyncrasie de ses membres : «L’ontologie
négative du roman policier ne démontre rien d’autre que le fait
que ses protagonistes sont des configurations stéréotypées dont la
ratio
détient les clés».111
Bien sûr, cette ratio
est la
mystification même du roman. En elle repose non la solution de
l’énigme mais l’effet de calmer les angoisses, ce que rappelle
Kracauer : «La
prétention de la ratio
fait du détective le pendant de Dieu lui-même. L’immanence qui
renie la transcendance occupe la place de celle-ci, et si l’on
confère au détective l’apparence de l’omniscience et de
l’omniprésence, s’il peut providentiellement produire ou
dès lors sur l’angoisse de ne pas savoir. Il
faut savoir pour juguler le risque; mais savoir, et surtout faire
savoir que l’on sait, c’est aussi courir un danger maximum».109
Avec la prière, le roman policier était une thérapie essentielle
pour maintenir le moral des membres de cette famille déchue. Du
centre de leur palais désert, ils avaient ainsi l’impression de
recouvrer une part du pouvoir sur eux-mêmes qu’ils venaient de
perdre : «On
a décrit la technique d’Hercule Poirot comme celle du “armchair
solver”,
c’est-à-dire celui qui enquête et résout les énigmes dans son
fauteuil, par opposition à l’homme de terrain qui va à la quête
des vestiges : empreintes de pas, cendres de cigarettes. Poirot
lui-même affirme à maintes reprises que sa seule technique est la
psychologie
[…] mais,
s’il affirme avec tant de certitude l’inutilité des méthodes
“scientifiques” de l’investigation criminelle, c’est parce
qu’il se fonde sur la dimension humaine du crime et sur la
certitude que l’énigme est en fait un secret».110
Pour une famille tout entière abandonnée à la piété
chrétienne-orthodoxe, la rationalité mécanique du roman policier
en provenance de la civilisation occidentale complétait
l’idiosyncrasie de ses membres : «L’ontologie
négative du roman policier ne démontre rien d’autre que le fait
que ses protagonistes sont des configurations stéréotypées dont la
ratio
détient les clés».111
Bien sûr, cette ratio
est la
mystification même du roman. En elle repose non la solution de
l’énigme mais l’effet de calmer les angoisses, ce que rappelle
Kracauer : «La
prétention de la ratio
fait du détective le pendant de Dieu lui-même. L’immanence qui
renie la transcendance occupe la place de celle-ci, et si l’on
confère au détective l’apparence de l’omniscience et de
l’omniprésence, s’il peut providentiellement produire ou
 empêcher des événements, à des fins qui sont dignes de tout
éloge, ce n’est là que la traduction esthétique d’une telle
déformation. Mais s’il est Dieu, ce n’est pas au sens antique,
en vertu de la perfection de sa figure ou de la puissance
inexplicable de son être; c’est bien plutôt le fait qu’il
déchiffre les figures sans les avoir comprises et qu’il déduit
intellectuellement toutes les caractéristiques essentielles, qui le
qualifie ici d’arbitre. Le roman dévoile ainsi indiscrètement ce
qui reste invisible pour la ratio
aveugle : le peu d’effet de sa prétendue divinité sur la réalité.
Car, déguisée en détective, elle calcule avec des grandeurs
données d’avance, au lieu de créer l’Étant incomparable; au
lieu de transformer et de peser les hommes, elle prend, sans
questionner, les pseudo-hommes comme des produits finis dont elle
connaît et utilise les lois; elle dirige des actions qui n’ont
aucun rapport avec elle, au lieu de se manifester dans le cours des
destinées. Ce Dieu-Détective n’est Dieu que dans un monde
abandonné de Dieu et qui par conséquent n’est pas authentique; il
commande l’inessentiel et il règne sur des fonctions sans supports
actifs. Dans la réalité, cette singerie de Dieu prendrait fin; la
ratio
y perdrait son pouvoir apparent qui est usurpé, et le détective se
révélerait être le tardillon dégénéré de l’Esprit de
Laplace, mais certainement pas le fils de Dieu».112
Quoi imaginer de plus pour satisfaire les prétentions d’un ancien
Tsar qui n’avait pas lésiné sur sa toute-puissance divine?
Nicolas Romanov pouvait ainsi se satisfaire d’une «fin
qui n’en est pas une, mettant tout juste fin à l’irréalité,
provoque le sentiment irréel, et des solutions qui n’en sont pas
sont finalement introduites pour contraindre le ciel qui n’existe
pas à descendre sur la terre. C’est ainsi que le kitsch trahit la
pensée déréalisée qui revêt l’apparence de la sphère la plus
haute».113
empêcher des événements, à des fins qui sont dignes de tout
éloge, ce n’est là que la traduction esthétique d’une telle
déformation. Mais s’il est Dieu, ce n’est pas au sens antique,
en vertu de la perfection de sa figure ou de la puissance
inexplicable de son être; c’est bien plutôt le fait qu’il
déchiffre les figures sans les avoir comprises et qu’il déduit
intellectuellement toutes les caractéristiques essentielles, qui le
qualifie ici d’arbitre. Le roman dévoile ainsi indiscrètement ce
qui reste invisible pour la ratio
aveugle : le peu d’effet de sa prétendue divinité sur la réalité.
Car, déguisée en détective, elle calcule avec des grandeurs
données d’avance, au lieu de créer l’Étant incomparable; au
lieu de transformer et de peser les hommes, elle prend, sans
questionner, les pseudo-hommes comme des produits finis dont elle
connaît et utilise les lois; elle dirige des actions qui n’ont
aucun rapport avec elle, au lieu de se manifester dans le cours des
destinées. Ce Dieu-Détective n’est Dieu que dans un monde
abandonné de Dieu et qui par conséquent n’est pas authentique; il
commande l’inessentiel et il règne sur des fonctions sans supports
actifs. Dans la réalité, cette singerie de Dieu prendrait fin; la
ratio
y perdrait son pouvoir apparent qui est usurpé, et le détective se
révélerait être le tardillon dégénéré de l’Esprit de
Laplace, mais certainement pas le fils de Dieu».112
Quoi imaginer de plus pour satisfaire les prétentions d’un ancien
Tsar qui n’avait pas lésiné sur sa toute-puissance divine?
Nicolas Romanov pouvait ainsi se satisfaire d’une «fin
qui n’en est pas une, mettant tout juste fin à l’irréalité,
provoque le sentiment irréel, et des solutions qui n’en sont pas
sont finalement introduites pour contraindre le ciel qui n’existe
pas à descendre sur la terre. C’est ainsi que le kitsch trahit la
pensée déréalisée qui revêt l’apparence de la sphère la plus
haute».113
 Narcejac avertissent :
«rappe-
Narcejac avertissent :
«rappe-lons-le, notre esprit est ainsi fait qu’il va du mystère à la vérité par l’an-
goisse. Il suffit qu’on se donne un détective pour que, du même mouvement, surgisse le crime dans la violence, et l’attente douloureuse et émerveillée d’un dénouement surprenant. Aucun autre genre littéraire ne présente au même degré ce caractère d’objet. Une épopée, une tragédie sont des genres malléables, modelables au gré du talent ou du génie. Pas le roman policier. Il est ce qu’il est. Ou bien on se conforme à ses lois ou bien on le détruit. Tombé dans le champ de la littérature comme un aérolithe, il semble défier non seulement les critiques mais les auteurs eux-mêmes. Paradoxal, il devait piquer à l’extrême la curiosité du public cultivé».108 Un roman policier qui ne parvient pas à résoudre l’énigme posé au départ nous déçoit autant, sinon plus, qu’un roman d’amour qui s’achève sur l’échec d’une relation amoureuse entre les deux personnages principaux. Il y a donc une exigence de réussite rattachée au roman policier, une efficacité, celle d’apaiser nos angoisses, et c’est sans doute pour apaiser les leurs que la famille Romanov lisait des romans policiers alors qu’elle résidait en détention dans son palais d’où s’étaient envolées les heures heureuses. Ce genre exerçait sur cette famille un déplacement de leur situation personnelle angoissante : «L’angoisse de mort se déplace
 dès lors sur l’angoisse de ne pas savoir. Il
faut savoir pour juguler le risque; mais savoir, et surtout faire
savoir que l’on sait, c’est aussi courir un danger maximum».109
Avec la prière, le roman policier était une thérapie essentielle
pour maintenir le moral des membres de cette famille déchue. Du
centre de leur palais désert, ils avaient ainsi l’impression de
recouvrer une part du pouvoir sur eux-mêmes qu’ils venaient de
perdre : «On
a décrit la technique d’Hercule Poirot comme celle du “armchair
solver”,
c’est-à-dire celui qui enquête et résout les énigmes dans son
fauteuil, par opposition à l’homme de terrain qui va à la quête
des vestiges : empreintes de pas, cendres de cigarettes. Poirot
lui-même affirme à maintes reprises que sa seule technique est la
psychologie
[…] mais,
s’il affirme avec tant de certitude l’inutilité des méthodes
“scientifiques” de l’investigation criminelle, c’est parce
qu’il se fonde sur la dimension humaine du crime et sur la
certitude que l’énigme est en fait un secret».110
Pour une famille tout entière abandonnée à la piété
chrétienne-orthodoxe, la rationalité mécanique du roman policier
en provenance de la civilisation occidentale complétait
l’idiosyncrasie de ses membres : «L’ontologie
négative du roman policier ne démontre rien d’autre que le fait
que ses protagonistes sont des configurations stéréotypées dont la
ratio
détient les clés».111
Bien sûr, cette ratio
est la
mystification même du roman. En elle repose non la solution de
l’énigme mais l’effet de calmer les angoisses, ce que rappelle
Kracauer : «La
prétention de la ratio
fait du détective le pendant de Dieu lui-même. L’immanence qui
renie la transcendance occupe la place de celle-ci, et si l’on
confère au détective l’apparence de l’omniscience et de
l’omniprésence, s’il peut providentiellement produire ou
dès lors sur l’angoisse de ne pas savoir. Il
faut savoir pour juguler le risque; mais savoir, et surtout faire
savoir que l’on sait, c’est aussi courir un danger maximum».109
Avec la prière, le roman policier était une thérapie essentielle
pour maintenir le moral des membres de cette famille déchue. Du
centre de leur palais désert, ils avaient ainsi l’impression de
recouvrer une part du pouvoir sur eux-mêmes qu’ils venaient de
perdre : «On
a décrit la technique d’Hercule Poirot comme celle du “armchair
solver”,
c’est-à-dire celui qui enquête et résout les énigmes dans son
fauteuil, par opposition à l’homme de terrain qui va à la quête
des vestiges : empreintes de pas, cendres de cigarettes. Poirot
lui-même affirme à maintes reprises que sa seule technique est la
psychologie
[…] mais,
s’il affirme avec tant de certitude l’inutilité des méthodes
“scientifiques” de l’investigation criminelle, c’est parce
qu’il se fonde sur la dimension humaine du crime et sur la
certitude que l’énigme est en fait un secret».110
Pour une famille tout entière abandonnée à la piété
chrétienne-orthodoxe, la rationalité mécanique du roman policier
en provenance de la civilisation occidentale complétait
l’idiosyncrasie de ses membres : «L’ontologie
négative du roman policier ne démontre rien d’autre que le fait
que ses protagonistes sont des configurations stéréotypées dont la
ratio
détient les clés».111
Bien sûr, cette ratio
est la
mystification même du roman. En elle repose non la solution de
l’énigme mais l’effet de calmer les angoisses, ce que rappelle
Kracauer : «La
prétention de la ratio
fait du détective le pendant de Dieu lui-même. L’immanence qui
renie la transcendance occupe la place de celle-ci, et si l’on
confère au détective l’apparence de l’omniscience et de
l’omniprésence, s’il peut providentiellement produire ou
 empêcher des événements, à des fins qui sont dignes de tout
éloge, ce n’est là que la traduction esthétique d’une telle
déformation. Mais s’il est Dieu, ce n’est pas au sens antique,
en vertu de la perfection de sa figure ou de la puissance
inexplicable de son être; c’est bien plutôt le fait qu’il
déchiffre les figures sans les avoir comprises et qu’il déduit
intellectuellement toutes les caractéristiques essentielles, qui le
qualifie ici d’arbitre. Le roman dévoile ainsi indiscrètement ce
qui reste invisible pour la ratio
aveugle : le peu d’effet de sa prétendue divinité sur la réalité.
Car, déguisée en détective, elle calcule avec des grandeurs
données d’avance, au lieu de créer l’Étant incomparable; au
lieu de transformer et de peser les hommes, elle prend, sans
questionner, les pseudo-hommes comme des produits finis dont elle
connaît et utilise les lois; elle dirige des actions qui n’ont
aucun rapport avec elle, au lieu de se manifester dans le cours des
destinées. Ce Dieu-Détective n’est Dieu que dans un monde
abandonné de Dieu et qui par conséquent n’est pas authentique; il
commande l’inessentiel et il règne sur des fonctions sans supports
actifs. Dans la réalité, cette singerie de Dieu prendrait fin; la
ratio
y perdrait son pouvoir apparent qui est usurpé, et le détective se
révélerait être le tardillon dégénéré de l’Esprit de
Laplace, mais certainement pas le fils de Dieu».112
Quoi imaginer de plus pour satisfaire les prétentions d’un ancien
Tsar qui n’avait pas lésiné sur sa toute-puissance divine?
Nicolas Romanov pouvait ainsi se satisfaire d’une «fin
qui n’en est pas une, mettant tout juste fin à l’irréalité,
provoque le sentiment irréel, et des solutions qui n’en sont pas
sont finalement introduites pour contraindre le ciel qui n’existe
pas à descendre sur la terre. C’est ainsi que le kitsch trahit la
pensée déréalisée qui revêt l’apparence de la sphère la plus
haute».113
empêcher des événements, à des fins qui sont dignes de tout
éloge, ce n’est là que la traduction esthétique d’une telle
déformation. Mais s’il est Dieu, ce n’est pas au sens antique,
en vertu de la perfection de sa figure ou de la puissance
inexplicable de son être; c’est bien plutôt le fait qu’il
déchiffre les figures sans les avoir comprises et qu’il déduit
intellectuellement toutes les caractéristiques essentielles, qui le
qualifie ici d’arbitre. Le roman dévoile ainsi indiscrètement ce
qui reste invisible pour la ratio
aveugle : le peu d’effet de sa prétendue divinité sur la réalité.
Car, déguisée en détective, elle calcule avec des grandeurs
données d’avance, au lieu de créer l’Étant incomparable; au
lieu de transformer et de peser les hommes, elle prend, sans
questionner, les pseudo-hommes comme des produits finis dont elle
connaît et utilise les lois; elle dirige des actions qui n’ont
aucun rapport avec elle, au lieu de se manifester dans le cours des
destinées. Ce Dieu-Détective n’est Dieu que dans un monde
abandonné de Dieu et qui par conséquent n’est pas authentique; il
commande l’inessentiel et il règne sur des fonctions sans supports
actifs. Dans la réalité, cette singerie de Dieu prendrait fin; la
ratio
y perdrait son pouvoir apparent qui est usurpé, et le détective se
révélerait être le tardillon dégénéré de l’Esprit de
Laplace, mais certainement pas le fils de Dieu».112
Quoi imaginer de plus pour satisfaire les prétentions d’un ancien
Tsar qui n’avait pas lésiné sur sa toute-puissance divine?
Nicolas Romanov pouvait ainsi se satisfaire d’une «fin
qui n’en est pas une, mettant tout juste fin à l’irréalité,
provoque le sentiment irréel, et des solutions qui n’en sont pas
sont finalement introduites pour contraindre le ciel qui n’existe
pas à descendre sur la terre. C’est ainsi que le kitsch trahit la
pensée déréalisée qui revêt l’apparence de la sphère la plus
haute».113
Ceux
qui discréditaient le roman policier négligeaient ces observations
et son utilité première. «Son
œuvre, sa fonction dans la littérature de divertissement, est
rassurante comme la religion du dimanche : le roman policier
classique est un genre “kitsch”, précurseur de l’industrie
culturelle. “Mouvement vide” (G. Lukács) comme le système
rationaliste qui dispose librement du monde, orienté par le seul
dieu de la déduction, le processus de l’enquête est la parodie du
processus esthétique par lequel, de Cervantès à Flaubert, le grand
roman tient en équilibre l’être et le devenir, par lequel il
accompagne en une ironique sympathie le personnage asservi à son
idéal, jusqu’à ce que le sens de son voyage s’éclaire
brusquement par l’échec et le souvenir».114
Siegfried Kracauer le reconnaît : «Sans
être une œuvre d’art, le roman policier présente à la société déréalisée sa propre face, sous une forme plus pure qu’elle ne
pourrait la voir autrement. Ses représentants et ses fonctions
rendent ici compte d’eux-mêmes et trahissent leur signification
cachée. Mais s’il peut contraindre le monde voilé à se dévoiler
lui-même, c’est uniquement parce qu’il est produit par une
conscience qui n’est pas limitée par ce monde. Porté par cette
conscience, il parachève d’abord intellectuellement la société
dominée par la ratio
autonome et qui n’existe qu’idéalement, et développe de manière
conséquente les rudiments présentés par cette société, pour que
l’idée se réalise entièrement dans des actions et des figures.
Lorsque la stylisation de l’irréalité unidimensionnelle est
achevée, il intègre les contenus particuliers, désormais adéquats
aux conditions constitutives, à un sens cohérent et achevé en soi;
il accomplit ce travail en vertu de son caractère existentiel qui se
traduit non par la critique et l’exigence, mais par les principes
de la composition esthétique. Mais les données figurées ne peuvent
être interprétées que grâce à l’unité tissée de la sorte».115
Parce qu’il est un genre opérant essentiellement sur les
mécanismes de la ratio,
le roman policier révèle une dimension de la vie sociale qui en est
précisément la source : «La
structure caractéristique que prend la vie présentée par le roman
policier indique que la conscience qui le produit n’est pas
individuelle ni contingente; elle donne en même temps à entendre
que les traits décisifs sur le plan métaphysique y ont été
sélectionnés. De même que le détective découvre le secret
enseveli parmi les hommes, de même le roman policier décèle dans
la sphère esthétique le secret de la société déréalisée et de
ses marionnettes dépourvues de substance. Sa composition transforme
la vie incapable de se saisir elle-même en une copie interprétable
de la réalité authentique».116
Société déréalisée vivant par ses désirs et ses angoisses, le
roman policier rendait  compte de la dégénérescence de la
civilisation au moment où elle apparaissait irréversible. Il
générait une compulsion à répétitions qui appelait toujours un
nouveau roman, racontant à peu près la même histoire, avec
seulement des détails divergents. La société bourgeoise
occidentale en avait besoin pour apaiser ses doutes en cette fin
de siècle :
«Fonction
qui, sous prétexte de réconcilier l’homme avec le monde, arbitre
en lui les conflits de l’inconscient et du conscient. Elle rend
dérisoire la place faite par la critique aux variations récentes de
l’épopée. Combien sont pauvres les analyses expliquant le succès
du roman policier (de science-fiction ou d’aventures) par un besoin
de “s’évader”, de se distraire, d’oublier la réalité grâce
à une altération violente de cette réalité. Ou le fait divers
comme un nouvel exotisme… Forme moderne de l’épopée, le roman
policier n’aide pas l’homme à s’évader, mais à demeurer dans
sa prison. Il est beaucoup plus qu’une simple scorie de la
civilisation industrielle : l’un des moyens de la supporter».117
D’ailleurs, «comme
l’a rappelé Jean Fabre, si roman policier et fantastique ont pour
trait commun de concerner l’individu, roman d’espionnage et
science-fiction ont pour caractéristique commune de concerner une
collectivité».118
La science-fiction, en effet, en était à ses premiers grands
ouvrages tandis que le roman d’espionnage suivra la Grande Guerre.
L’essence du fantastique au XIXe siècle résidait ailleurs.
compte de la dégénérescence de la
civilisation au moment où elle apparaissait irréversible. Il
générait une compulsion à répétitions qui appelait toujours un
nouveau roman, racontant à peu près la même histoire, avec
seulement des détails divergents. La société bourgeoise
occidentale en avait besoin pour apaiser ses doutes en cette fin
de siècle :
«Fonction
qui, sous prétexte de réconcilier l’homme avec le monde, arbitre
en lui les conflits de l’inconscient et du conscient. Elle rend
dérisoire la place faite par la critique aux variations récentes de
l’épopée. Combien sont pauvres les analyses expliquant le succès
du roman policier (de science-fiction ou d’aventures) par un besoin
de “s’évader”, de se distraire, d’oublier la réalité grâce
à une altération violente de cette réalité. Ou le fait divers
comme un nouvel exotisme… Forme moderne de l’épopée, le roman
policier n’aide pas l’homme à s’évader, mais à demeurer dans
sa prison. Il est beaucoup plus qu’une simple scorie de la
civilisation industrielle : l’un des moyens de la supporter».117
D’ailleurs, «comme
l’a rappelé Jean Fabre, si roman policier et fantastique ont pour
trait commun de concerner l’individu, roman d’espionnage et
science-fiction ont pour caractéristique commune de concerner une
collectivité».118
La science-fiction, en effet, en était à ses premiers grands
ouvrages tandis que le roman d’espionnage suivra la Grande Guerre.
L’essence du fantastique au XIXe siècle résidait ailleurs.
 compte de la dégénérescence de la
civilisation au moment où elle apparaissait irréversible. Il
générait une compulsion à répétitions qui appelait toujours un
nouveau roman, racontant à peu près la même histoire, avec
seulement des détails divergents. La société bourgeoise
occidentale en avait besoin pour apaiser ses doutes en cette fin
de siècle :
«Fonction
qui, sous prétexte de réconcilier l’homme avec le monde, arbitre
en lui les conflits de l’inconscient et du conscient. Elle rend
dérisoire la place faite par la critique aux variations récentes de
l’épopée. Combien sont pauvres les analyses expliquant le succès
du roman policier (de science-fiction ou d’aventures) par un besoin
de “s’évader”, de se distraire, d’oublier la réalité grâce
à une altération violente de cette réalité. Ou le fait divers
comme un nouvel exotisme… Forme moderne de l’épopée, le roman
policier n’aide pas l’homme à s’évader, mais à demeurer dans
sa prison. Il est beaucoup plus qu’une simple scorie de la
civilisation industrielle : l’un des moyens de la supporter».117
D’ailleurs, «comme
l’a rappelé Jean Fabre, si roman policier et fantastique ont pour
trait commun de concerner l’individu, roman d’espionnage et
science-fiction ont pour caractéristique commune de concerner une
collectivité».118
La science-fiction, en effet, en était à ses premiers grands
ouvrages tandis que le roman d’espionnage suivra la Grande Guerre.
L’essence du fantastique au XIXe siècle résidait ailleurs.
compte de la dégénérescence de la
civilisation au moment où elle apparaissait irréversible. Il
générait une compulsion à répétitions qui appelait toujours un
nouveau roman, racontant à peu près la même histoire, avec
seulement des détails divergents. La société bourgeoise
occidentale en avait besoin pour apaiser ses doutes en cette fin
de siècle :
«Fonction
qui, sous prétexte de réconcilier l’homme avec le monde, arbitre
en lui les conflits de l’inconscient et du conscient. Elle rend
dérisoire la place faite par la critique aux variations récentes de
l’épopée. Combien sont pauvres les analyses expliquant le succès
du roman policier (de science-fiction ou d’aventures) par un besoin
de “s’évader”, de se distraire, d’oublier la réalité grâce
à une altération violente de cette réalité. Ou le fait divers
comme un nouvel exotisme… Forme moderne de l’épopée, le roman
policier n’aide pas l’homme à s’évader, mais à demeurer dans
sa prison. Il est beaucoup plus qu’une simple scorie de la
civilisation industrielle : l’un des moyens de la supporter».117
D’ailleurs, «comme
l’a rappelé Jean Fabre, si roman policier et fantastique ont pour
trait commun de concerner l’individu, roman d’espionnage et
science-fiction ont pour caractéristique commune de concerner une
collectivité».118
La science-fiction, en effet, en était à ses premiers grands
ouvrages tandis que le roman d’espionnage suivra la Grande Guerre.
L’essence du fantastique au XIXe siècle résidait ailleurs. Il
résidait, entre autres, dans ces espaces vides qui baignent les
œuvres du photographe Atget, comme le rappelle Walter Benjamin :
«On a dit
d’Atget à très juste titre qu’il photographiait
[des rues de Paris désertes] comme
s’il s’agissait des lieux d’un crime. Les lieux d’un crime
aussi sont déserts : on les photographie afin d’établir des
preuves. Avec Atget, les photos deviennent les preuves classiques
d’événements historiques, et acquièrent une signification
politique cachée».119
Il n’y avait pas de cadavres dans les photographies d’Atget, mais
quelque chose qui ressemblait à une empreinte, un spectre. Ces lieux
qui apparaissaient sur les clichés d'Atget étaient conformes à
ceux des crimes que l’on retrouve dans les romans policiers; des
lieux familiers.
Rappelons-le, le roman policier ne reprenait pas les thématiques
propres aux anciens romans gothiques de la fin du XVIIIe siècle. Par
exemple, «chez
Agatha Christie, le home
va s’avérer étrangement inquiétant, non pas qu’il soit
d’aspect sinistre bien au contraire
[ce en
quoi Agatha Christie se différencie des classiques “romans
gothiques” dont sa génération avait été nourrie],
mais parce
que c’est précisément en ces lieux rassurants où il fait bon
vivre que se commet, voire se répète, le crime “intime”,
“familier”…».120
Des chambres, des bibliothèques, des salons, les fameux jardins anglais. À cela, il faut ajouter que «le
seul intérêt des lieux du crime réside dans la concentration des
familiers de la victime. C’est dans le secret des cœurs que réside
la solution, non dans les scories abandonnées par un assassin peu
soigneux. Au lieu de s’acharner sur une illusoire lecture du
terrain,
Il
résidait, entre autres, dans ces espaces vides qui baignent les
œuvres du photographe Atget, comme le rappelle Walter Benjamin :
«On a dit
d’Atget à très juste titre qu’il photographiait
[des rues de Paris désertes] comme
s’il s’agissait des lieux d’un crime. Les lieux d’un crime
aussi sont déserts : on les photographie afin d’établir des
preuves. Avec Atget, les photos deviennent les preuves classiques
d’événements historiques, et acquièrent une signification
politique cachée».119
Il n’y avait pas de cadavres dans les photographies d’Atget, mais
quelque chose qui ressemblait à une empreinte, un spectre. Ces lieux
qui apparaissaient sur les clichés d'Atget étaient conformes à
ceux des crimes que l’on retrouve dans les romans policiers; des
lieux familiers.
Rappelons-le, le roman policier ne reprenait pas les thématiques
propres aux anciens romans gothiques de la fin du XVIIIe siècle. Par
exemple, «chez
Agatha Christie, le home
va s’avérer étrangement inquiétant, non pas qu’il soit
d’aspect sinistre bien au contraire
[ce en
quoi Agatha Christie se différencie des classiques “romans
gothiques” dont sa génération avait été nourrie],
mais parce
que c’est précisément en ces lieux rassurants où il fait bon
vivre que se commet, voire se répète, le crime “intime”,
“familier”…».120
Des chambres, des bibliothèques, des salons, les fameux jardins anglais. À cela, il faut ajouter que «le
seul intérêt des lieux du crime réside dans la concentration des
familiers de la victime. C’est dans le secret des cœurs que réside
la solution, non dans les scories abandonnées par un assassin peu
soigneux. Au lieu de s’acharner sur une illusoire lecture du
terrain,  il faut tenter une profitable lecture des âmes. La vérité
ne peut résider dans la matière : elle n’a pas d’â-
il faut tenter une profitable lecture des âmes. La vérité
ne peut résider dans la matière : elle n’a pas d’â-me».121 Or, pré-
cisé-
ment, les clichés d’Atget étaient remplis d’âme, ce qui fascina Benjamin. Il en va de même des preuves : «Dans les romans policiers, de Conan Doyle à Rex Stout, ces preuves ne sont pas nécessaires. Le détective imagine la solution et la “dit” comme si c’était la vérité; aussitôt, Watson, ou l’assassin présent, ou une tierce personne, vérifient l’hypothèse, s’écriant : “Cela s’est passé exactement ainsi!” Et le détective a la certitude d’avoir vu juste. Dans les romans policiers, l’auteur (qui agit à la place de Dieu) garantit la correspondance entre le Monde Possible imaginé par le détective et le Monde Réel. Hors du polar, les abductions sont plus risquées, toujours soumises au risque d’échec».122 Mais parce que cette mystification était voulue par le lecteur; parce qu’à la vérité, il préférait la certitude et qu’un homme de méthode, un expérimentateur, un savant et logicien le disait, cela valait n’importe quelle parole sacrée : «La formule du scénario fantasmatique “on découvre un cadavre” est donc à traduire ainsi : il est brusquement révélé qu’il existe derrière le monde des apparences un monde inconnu, menaçant et dangereux, d’une puissance bien supérieure au premier. Plus précisément encore, ces deux mondes n’en font qu’un comme l’envers et l’endroit d’un même objet. Si le retournement est possible à tout instant, il est aussi éventuellement décelable à des indices extrêmement ténus et c’est à l’intelligence que va être confiée la mission de tresser ces indices en une logique qui reconstituera et maîtrisera le traumatisme».123
UN ROMAN MÉTAPHYSIQUE
Même si le fantastique du roman policier sublime le mystère surnaturel, il n’en conserve pas moins que «les figures du roman policier répondent point par point aux formes de la religion : le mystère à élucider répond au Mystère divin, le détective au prêtre-médiateur comme lui voué au célibat, son intellect infaillible au Logos divin, le criminel au pécheur et à l’hérétique, la police à l’Église institutionnalisée et aliénée à ses sources, le suspense à l’intensité de la ferveur religieuse tendue vers Dieu. Malgré les apparences, il y a une affinité élective entre le roman policier et la théologie».124 Les critiques ne cessent, par exemple, de retrouver des traces du mystère chrétien dans la structure de l’Imaginaire du roman policier. Jean-Pierre Bayard «remarque que le roman policier tourne autour du chiffre 3 “auquel Freud reconnaissait un symbolisme sexuel (!) : il y a trois héros : la victime, le criminel, le détective; et trois phases principales : le meurtre, l’enquête, la
 solution”».125
On pourrait penser aussi au système ternaire de Hegel, la
dialec-
solution”».125
On pourrait penser aussi au système ternaire de Hegel, la
dialec-tique de la thèse (la victi-
me), l’an-
tithèse (le crimi-
nel) enfin la synthèse opérée par le détecti-
ve. D’autres préfè-
rent une structure binaire, comme Narcejac : «Peut-être vaudrait-il mieux parler de deux pôles, l’un positif (l’information), l’autre négatif (l’émotion), produisant un courant qui constitue la vie même du roman policier. […] Le recours à l’émotion permet… de paralyser la démarche de la réflexion en train de s’éveiller […] et, par ce mouvement de va-et-vient, l’histoire avance vers son terme. C’est pourquoi on peut affirmer que le roman policier “fonctionne” comme une machine. […] Il est donc vrai que le roman policier établit un courant entre deux pôles, produit une énergie qui, peu à peu, se dégrade. C’est pourquoi on peut l’étudier en fonction de la théorie des machines».126 Cela s’insère sans doute mieux dans la conception mécaniciste du roman policier, mais en termes métaphysiques, cela ne change pas grand chose qu’il soit unaire, binaire ou ternaire. Ce qui compte, c’est que le mystère y est présent dès l’origine, une nécessité dans la structure du roman policier. «Régis Messac, auteur en 1929, de la première étude importante sur le sujet (Le Detective-Novel et l’influence de la pensée scientifique)
 écrit qu’il s’agit d’un “récit consacré à la découverte
méthodique et graduelle, par des moyens rationnels des circonstances
exactes d’un événement mystérieux”».127
Au départ, on retient, comme il a été dit, l’importance de
l’occulte dans les romans policiers. Évidemment, la gitane
chiromancienne ou la diseuse de bonne aventure ne sont là que pour
brouiller les cartes, mais aussi pour rappeler que le roman policier
baigne dans un mystère numineux. Le spiritisme à la mode y fut donc
exploité dès Conan Doyle qui fût, un temps, un adepte des séances
de médium et de tables tournantes : «On
ne saurait sous-estimer l’énorme influence du spiritisme chez les
Anglo-Saxons, à l’époque où se constitue le roman policier. Il
suffit de ne pas oublier que Conan Doyle, père de Sherlock Holmes,
est en même temps un adepte convaincu du spiritisme. Peu nous
importe le contenu de ce dernier. Ce qui frappe, c’est qu’il se
donne d’emblée comme une science de l’au-delà. L’au-delà
existe : voilà le fait établi grâce aux tables tournantes et aux
expériences faites avec des médiums. Et ses manifestations peuvent
être objet de science, parce qu’elles sont faciles, à produire, à
observer, à classer, à décrire. Elles obéissent à des lois.
Mais, évidemment, elles ont un aspect sui
generis
qui les place à part, dans la catégorie des faits “immatériels”».128
Ce fantôme qui n’existe pas mais qui brouille l’enquête agit à
la manière du vieil Hamlet. Il motive l’assassin à commettre le
meurtre ou alors il terrorise les témoins qui sont persuadés de la
malédiction qui s’abat sur une famille (les Baskerville, par
exemple). Cela revêt donc le détective d’une autre fonction
parcellaire, celle d’être un exorciste.
écrit qu’il s’agit d’un “récit consacré à la découverte
méthodique et graduelle, par des moyens rationnels des circonstances
exactes d’un événement mystérieux”».127
Au départ, on retient, comme il a été dit, l’importance de
l’occulte dans les romans policiers. Évidemment, la gitane
chiromancienne ou la diseuse de bonne aventure ne sont là que pour
brouiller les cartes, mais aussi pour rappeler que le roman policier
baigne dans un mystère numineux. Le spiritisme à la mode y fut donc
exploité dès Conan Doyle qui fût, un temps, un adepte des séances
de médium et de tables tournantes : «On
ne saurait sous-estimer l’énorme influence du spiritisme chez les
Anglo-Saxons, à l’époque où se constitue le roman policier. Il
suffit de ne pas oublier que Conan Doyle, père de Sherlock Holmes,
est en même temps un adepte convaincu du spiritisme. Peu nous
importe le contenu de ce dernier. Ce qui frappe, c’est qu’il se
donne d’emblée comme une science de l’au-delà. L’au-delà
existe : voilà le fait établi grâce aux tables tournantes et aux
expériences faites avec des médiums. Et ses manifestations peuvent
être objet de science, parce qu’elles sont faciles, à produire, à
observer, à classer, à décrire. Elles obéissent à des lois.
Mais, évidemment, elles ont un aspect sui
generis
qui les place à part, dans la catégorie des faits “immatériels”».128
Ce fantôme qui n’existe pas mais qui brouille l’enquête agit à
la manière du vieil Hamlet. Il motive l’assassin à commettre le
meurtre ou alors il terrorise les témoins qui sont persuadés de la
malédiction qui s’abat sur une famille (les Baskerville, par
exemple). Cela revêt donc le détective d’une autre fonction
parcellaire, celle d’être un exorciste.
En
cela, le détective poursuit sa substitution au prêtre. Il est
au-dessus de toutes corruptions : «Le
personnage qui mène et résoud l’enquête est souvent un individu
“installé”, au-dessus de tout soupçon : de ce fait, il saura
vite reconnaître le vrai et le faux ambitieux. Il symbolise donc en
quelque sorte la loi sociale qui assigne chaque individu à sa
véritable place. C’est pourquoi le roman du surhomme qui resurgit
dans les années précédant la Première Guerre mondiale a une
valeur anarchiste : non point parce que le héros bafoue la police et
les pouvoirs à longueur d’épisodes, mais parce que, protéiforme
et doté d’ubiquité, il est inassignable à une position sociale
(cas d’Arsène Lupin, de Fantômas)».129
Le prêtre ou le pasteur ont souvent conservé leur vieille fonction
 inquisitrice des temps anciens sans disposer, toutefois, du pouvoir
de juger, de condamner et d’exécuter les criminels. À ce titre,
le curé de paroisse était déjà un personnage de romans
policiers : «Il
surveille et enquête comme un policier le fait ordinairement, se
substitue souvent aux administrateurs de la justice et abuse parfois
de ce pouvoir que lui confère la collaboration presque
inconditionnelle de la justice.
[…] Le
curé enquête, interroge et furète, car tout savoir est une
condition essentielle au contrôle qu’il tente d’exercer sur le
territoire paroissial. Il arrive que le greffier l’informe de
situations qui lui ont échappé, mais c’est plus souvent lui qui
demande, qui dénonce ou qui transmet les détails de désordres
qu’il voudrait faire réprimer. Ici, il s’adresse au greffier
pour connaître les noms de ses paroissiens qui ont payé le
cautionnement d’une prostituée, ou pour avoir copie de la sentence
contre un hôtelier; là, il transmet avec force détails les
agissements de paroissiens en lien avec une maison de prostitution ou
les déplacements d’un prévenu; là encore, il dévoile la
conduite du postillon et du boucher qui livrent du whisky, ou les
divers camouflages d’un débit clandestin d’alcool. Le curé
connaît bien son monde et se permet de conseiller le greffier sur la
manière de faire une arrestation.
[…] En
fait, si le clergé est si bien informé, c’est aussi à cause de
son réseau d’informateurs qu’il encourage en lui prêtant une
oreille attentive. Mais il y a parfois un risque à solliciter le
commérage et la délation, comme l’apprend le curé Pierre Foulay
de Lac-à-la-Tortue qui a soulevé contre lui une partie de la
jeunesse. Un soir, au retour d’une veillée, des jeunes “en fête”
l’invectivent en criant “Hourah pour p’tit Pierre” et
insultent ses informatrices, l’institutrice et une veuve, à qui
ils crient : “Va donc porter les nouvelles au curé
[…] il
est temps de sortir de sous la robe du curé”».130
Mais, pour le Father Brown
inquisitrice des temps anciens sans disposer, toutefois, du pouvoir
de juger, de condamner et d’exécuter les criminels. À ce titre,
le curé de paroisse était déjà un personnage de romans
policiers : «Il
surveille et enquête comme un policier le fait ordinairement, se
substitue souvent aux administrateurs de la justice et abuse parfois
de ce pouvoir que lui confère la collaboration presque
inconditionnelle de la justice.
[…] Le
curé enquête, interroge et furète, car tout savoir est une
condition essentielle au contrôle qu’il tente d’exercer sur le
territoire paroissial. Il arrive que le greffier l’informe de
situations qui lui ont échappé, mais c’est plus souvent lui qui
demande, qui dénonce ou qui transmet les détails de désordres
qu’il voudrait faire réprimer. Ici, il s’adresse au greffier
pour connaître les noms de ses paroissiens qui ont payé le
cautionnement d’une prostituée, ou pour avoir copie de la sentence
contre un hôtelier; là, il transmet avec force détails les
agissements de paroissiens en lien avec une maison de prostitution ou
les déplacements d’un prévenu; là encore, il dévoile la
conduite du postillon et du boucher qui livrent du whisky, ou les
divers camouflages d’un débit clandestin d’alcool. Le curé
connaît bien son monde et se permet de conseiller le greffier sur la
manière de faire une arrestation.
[…] En
fait, si le clergé est si bien informé, c’est aussi à cause de
son réseau d’informateurs qu’il encourage en lui prêtant une
oreille attentive. Mais il y a parfois un risque à solliciter le
commérage et la délation, comme l’apprend le curé Pierre Foulay
de Lac-à-la-Tortue qui a soulevé contre lui une partie de la
jeunesse. Un soir, au retour d’une veillée, des jeunes “en fête”
l’invectivent en criant “Hourah pour p’tit Pierre” et
insultent ses informatrices, l’institutrice et une veuve, à qui
ils crient : “Va donc porter les nouvelles au curé
[…] il
est temps de sortir de sous la robe du curé”».130
Mais, pour le Father Brown  de Chesterton, «l’ex-
de Chesterton, «l’ex-
périence du confes-
sionnal ne suffit pas à expli-
quer la sûreté de ses analyses psycho-
logi-
ques. La morale retirée de ses enquêtes, ajoutée à une réticence envers l’Ancien Testament trop obscurci par le surnaturel et au regret de la limitation que l’homme apporte à l’usage de la Raison révèlent le disciple de saint Thomas d’Aquin».131 Fidèle en cela à la tradition cléricale, Father Brown «réprouve la foi aveugle, la superstition scientifique, l’application mécanique - auxquelles peut donner lieu un objet inerte, souillé, déformé ou intact».132 Comme le prêtre, là encore, le détective est un célibataire coriace que l’attrait du beau sexe ne détache pas de sa mission métaphysique : «Sur le plan esthétique, le roman souligne son isolement en le condamnant au célibat. Comme le prêtre catholique, il vit dans cet état d’exception; tout au plus est-il assisté d’une femme de ménage, mais en l’absence de besoins sexuels, elle n’a à s’occuper que du linge, des repas opulents et des valises - si tant est qu’elle existe et qu’un valet ne témoigne avec une insistance encore plus grande de l’absence de tout lien avec les hommes. Car son célibat n’est pas dû aux renoncement pour l’amour de quelque chose de plus élevé : c’est un célibat a priori qui représente la situation de la ratio qui, s’étant nommée elle-même critère univer-
nommée elle-même critère univer-
sel,
ignore toute accom-
mo
dation. Inhu-
maine sans être divine, reine du royaume que Lask appelle le “no-sensible”, elle est absolument dépourvue du désir et de relation, ni inclinée vers le bas comme la divinité ni tendue vers celle-ci, elle ne se réalise que sous la forme d’un processus qui n’accède jamais à la plénitude. C’est pourquoi le détective est compris comme un neutre qui n’est ni érotique ni non érotique, mais un “Cela” que rien ne saurait affecter et dont le caractère objectal s’explique par l’objectivité d’un intellect que rien ne peut influencer parce qu’il se fonde sur le Néant. Pour que sa personnification devienne saisissable sur le plan esthétique, le roman policier, et notamment son type anglo-saxon, lui donne des traits puritains en faisant d’elle le modèle de l’ascèse intramondaine; l’exercice de celle-ci lui rend le monde indifférent à l’intérieur même du monde et le plonge entièrement dans son affaire».133 Contrairement aux détectives du roman noir d’après la Seconde Guerre mondiale, le détective de l’époque vivait dans un état de chasteté virginal.
Toute la libido était absorbée chez lui par ce goût du mystère, à l’image d’un mystique des temps modernes satisfait de la vision mécaniciste du monde. Tintin, l'éternel adolescent des bandes dessinées de Hergé, était son proche parent. «Last and least, le mystère qui fait courir un Sherlock Holmes s’avère être un fait quelconque qui en soi ne veut rien dire. Dans la plupart des cas, il n’y a pas non plus de conclusion morale, ou seulement de manière accessoire. Lorsque tous les éclaircissements nécessaires pour comprendre l’enchaînement des événements sont donnés, les conséquences du crime pour le criminel sont traités comme des bagatelles; que son destin personnel soit négligé, cela n’est que juste. Mais souvent on n’apprend même pas si le bras de la justice s’est emparé de lui».134 Clairvoyant lorsqu’il s’agissait de résoudre les mystères des autres, il se montrit aveugle à sa propre condition :
«Rouletabille
de Leroux, qui “prend la raison par le bon bout” et semble donc
un émule des détectives anglo-saxons, mais avec un esprit
infiniment “Belle Époque française”, patriote, revanchard, ami
des Russes, et dans une situation œdipienne qui n’a rien à voir
avec la raison raisonnante, puisqu’il est toute sa vie à la
recherche de sa mère et apprend à l’issue du Mystère
de la chambre jaune
que le coupable digne de la mort n’est autre que son propre
père!».135
Mais rien ne vaut Londres sous la brume où la campagne anglaise pour
y déposer un cadavre gênant : «Des
millions de romans policiers entre les deux guerres ont ainsi placé
leur crime presque parfait dans la campagne anglaise : un manoir
confortable, des occupants fortunés, souvent oisifs, un détective
dilettante pour lequel l’assassinat est l’un des beaux arts.
Univers insolite, rite immuable, célébration du crime dans un monde
de douairières, de majors des Indes, nourris de scones muffins et
buns (sans oublier le thé, le sherry et le vieux porto). Les
lecteurs populaires de ces romans policiers sont encore légion…».136
C’est dans ces décors que Agatha Christie plantait ses personnages
appelés à une longue existence, Hercule Poirot, détective belge
immigré lors de l’occupation de son pays par les troupes du Kaiser
en 1914 et Miss
Jane Marple. Dès que Poirot et Marple apparaissent sur un lieu, on
est sûr qu'un crime s'y commettra. Qu'ils soient invités à fêter
Noël, qu'ils prennent des vacances sur une île de la Mer Égée
aveugle à sa propre condition :
«Rouletabille
de Leroux, qui “prend la raison par le bon bout” et semble donc
un émule des détectives anglo-saxons, mais avec un esprit
infiniment “Belle Époque française”, patriote, revanchard, ami
des Russes, et dans une situation œdipienne qui n’a rien à voir
avec la raison raisonnante, puisqu’il est toute sa vie à la
recherche de sa mère et apprend à l’issue du Mystère
de la chambre jaune
que le coupable digne de la mort n’est autre que son propre
père!».135
Mais rien ne vaut Londres sous la brume où la campagne anglaise pour
y déposer un cadavre gênant : «Des
millions de romans policiers entre les deux guerres ont ainsi placé
leur crime presque parfait dans la campagne anglaise : un manoir
confortable, des occupants fortunés, souvent oisifs, un détective
dilettante pour lequel l’assassinat est l’un des beaux arts.
Univers insolite, rite immuable, célébration du crime dans un monde
de douairières, de majors des Indes, nourris de scones muffins et
buns (sans oublier le thé, le sherry et le vieux porto). Les
lecteurs populaires de ces romans policiers sont encore légion…».136
C’est dans ces décors que Agatha Christie plantait ses personnages
appelés à une longue existence, Hercule Poirot, détective belge
immigré lors de l’occupation de son pays par les troupes du Kaiser
en 1914 et Miss
Jane Marple. Dès que Poirot et Marple apparaissent sur un lieu, on
est sûr qu'un crime s'y commettra. Qu'ils soient invités à fêter
Noël, qu'ils prennent des vacances sur une île de la Mer Égée  ou
se laissant porter sur le Nil, dans les lieux de fouilles
ar-
ou
se laissant porter sur le Nil, dans les lieux de fouilles
ar-
chéolo-
giques, la mort les suit la peste : «L’at-
mosphè-
re propre à ce que l’on a appelé “l’uni-
vers christien” tient sa magie du délicat dosage entre la quotidienneté tranquille et l’angoisse de mort à travers la découverte du meurtre et son risque de récidive. Angoisse subtile qui ne tire pas son efficacité de faire peur. Les héros christiens ont d’ailleurs rarement peur, seuls les comparses, souvent sacrifiés comme victimes suivantes, éprouvent ce sentiment au moment où ils pressentent la vérité».137 La simplicité avec laquelle étaient composés les romans d’Agatha Christie nous rappellent que le roman policier est propre à la forme de domination totémique. Comme ceux de Conan Doyle, les romans christiens nous racontaient la fin de la domination de la figure du Père, celle des Gérontocrates du tournant du siècle. Le père assassiné, c’est dans la phratrie que le détective Hercule Poirot allait débusquer le ou les assassins. «Si…, Poirot est aussi le représentant d’Agatha Christie elle-même, c’est d’abord une créature œdipienne issue de cette union mathématique entre le père et la fille, qui, loin de défendre la liberté de la fantaisie contre les rigueurs de la logique, s’emploiera contre les idées reçues à les faire aller de pair».138Peut-être était-ce pour cela, malgré ses mariages malheureux, que Poirot l'accompagna sur la plus longue partie de son existence, la romancière le faisant mourir – après avoir commis un meurtre – dans un dernier roman écrit en 1976.
 inquisitrice des temps anciens sans disposer, toutefois, du pouvoir
de juger, de condamner et d’exécuter les criminels. À ce titre,
le curé de paroisse était déjà un personnage de romans
policiers : «Il
surveille et enquête comme un policier le fait ordinairement, se
substitue souvent aux administrateurs de la justice et abuse parfois
de ce pouvoir que lui confère la collaboration presque
inconditionnelle de la justice.
[…] Le
curé enquête, interroge et furète, car tout savoir est une
condition essentielle au contrôle qu’il tente d’exercer sur le
territoire paroissial. Il arrive que le greffier l’informe de
situations qui lui ont échappé, mais c’est plus souvent lui qui
demande, qui dénonce ou qui transmet les détails de désordres
qu’il voudrait faire réprimer. Ici, il s’adresse au greffier
pour connaître les noms de ses paroissiens qui ont payé le
cautionnement d’une prostituée, ou pour avoir copie de la sentence
contre un hôtelier; là, il transmet avec force détails les
agissements de paroissiens en lien avec une maison de prostitution ou
les déplacements d’un prévenu; là encore, il dévoile la
conduite du postillon et du boucher qui livrent du whisky, ou les
divers camouflages d’un débit clandestin d’alcool. Le curé
connaît bien son monde et se permet de conseiller le greffier sur la
manière de faire une arrestation.
[…] En
fait, si le clergé est si bien informé, c’est aussi à cause de
son réseau d’informateurs qu’il encourage en lui prêtant une
oreille attentive. Mais il y a parfois un risque à solliciter le
commérage et la délation, comme l’apprend le curé Pierre Foulay
de Lac-à-la-Tortue qui a soulevé contre lui une partie de la
jeunesse. Un soir, au retour d’une veillée, des jeunes “en fête”
l’invectivent en criant “Hourah pour p’tit Pierre” et
insultent ses informatrices, l’institutrice et une veuve, à qui
ils crient : “Va donc porter les nouvelles au curé
[…] il
est temps de sortir de sous la robe du curé”».130
Mais, pour le Father Brown
inquisitrice des temps anciens sans disposer, toutefois, du pouvoir
de juger, de condamner et d’exécuter les criminels. À ce titre,
le curé de paroisse était déjà un personnage de romans
policiers : «Il
surveille et enquête comme un policier le fait ordinairement, se
substitue souvent aux administrateurs de la justice et abuse parfois
de ce pouvoir que lui confère la collaboration presque
inconditionnelle de la justice.
[…] Le
curé enquête, interroge et furète, car tout savoir est une
condition essentielle au contrôle qu’il tente d’exercer sur le
territoire paroissial. Il arrive que le greffier l’informe de
situations qui lui ont échappé, mais c’est plus souvent lui qui
demande, qui dénonce ou qui transmet les détails de désordres
qu’il voudrait faire réprimer. Ici, il s’adresse au greffier
pour connaître les noms de ses paroissiens qui ont payé le
cautionnement d’une prostituée, ou pour avoir copie de la sentence
contre un hôtelier; là, il transmet avec force détails les
agissements de paroissiens en lien avec une maison de prostitution ou
les déplacements d’un prévenu; là encore, il dévoile la
conduite du postillon et du boucher qui livrent du whisky, ou les
divers camouflages d’un débit clandestin d’alcool. Le curé
connaît bien son monde et se permet de conseiller le greffier sur la
manière de faire une arrestation.
[…] En
fait, si le clergé est si bien informé, c’est aussi à cause de
son réseau d’informateurs qu’il encourage en lui prêtant une
oreille attentive. Mais il y a parfois un risque à solliciter le
commérage et la délation, comme l’apprend le curé Pierre Foulay
de Lac-à-la-Tortue qui a soulevé contre lui une partie de la
jeunesse. Un soir, au retour d’une veillée, des jeunes “en fête”
l’invectivent en criant “Hourah pour p’tit Pierre” et
insultent ses informatrices, l’institutrice et une veuve, à qui
ils crient : “Va donc porter les nouvelles au curé
[…] il
est temps de sortir de sous la robe du curé”».130
Mais, pour le Father Brown  de Chesterton, «l’ex-
de Chesterton, «l’ex-périence du confes-
sionnal ne suffit pas à expli-
quer la sûreté de ses analyses psycho-
logi-
ques. La morale retirée de ses enquêtes, ajoutée à une réticence envers l’Ancien Testament trop obscurci par le surnaturel et au regret de la limitation que l’homme apporte à l’usage de la Raison révèlent le disciple de saint Thomas d’Aquin».131 Fidèle en cela à la tradition cléricale, Father Brown «réprouve la foi aveugle, la superstition scientifique, l’application mécanique - auxquelles peut donner lieu un objet inerte, souillé, déformé ou intact».132 Comme le prêtre, là encore, le détective est un célibataire coriace que l’attrait du beau sexe ne détache pas de sa mission métaphysique : «Sur le plan esthétique, le roman souligne son isolement en le condamnant au célibat. Comme le prêtre catholique, il vit dans cet état d’exception; tout au plus est-il assisté d’une femme de ménage, mais en l’absence de besoins sexuels, elle n’a à s’occuper que du linge, des repas opulents et des valises - si tant est qu’elle existe et qu’un valet ne témoigne avec une insistance encore plus grande de l’absence de tout lien avec les hommes. Car son célibat n’est pas dû aux renoncement pour l’amour de quelque chose de plus élevé : c’est un célibat a priori qui représente la situation de la ratio qui, s’étant
 nommée elle-même critère univer-
nommée elle-même critère univer-sel,
ignore toute accom-
mo
dation. Inhu-
maine sans être divine, reine du royaume que Lask appelle le “no-sensible”, elle est absolument dépourvue du désir et de relation, ni inclinée vers le bas comme la divinité ni tendue vers celle-ci, elle ne se réalise que sous la forme d’un processus qui n’accède jamais à la plénitude. C’est pourquoi le détective est compris comme un neutre qui n’est ni érotique ni non érotique, mais un “Cela” que rien ne saurait affecter et dont le caractère objectal s’explique par l’objectivité d’un intellect que rien ne peut influencer parce qu’il se fonde sur le Néant. Pour que sa personnification devienne saisissable sur le plan esthétique, le roman policier, et notamment son type anglo-saxon, lui donne des traits puritains en faisant d’elle le modèle de l’ascèse intramondaine; l’exercice de celle-ci lui rend le monde indifférent à l’intérieur même du monde et le plonge entièrement dans son affaire».133 Contrairement aux détectives du roman noir d’après la Seconde Guerre mondiale, le détective de l’époque vivait dans un état de chasteté virginal.
Toute la libido était absorbée chez lui par ce goût du mystère, à l’image d’un mystique des temps modernes satisfait de la vision mécaniciste du monde. Tintin, l'éternel adolescent des bandes dessinées de Hergé, était son proche parent. «Last and least, le mystère qui fait courir un Sherlock Holmes s’avère être un fait quelconque qui en soi ne veut rien dire. Dans la plupart des cas, il n’y a pas non plus de conclusion morale, ou seulement de manière accessoire. Lorsque tous les éclaircissements nécessaires pour comprendre l’enchaînement des événements sont donnés, les conséquences du crime pour le criminel sont traités comme des bagatelles; que son destin personnel soit négligé, cela n’est que juste. Mais souvent on n’apprend même pas si le bras de la justice s’est emparé de lui».134 Clairvoyant lorsqu’il s’agissait de résoudre les mystères des autres, il se montrit
 aveugle à sa propre condition :
«Rouletabille
de Leroux, qui “prend la raison par le bon bout” et semble donc
un émule des détectives anglo-saxons, mais avec un esprit
infiniment “Belle Époque française”, patriote, revanchard, ami
des Russes, et dans une situation œdipienne qui n’a rien à voir
avec la raison raisonnante, puisqu’il est toute sa vie à la
recherche de sa mère et apprend à l’issue du Mystère
de la chambre jaune
que le coupable digne de la mort n’est autre que son propre
père!».135
Mais rien ne vaut Londres sous la brume où la campagne anglaise pour
y déposer un cadavre gênant : «Des
millions de romans policiers entre les deux guerres ont ainsi placé
leur crime presque parfait dans la campagne anglaise : un manoir
confortable, des occupants fortunés, souvent oisifs, un détective
dilettante pour lequel l’assassinat est l’un des beaux arts.
Univers insolite, rite immuable, célébration du crime dans un monde
de douairières, de majors des Indes, nourris de scones muffins et
buns (sans oublier le thé, le sherry et le vieux porto). Les
lecteurs populaires de ces romans policiers sont encore légion…».136
C’est dans ces décors que Agatha Christie plantait ses personnages
appelés à une longue existence, Hercule Poirot, détective belge
immigré lors de l’occupation de son pays par les troupes du Kaiser
en 1914 et Miss
Jane Marple. Dès que Poirot et Marple apparaissent sur un lieu, on
est sûr qu'un crime s'y commettra. Qu'ils soient invités à fêter
Noël, qu'ils prennent des vacances sur une île de la Mer Égée
aveugle à sa propre condition :
«Rouletabille
de Leroux, qui “prend la raison par le bon bout” et semble donc
un émule des détectives anglo-saxons, mais avec un esprit
infiniment “Belle Époque française”, patriote, revanchard, ami
des Russes, et dans une situation œdipienne qui n’a rien à voir
avec la raison raisonnante, puisqu’il est toute sa vie à la
recherche de sa mère et apprend à l’issue du Mystère
de la chambre jaune
que le coupable digne de la mort n’est autre que son propre
père!».135
Mais rien ne vaut Londres sous la brume où la campagne anglaise pour
y déposer un cadavre gênant : «Des
millions de romans policiers entre les deux guerres ont ainsi placé
leur crime presque parfait dans la campagne anglaise : un manoir
confortable, des occupants fortunés, souvent oisifs, un détective
dilettante pour lequel l’assassinat est l’un des beaux arts.
Univers insolite, rite immuable, célébration du crime dans un monde
de douairières, de majors des Indes, nourris de scones muffins et
buns (sans oublier le thé, le sherry et le vieux porto). Les
lecteurs populaires de ces romans policiers sont encore légion…».136
C’est dans ces décors que Agatha Christie plantait ses personnages
appelés à une longue existence, Hercule Poirot, détective belge
immigré lors de l’occupation de son pays par les troupes du Kaiser
en 1914 et Miss
Jane Marple. Dès que Poirot et Marple apparaissent sur un lieu, on
est sûr qu'un crime s'y commettra. Qu'ils soient invités à fêter
Noël, qu'ils prennent des vacances sur une île de la Mer Égée  ou
se laissant porter sur le Nil, dans les lieux de fouilles
ar-
ou
se laissant porter sur le Nil, dans les lieux de fouilles
ar-chéolo-
giques, la mort les suit la peste : «L’at-
mosphè-
re propre à ce que l’on a appelé “l’uni-
vers christien” tient sa magie du délicat dosage entre la quotidienneté tranquille et l’angoisse de mort à travers la découverte du meurtre et son risque de récidive. Angoisse subtile qui ne tire pas son efficacité de faire peur. Les héros christiens ont d’ailleurs rarement peur, seuls les comparses, souvent sacrifiés comme victimes suivantes, éprouvent ce sentiment au moment où ils pressentent la vérité».137 La simplicité avec laquelle étaient composés les romans d’Agatha Christie nous rappellent que le roman policier est propre à la forme de domination totémique. Comme ceux de Conan Doyle, les romans christiens nous racontaient la fin de la domination de la figure du Père, celle des Gérontocrates du tournant du siècle. Le père assassiné, c’est dans la phratrie que le détective Hercule Poirot allait débusquer le ou les assassins. «Si…, Poirot est aussi le représentant d’Agatha Christie elle-même, c’est d’abord une créature œdipienne issue de cette union mathématique entre le père et la fille, qui, loin de défendre la liberté de la fantaisie contre les rigueurs de la logique, s’emploiera contre les idées reçues à les faire aller de pair».138Peut-être était-ce pour cela, malgré ses mariages malheureux, que Poirot l'accompagna sur la plus longue partie de son existence, la romancière le faisant mourir – après avoir commis un meurtre – dans un dernier roman écrit en 1976.
LA PRÉDATION MENTALE
Agatha Christie, à la mode de l’époque, voulait composer des romans policiers en appelant à la psychologie de ses meurtriers autant que de son détective, «parce qu’il procède en travaillant sur un ensemble de coupables potentiels, la méthode de Poirot et sa “psychologie” relèvent, en fait, bien souvent, d’une sorte de dynamique de groupe où l’élément d’enfermement et l’angoisse qu’il génère joue un rôle non négligeable. Poirot va de l’un à l’autre, écoute et fait parler les uns sur les autres. Le fait d’être bizarre, un peu ridicule, et de ne pas appartenir à la police officielle lui permet de disposer d’une grande liberté de manœuvre. Les gens ne se méfient pas de lui ou, en tous les cas, le sous-estiment et s’amusent à l’envoyer sur les fausses pistes. Ce faisant, ils trahissent leur attitude intime par rapport à la vérité de l’enquête et c’est précisément ce qu’attend Poirot, qui dispose dès lors d’un élément supplémentaire non prévu dans le plan bien agencé de l’assassin».139 Contrairement à Miss Marple, qui part souvent de l’intuition (féminine) et sert de doublet à Agatha
 Christie qui, par sa bouche, fait dire ce qu’elle
pense (de méchant) de la vieillesse qui la ronge, Poirot est
entièrement hypothético-déductif. Il est même, plus que Holmes
encore, un prédateur mental : «La
lueur verte qui s’allume dans ses yeux de chat lorsqu’il pressent
qu’il est sur la piste montre combien la férocité du pulsionnel
est à l’œuvre dans son désir de savoir».140
Comme un historien, Poirot est un maître de la critique de laquelle
il tire tout son génie mystificateur : «Chesterton
fait dire à Aristide Valentin, chef de la police parisienne, peu
avant la première apparition du Père Brown : “Le criminel est un
artiste créateur; le détective n’est qu’un critique”
(la
Croix bleue)».141
Parce que les crimes christiens sont souvent cruels à défaut d’être
horrifiants – le poison est l’outil préféré d’Agatha
Christie qui s’y connaissait moins en armes de poing; l’arme
blanche est utilisée surtout dans les crimes sanglants comme dans
L’express
de Plymouth et
surtout Le
crime de l’Orient-Express -,
l’auteur ne pouvait s’en tenir à des déductions banales.
Toutefois, cette critique restait strictement psychologique, elle ne
débordait jamais sur la dimension sociale du crime, même si la
conclusion implicite finissait toujours par s’en remettre à la
misère des riches dévorés
par leur cupidité. Pour Siegfried Kracauer, «ce
n’est que dans les romans de Frank Heller que le détective est
compris et apprécié comme critique social de premier ordre et dont
la critique se traduit dans les actes. Dans ces romans, dont
l’atmosphère raréfiée et l’ironie sereine et courtoise font
penser à Anatole France, M. Philipp Collin, alias professeur
Pelotard, s’acquitte de la tâche morale d’agiter une société
corrompue par ses irrégularités; c’est un hérétique de salon
qui s’élève contre la légalité. S’il empoche des biens
d’autrui à des fins personnelles, c’est que ceux-ci étaient
volés, et il s’écarte de la vérité, ce n’est que pour duper
les fraudeurs légaux. C’est encore la ratio
qui se montre dans ces escroqueries, car c’est elle qui conditionne
toute l’agitation sociale. Mais ses intentions visent manifestement
plus haut, et seule sa domination sur la totalité empêche les
sphères supérieures de régner elles-mêmes sur la totalité».142
Les problématiques sociales étaient donc exclues des romans
policiers. Si la domination totémique s’effondrait, c’était à
cause des dysfonctions psychologiques intérieures seules, d’où
que Poirot par exemple, se sent obligé d'assurer contre les
criminels la légitimité du régime démocratique et libéral.
Christie qui, par sa bouche, fait dire ce qu’elle
pense (de méchant) de la vieillesse qui la ronge, Poirot est
entièrement hypothético-déductif. Il est même, plus que Holmes
encore, un prédateur mental : «La
lueur verte qui s’allume dans ses yeux de chat lorsqu’il pressent
qu’il est sur la piste montre combien la férocité du pulsionnel
est à l’œuvre dans son désir de savoir».140
Comme un historien, Poirot est un maître de la critique de laquelle
il tire tout son génie mystificateur : «Chesterton
fait dire à Aristide Valentin, chef de la police parisienne, peu
avant la première apparition du Père Brown : “Le criminel est un
artiste créateur; le détective n’est qu’un critique”
(la
Croix bleue)».141
Parce que les crimes christiens sont souvent cruels à défaut d’être
horrifiants – le poison est l’outil préféré d’Agatha
Christie qui s’y connaissait moins en armes de poing; l’arme
blanche est utilisée surtout dans les crimes sanglants comme dans
L’express
de Plymouth et
surtout Le
crime de l’Orient-Express -,
l’auteur ne pouvait s’en tenir à des déductions banales.
Toutefois, cette critique restait strictement psychologique, elle ne
débordait jamais sur la dimension sociale du crime, même si la
conclusion implicite finissait toujours par s’en remettre à la
misère des riches dévorés
par leur cupidité. Pour Siegfried Kracauer, «ce
n’est que dans les romans de Frank Heller que le détective est
compris et apprécié comme critique social de premier ordre et dont
la critique se traduit dans les actes. Dans ces romans, dont
l’atmosphère raréfiée et l’ironie sereine et courtoise font
penser à Anatole France, M. Philipp Collin, alias professeur
Pelotard, s’acquitte de la tâche morale d’agiter une société
corrompue par ses irrégularités; c’est un hérétique de salon
qui s’élève contre la légalité. S’il empoche des biens
d’autrui à des fins personnelles, c’est que ceux-ci étaient
volés, et il s’écarte de la vérité, ce n’est que pour duper
les fraudeurs légaux. C’est encore la ratio
qui se montre dans ces escroqueries, car c’est elle qui conditionne
toute l’agitation sociale. Mais ses intentions visent manifestement
plus haut, et seule sa domination sur la totalité empêche les
sphères supérieures de régner elles-mêmes sur la totalité».142
Les problématiques sociales étaient donc exclues des romans
policiers. Si la domination totémique s’effondrait, c’était à
cause des dysfonctions psychologiques intérieures seules, d’où
que Poirot par exemple, se sent obligé d'assurer contre les
criminels la légitimité du régime démocratique et libéral.
Pour
cette raison sans doute – celle d’un genre littéraire trop
rattaché à défendre l’individualisme, la liberté et la
démocratie -, les régimes totalitaires rejetèrent le roman
policier jusqu’à une période très récente : «C’est
un fait, certes, très curieux : le roman policier, dans les années
qui ont précédé la guerre, a été prohibé en Allemagne et en
Italie. En U.R.S.S., il a toujours été considéré comme un produit
de la civilisation bourgeoise. Et l’on voit bien pourquoi il est
incompatible avec un socialisme scientifique, car l’ordre qu’il
se propose de rétablir, grâce à l’explication déductive, est
l’ordre logique, celui des justifications courtes qui se réfèrent,
en dernière analyse, à la nature des choses.
[…] Mais
pourquoi le fascisme a-t-il condamné la littérature policière? La
réponse est simple : c’est qu’il fonde le droit sur la force et
non sur la morale. Un texte de Nicholas Blake est, à ce point de
vue, tout à fait éclairant : “La civilisation démocratique ne
nous encourage pas à nous laisser aller à notre INSTINCT
DE CRUAUTÉ.
L’attitude toute différente des dictatures, à cet égard, aussi
bien que sur leur conception différente de la justice et de la
preuve légale doit expliquer pourquoi elles ont interdit le roman
policier, considéré comme la marque du pur libéralisme” (The
Art of the Mystery Story)».143
Comme tout autre genre littéraire, le roman policier ne pouvait
rester à l’écart de l’évolution de la littérature dans son
ensemble. «Après
la Première Guerre mondiale, dans le sillage de Marcel Proust et
André Gide, c’est le triomphe du roman  psychologique. L’ambition
des auteurs du roman policier est de transpo-
psychologique. L’ambition
des auteurs du roman policier est de transpo-
ser dans un genre mineur l’univers du roman bour-
geois. Le crime flâne avec élégance dans les châteaux ou tout autre salon de moindre dimension. Le meurtre devient un art dont la critique échappe à la police officielle renvoyée à ses tâches administratives, à la surveillance de la circulation, à la protection des bonnes mœurs. Le roman policier, devenu la récréation du roman psychologique ou divertissement cérébral, prend l’allure d’un puzzle brouillé que rétablit, par pur dilettantisme, un enquêteur génial ou distingué mais toujours pontifiant. C’est le règne du “roman-problème” dont le pont aux ânes est le crime en local clos».144 Le roman-problème, on l’a vu, était né bien avant, dès que des auteurs comme Poe et Doyle prétendirent à la méthode empirique et à la déduction logique. Le nouveau problème posé en était un strictement psychologique, à la manière des héros d’Agatha Christie. Mais ce ne fut pas elle qui éleva ce genre à son plus haut niveau. C’est à un romancier belge, Georges Simenon (1903-1989) que revint le génie d'élever le roman policier au rang du réalisme issu de Balzac et de Céline.
 psychologique. L’ambition
des auteurs du roman policier est de transpo-
psychologique. L’ambition
des auteurs du roman policier est de transpo-ser dans un genre mineur l’univers du roman bour-
geois. Le crime flâne avec élégance dans les châteaux ou tout autre salon de moindre dimension. Le meurtre devient un art dont la critique échappe à la police officielle renvoyée à ses tâches administratives, à la surveillance de la circulation, à la protection des bonnes mœurs. Le roman policier, devenu la récréation du roman psychologique ou divertissement cérébral, prend l’allure d’un puzzle brouillé que rétablit, par pur dilettantisme, un enquêteur génial ou distingué mais toujours pontifiant. C’est le règne du “roman-problème” dont le pont aux ânes est le crime en local clos».144 Le roman-problème, on l’a vu, était né bien avant, dès que des auteurs comme Poe et Doyle prétendirent à la méthode empirique et à la déduction logique. Le nouveau problème posé en était un strictement psychologique, à la manière des héros d’Agatha Christie. Mais ce ne fut pas elle qui éleva ce genre à son plus haut niveau. C’est à un romancier belge, Georges Simenon (1903-1989) que revint le génie d'élever le roman policier au rang du réalisme issu de Balzac et de Céline.
C’est
peut-être parce que Simenon ne recourait à aucun des lieux communs
du roman policier traditionnel qu’il transforma et améliora le
genre. «J’ai
un faible pour les “Maigret”. Le commissaire n’est flanqué ni
d’un ami narrateur ni d’un faire-valoir borné - finis les
couples de comédie. Maigret  semble porter sur ses épaules la
laideur et la douleur du monde. Il confesse les gens plus qu’il
n’en obtient des aveux. Jeune, il rêvait d’une profession
idéale. “Il ne l’avait dit à personne, n’avait jamais
prononcé les deux mots à voix haute, fût-ce pour lui-même : il
aurait voulu être un raccommodeur de destinées”. Son meilleur ami
n’est-il pas médecin? Ne s’appelle-t-il pas le docteur Pardon?
Le balancier est revenu vers autrui, vers le “nous”, la vie
ensemble».145
Cherchant moins à apaiser les angoisses par une mystification
heureuse appuyée sur l’ordre hypothético-déductif; moins porté
également à prêcher le salut de la domination totémique, chez
Simenon, c’était le monde du type de domination charismatique qui
était cliniquement
traité
par le romancier. La phratrie démocratique souffrait-elle de maux
quasi insolubles socialement? C’est en chacun de ses membres qu’il
fallait déraciner les causes de la souffrance – entendons les
névroses – et le criminel n’était plus séparé du groupe par
sa transgression qui pourrait être celle de chacun de ses frères et
sœurs : «Simenon
croyait que chaque homme avait en lui un coin d’ombre dont il avait
plus ou moins honte : ses livres étaient destinés à montrer au
lecteur qu’il n’était pas seul, que les autres souffraient des
mêmes tourments intérieurs et que l’on pouvait être aimé et
même réussir, malgré tout. Simenon s’identifiait au criminel qui
cherche à retrouver sa propre estime et soutient qu’aucune
humiliation n’est plus intolérable que celle de se sentir rejeté
de sa propre communauté. Son détective n’était donc pas un
policier, mais un “ravaudeur de destinées”. Ses solutions
étaient masculines; il pensait que l’amour paternel était plus
fort que l’amour maternel et même que beaucoup de femmes ne
savaient pas ce qu’était l’amour maternel : le plus souvent, les
semble porter sur ses épaules la
laideur et la douleur du monde. Il confesse les gens plus qu’il
n’en obtient des aveux. Jeune, il rêvait d’une profession
idéale. “Il ne l’avait dit à personne, n’avait jamais
prononcé les deux mots à voix haute, fût-ce pour lui-même : il
aurait voulu être un raccommodeur de destinées”. Son meilleur ami
n’est-il pas médecin? Ne s’appelle-t-il pas le docteur Pardon?
Le balancier est revenu vers autrui, vers le “nous”, la vie
ensemble».145
Cherchant moins à apaiser les angoisses par une mystification
heureuse appuyée sur l’ordre hypothético-déductif; moins porté
également à prêcher le salut de la domination totémique, chez
Simenon, c’était le monde du type de domination charismatique qui
était cliniquement
traité
par le romancier. La phratrie démocratique souffrait-elle de maux
quasi insolubles socialement? C’est en chacun de ses membres qu’il
fallait déraciner les causes de la souffrance – entendons les
névroses – et le criminel n’était plus séparé du groupe par
sa transgression qui pourrait être celle de chacun de ses frères et
sœurs : «Simenon
croyait que chaque homme avait en lui un coin d’ombre dont il avait
plus ou moins honte : ses livres étaient destinés à montrer au
lecteur qu’il n’était pas seul, que les autres souffraient des
mêmes tourments intérieurs et que l’on pouvait être aimé et
même réussir, malgré tout. Simenon s’identifiait au criminel qui
cherche à retrouver sa propre estime et soutient qu’aucune
humiliation n’est plus intolérable que celle de se sentir rejeté
de sa propre communauté. Son détective n’était donc pas un
policier, mais un “ravaudeur de destinées”. Ses solutions
étaient masculines; il pensait que l’amour paternel était plus
fort que l’amour maternel et même que beaucoup de femmes ne
savaient pas ce qu’était l’amour maternel : le plus souvent, les
 femmes étaient décrites comme des en-
femmes étaient décrites comme des en-
nemies; il disait qu’il préférait les appeler des “fe-
melles”. Obser-
vateur attentif à l’extrême des milieux modestes de la société, il voulut en plus expliquer leur comportement».146 À la fin de sa vie, Simenon fut accusé d’inceste qui aurait poussé sa fille au suicide. C’était un drame profondément simenonien qui se révélait là. En tant que roman psychologique, le roman policier atteignit le niveau des grands romans de l’époque. Il atteignait sa pleine maturité. Ce n’est pas pour rien que «Freud, à la fin de sa vie, lisait beaucoup de romans policiers, dont ceux d’Agatha Christie. Paula Fichtl, la fidèle gouvernante, se souvient que : “En matière de romans policiers, Freud choisit surtout des auteurs anglais, comme G. K. Chesterton, Agatha Christie et Dorothy Sayers : ‘Monsieur le professeur savait presque toujours qui était le meurtrier, mais s’il s’agissait tout de même de quelqu’un d’autre, cela l’irritait.’ Freud détective amateur lit très vite : il lui faut rarement plus d’une soirée pour un livre. S’il n’y parvenait pas, la femme de chambre devait veiller, le lendemain, en faisant le ménage, à ne pas égarer la marque de Freud. ‘Les romans policiers se trouvaient toujours sur sa table de nuit. Le professeur glissait toujours ses bouts d’allumette entre les pages’”».147 Il n’y reconnaissait sans doute pas là des romans psychanalytiques, mais il jouissait sans doute à vouloir prendre le détective de vitesse. Il pouvait encore découvrir les motivations profondes des actants du drame. S’il s’en servait, à la manière de Nicolas II ou de Maurras, comme moyen d’exorciser son angoisse de la mort, du fond de sa vision tragique, il se voyait confirmé qu’à travers les romans policiers, «l’enquêteur en vient rapidement à l’idée que non seulement la disparition de la victime ne chagrine personne, à quelques rares exceptions près, mais que celui qui a agi n’a fait que traduire une volonté largement partagée».148 Et qu’il fallait se résigner à ce sort⌛
NOTES
 semble porter sur ses épaules la
laideur et la douleur du monde. Il confesse les gens plus qu’il
n’en obtient des aveux. Jeune, il rêvait d’une profession
idéale. “Il ne l’avait dit à personne, n’avait jamais
prononcé les deux mots à voix haute, fût-ce pour lui-même : il
aurait voulu être un raccommodeur de destinées”. Son meilleur ami
n’est-il pas médecin? Ne s’appelle-t-il pas le docteur Pardon?
Le balancier est revenu vers autrui, vers le “nous”, la vie
ensemble».145
Cherchant moins à apaiser les angoisses par une mystification
heureuse appuyée sur l’ordre hypothético-déductif; moins porté
également à prêcher le salut de la domination totémique, chez
Simenon, c’était le monde du type de domination charismatique qui
était cliniquement
traité
par le romancier. La phratrie démocratique souffrait-elle de maux
quasi insolubles socialement? C’est en chacun de ses membres qu’il
fallait déraciner les causes de la souffrance – entendons les
névroses – et le criminel n’était plus séparé du groupe par
sa transgression qui pourrait être celle de chacun de ses frères et
sœurs : «Simenon
croyait que chaque homme avait en lui un coin d’ombre dont il avait
plus ou moins honte : ses livres étaient destinés à montrer au
lecteur qu’il n’était pas seul, que les autres souffraient des
mêmes tourments intérieurs et que l’on pouvait être aimé et
même réussir, malgré tout. Simenon s’identifiait au criminel qui
cherche à retrouver sa propre estime et soutient qu’aucune
humiliation n’est plus intolérable que celle de se sentir rejeté
de sa propre communauté. Son détective n’était donc pas un
policier, mais un “ravaudeur de destinées”. Ses solutions
étaient masculines; il pensait que l’amour paternel était plus
fort que l’amour maternel et même que beaucoup de femmes ne
savaient pas ce qu’était l’amour maternel : le plus souvent, les
semble porter sur ses épaules la
laideur et la douleur du monde. Il confesse les gens plus qu’il
n’en obtient des aveux. Jeune, il rêvait d’une profession
idéale. “Il ne l’avait dit à personne, n’avait jamais
prononcé les deux mots à voix haute, fût-ce pour lui-même : il
aurait voulu être un raccommodeur de destinées”. Son meilleur ami
n’est-il pas médecin? Ne s’appelle-t-il pas le docteur Pardon?
Le balancier est revenu vers autrui, vers le “nous”, la vie
ensemble».145
Cherchant moins à apaiser les angoisses par une mystification
heureuse appuyée sur l’ordre hypothético-déductif; moins porté
également à prêcher le salut de la domination totémique, chez
Simenon, c’était le monde du type de domination charismatique qui
était cliniquement
traité
par le romancier. La phratrie démocratique souffrait-elle de maux
quasi insolubles socialement? C’est en chacun de ses membres qu’il
fallait déraciner les causes de la souffrance – entendons les
névroses – et le criminel n’était plus séparé du groupe par
sa transgression qui pourrait être celle de chacun de ses frères et
sœurs : «Simenon
croyait que chaque homme avait en lui un coin d’ombre dont il avait
plus ou moins honte : ses livres étaient destinés à montrer au
lecteur qu’il n’était pas seul, que les autres souffraient des
mêmes tourments intérieurs et que l’on pouvait être aimé et
même réussir, malgré tout. Simenon s’identifiait au criminel qui
cherche à retrouver sa propre estime et soutient qu’aucune
humiliation n’est plus intolérable que celle de se sentir rejeté
de sa propre communauté. Son détective n’était donc pas un
policier, mais un “ravaudeur de destinées”. Ses solutions
étaient masculines; il pensait que l’amour paternel était plus
fort que l’amour maternel et même que beaucoup de femmes ne
savaient pas ce qu’était l’amour maternel : le plus souvent, les
 femmes étaient décrites comme des en-
femmes étaient décrites comme des en-nemies; il disait qu’il préférait les appeler des “fe-
melles”. Obser-
vateur attentif à l’extrême des milieux modestes de la société, il voulut en plus expliquer leur comportement».146 À la fin de sa vie, Simenon fut accusé d’inceste qui aurait poussé sa fille au suicide. C’était un drame profondément simenonien qui se révélait là. En tant que roman psychologique, le roman policier atteignit le niveau des grands romans de l’époque. Il atteignait sa pleine maturité. Ce n’est pas pour rien que «Freud, à la fin de sa vie, lisait beaucoup de romans policiers, dont ceux d’Agatha Christie. Paula Fichtl, la fidèle gouvernante, se souvient que : “En matière de romans policiers, Freud choisit surtout des auteurs anglais, comme G. K. Chesterton, Agatha Christie et Dorothy Sayers : ‘Monsieur le professeur savait presque toujours qui était le meurtrier, mais s’il s’agissait tout de même de quelqu’un d’autre, cela l’irritait.’ Freud détective amateur lit très vite : il lui faut rarement plus d’une soirée pour un livre. S’il n’y parvenait pas, la femme de chambre devait veiller, le lendemain, en faisant le ménage, à ne pas égarer la marque de Freud. ‘Les romans policiers se trouvaient toujours sur sa table de nuit. Le professeur glissait toujours ses bouts d’allumette entre les pages’”».147 Il n’y reconnaissait sans doute pas là des romans psychanalytiques, mais il jouissait sans doute à vouloir prendre le détective de vitesse. Il pouvait encore découvrir les motivations profondes des actants du drame. S’il s’en servait, à la manière de Nicolas II ou de Maurras, comme moyen d’exorciser son angoisse de la mort, du fond de sa vision tragique, il se voyait confirmé qu’à travers les romans policiers, «l’enquêteur en vient rapidement à l’idée que non seulement la disparition de la victime ne chagrine personne, à quelques rares exceptions près, mais que celui qui a agi n’a fait que traduire une volonté largement partagée».148 Et qu’il fallait se résigner à ce sort⌛
NOTES
1
T. Zeldin. Histoire des passions françaises, t. 3 : Goût
et corruptions, Paris, Seuil,
Col. Points-Histoire, # H53, 1981, p. 40.
2
«Les Romains appelaient fascinus ce que les Grecs nommaient
phallos. Du sexe masculin dressé, c'est-à-dire du fascinus, dérive
le mot de fascination, c'est-à-dire la pétrification qui s'empare
des animaux et des hommes devant une angoisse insoutenable. Les
fascia désignent le bandeau qui entourait les seins des femmes. Les
fascies sont les faisceaux de soldats qui précédaient les
Triomphes des imperator. De là découle également le mot fascisme,
qui traduit cette esthétique de l'effroi et de la fascination».
Pascal Quinard, Gallimard.
3
T. Zeldin. ibid. pp. 41-42.
4
T. Narcejac. Une machine à lire : le roman policier, Paris,
Denoël/Gonthier, Col. Médiations, # 124, 1975, pp. 31-32.
5
R. Rumilly. Histoire de la province de Québec, t. IX :
Marchand, Montréal, Bernard Valiquette, s.d., p. 106.
6
J. Thorwald. L’heure du détective, Paris,
Albin Michel, 1969, p. 181.
7
M.-C. Bancquart. Paris “Belle Époque” par ses écrivains,
Paris, Éditions Adam Birot,
1997, p. 52.
8
Boileau-Narcejac. Le roman policier, Paris,
P.U.F., Col. Que sais-je?, # 1623, 1975, p. 15.
9
M. Angenot. 1889, un état du discours social, Montréal,
Balzac, Col. L'univers du discours, 1989, p. 639.
10
D. Tarizzo. L’Anarchie, Paris,
Seghers, 1978, p. 207.
11
M. Foucault. Surveiller et punir, Paris,
Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1975, p. 72.
12
John Carter, in Boileau-Narcejac. Op. cit. p. 24.
13
P. Accoce & P. Bentchnick. Ces malades qui nous gouvernent,
Paris, Stock, réed. Livre de
poche # 5092, 1976, pp. 13-14.
14
S. Kracauer. De Caligari à Hitler, Paris,
Flammarion, Col. Champs, # 506, 1987, p. 253.
15
J. Thorwald. Op. cit. p. 176.
16
Boileau-Narcejac. Op. cit. pp. 6 et 5.
17
F. Lacassin. Mythologie du roman policier, t. 1, Paris,
U.G.É., col. 10/18, # 867, 1974, pp. 16-17.
18
A. Hitchcock. «Préface» à E. A. Poe. Histoires
extraordinaires, Paris,
Gallimard, réed. Livre de poche, Col. Classique, # 604-605, 1960,
p. 7
19
T. Narcejac. Op. cit. p. 28.
20
Boileau-Narcejac. Op. cit. p. 33.
21
J. Dupuy. Le roman policier, Paris,
Larousse, Col. Textes pour aujourd’hui, 1974, p. 18.
22
J. Cabau. Edgar Poe par lui-même, Paris,
Seuil, Col. Écrivains de toujours, # 49, 1960, pp. 53-55.
23
J. Cabau. Ibid, pp. 51, 52 et 53.
24
H. Justin. Avec Poe jusqu’au bout de la prose, Paris,
Gallimard, Col. Bibliothèque des Idées, 2009, pp. 198-199.
25
J. Thorwald. Op. cit. p. 176.
26
C. Leatherdale. Dracula : Du mythe au réel, Paris,
Dervy, 1998, pp. 64-65.
27
F. Lacassin. Op. cit. pp. 164-165.
28
H. Rosenberg. La tradition du nouveau, Paris,
Minuit, Col. Arguments, 1962, p. 261.
29
T. Narcejac. Op. cit. p. 159.
30
T. Narcejac. Op. cit. p. 168.
31
F. Lacassin. Op. cit. p. 15.
32
A.-M. Thiesse. Le roman au quotidien, Paris,
Seuil, Col. Points-Histoire, # 277, 2000, pp. 170-171.
33
E. J. Hobsbawm. L’âge des extrêmes, Bruxelles,
Complexe/Le Monde diplomatique, 1994, p. 258.
34
S. Mijolla-Mellor. Meurtre familier, Paris,
Dunod, 1995, p. ix.
35
S. Mijolla-Mellor. Ibid. p. 23, n. 1.
36
E. Traverso. La violence nazie, une généalogie européenne,
Paris, La Fabrique, 2002, p. 162.
37
S. Kracauer. Le roman policier, Paris, Payot, Col. P.B.P., #
410, 2001, p. 20.
38
P. Leprohon. Cinquante ans de cinéma français, Paris,
Cerf, Col. 7e Art, 1954, p. 20.
39
Cité in G. Guillot. Les Prévert, Paris,
Seghers, Col. Cinéma d’aujourd’hui, # 47, 1967, pp.
14-15.
40
G. Guillot. Ibid. p. 15.
41
U. M. Schneede. Surrealism, New
York, H. N. Abrams, 1973, p. 104.
42
U. M. Schneede. Ibid. p. 104.
43
Cf. J.-P. Coupal. La Préhistoire oubliée précédée d’un
Petit traité de philosophie de l’histoire, Montréal, Marc
Collin éditeur.
44
P. Gay. La culture de la haine, Paris,
Plon, 1997, pp. 56-57.
45
T. Narcejac. Op. cit. pp. 21-22.
46
T. Narcejac. Ibid. p. 32.
47
T. Narcejac. Ibid. pp. 20-21.
48
C. Leatherdale. op. cit.
p. 244.
49
T. Narcejac. Op. cit. p. 51.
50
S. Rochlitz. Avant-propos à S. Kracauer. Op. cit. 2001, pp. 22-23.
51
J. Dupuy. Op. cit. p. 53.
52
M. Chastaing. «Le roman policier “classique”», in P. Gamarra
(éd.) La fiction policière, Paris,
Europe # 571-572, 1976, . 45.
53
M. Chastaing. «Le roman policier “classique”», in P. Gamarra
(éd.) ibid. pp. 45-46.
54
T. Narcejac. Op. cit. p. 200.
55
Cité in Boileau-Narcejac. Op. cit. p. 51.
56
T. Narcejac. Op. cit. pp. 87-88.
57
F. Lacassin. Op. cit. pp. 77-78.
58
S. Mijolla-Mellor. Op. cit. p. 1.
59
R. Rochlitz. Avant-propos in S. Kracauer. Op. cit. 2001, p. 22.
60
J. Dupuy. Op. cit. p. 125.
61
H. Arendt. Le système totalitaire, Paris,
Seuil, Col. Points, # 307, 1972, p. 209.
62
T. Narcejac. Op. cit. p. 112.
63
J. Dupuy. Op. cit. p. 53.
64
T. Maerli. «Travailler sur Ibsen»,
in Europe Henrik Ibsen, Paris,
Europe # 840, 1999, pp. 151-152
65
P. Lidsky. Les écrivains contre la Commune, Paris,
La Découverte, Col. Fondations, 1982, p. 47.
66
P. Lidsky. Ibid. p. 50.
67
G. Markow-Totevy. Henry James, Paris,
Presses Universitaires, Col. Classiques du XXe siècle, # 31, 1958,
p. 12.
68
H. Justin. Op. cit. pp. 199-200.
69
J. Attali. Chemins de sagesse, Paris,
Fayard, réed. Livre de poche, # 14547, 1996, p. 99.
70
F. Lacassin. Op. cit. pp. 79-80.
71
F. Lacassin. Ibid. p. 81.
72
F. Lacassin. Ibid. p. 113.
73
S. Mijolla-Mellor. Op. cit. p. 5.
74
S. Mijolla-Mellor. Ibid. p. 145.
75
S. Mijolla-Mellor. Ibid. p. 14.
76
S. Mijolla-Mellor. Ibid. pp. 21 et 22.
77
F. Lacassin. Mythologie du roman policier, t. 2, Paris,
U.G.É., col. 10/18, # 868, 1974, p. 10.
78
F. Lacassin. Ibid. pp. 14-15.
79
W. Benjamin. Essais, t. 2 : 1935-1940, Paris,
Denoël/Gonthier, Col. Médiations, # 241, 1983, p. 47.
80
R. Rochlitz. Avant porpos à S. Kracauer. Op. cit. 2001, pp. 13-14.
81
D. Laporte. Histoire de la merde,
Paris, Christian Bourgois, 2003, p. 49.
82
L. Côté. En garde!, Québec, P.U.L., Col. Intercultures,
2000, p. 61.
83
T. Zeldin. Histoire des passions françaises, t. 5 : Anxiété
et hypocrisie, Paris, Seuil,
Col. Points-Histoire, # H55, 1981, p. 162.
84
P. Sloterdijk. Critique de la raison cynique, Paris,
Christian Bourgois, 1987, pp. 380-381.
85
Cité in M. Chastaing. «Le roman policier “classique”», in P.
Gamarra (éd). op. cit. p. 32.
86
M. Chastaing. «Le roman policier “classique”», in P. Gamarra
(éd). ibid. p. 36.
87
R. Rumilly. Histoire de la province de Québec, t. XI :
S.-N. Parent, Montréal,
Bernard Valiquette, s.d., p. 102.
88
J. Thorwald. La grande aventure de la criminologie, t. 1 :
enquête et poisons, Paris,
Flammarion, Col. J’ai lu Documents, # D 24, 1973, p. 132.
89
J. Thorwald. Op. cit. 1969 p. 178.
90
Boileau-Narcejac. Op. cit. pp. 14-15.
91
S. Luzzatto. Le corps du Duce, Paris, Gallimard, Col. Essais,
2014, p. 164. * Ventennio désigne la période des vingt
années du régime de Mussolini (1922-1943).
92
T. Narcejac. Op. cit. p. 192.
93
C. Clay. Le roi, l’empereur et le tsar, Paris,
Perrin, Col. Tempus, #238, 2007, p. 473.
94
E. Weber. L’Action française, Paris,
Fayard, 1985, p. 23.
95
S. de Mijolla-Mellor. Op. cit. p. 142.
96
M. Vovelle. La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris,
Gallimard, Col. Bibliothèque des histoires, 1983, pp.
655-656.
97
W. Reich. Psychologie de masse du fascisme, Paris,
Payot, Col. P.B.P., # 244, 1970, p. 133.
98
Boileau-Narcejac. Op. cit. p. 8.
99
Boileau-Narcejac. Ibid. pp. 9 et 10.
100
Boileau-Narcejac. Ibid. p. 11.
101
Boileau-Narcejac. Ibid. pp. 22-23.
102
J. Thorwald. Op. cit. 1969 p. 9.
103
E. A. Poe. Histoires grotesques et sérieuses, Paris,
Gallimard, réed. Livre de poche, Col. Classique, # 2173, 1967, p.
233.
104
Boileau-Narcejac. Op. cit. p. 121.
105
Boileau-Narcejac. Ibid. p. 27-28.
106
Cité in T. Narcejac. Op. cit. p. 54.
107
T. Narcejac. Ibid. pp. 83-84.
108
Boileau-Narcejac. Op. cit. p. 23.
109
S. Mijolla-Mellor. Op. cit. p. viii.
110
S. Mijolla-Mellor. Ibid. pp. 124-125.
111
S. Kracauer. op. cit. 2001,
p. 67.
112
S. Kracauer. Ibid. pp. 95-97.
113
S. Kracauer. Ibid. p. 207.
114
R. Rochlitz. Avant propos à S. Kracauer. Ibid. pp. 21-22.
115
S. Kracauer. Ibid. p. 52.
116
S. Kracauer. Ibid. p. 53.
117
F. Lacassin. Op. cit. t. 1, p. 18.
118
A. Faivre, in A. Faivre (éd.) Littérature fantastique, Paris,
Dervy, 1989, p. 31.
119
Cité in S. Sontag. Sur la photographie, Paris,
Christian Bourgois, Col. Titres, # 88, 2008, p. 250.
120
S. Mijolla-Mellor. Op. cit. p. 158 et n. 2.
121
F. Lacassin. Op. cit. t. 1, p. 208.
122
U. Eco. De superman au surhomme, Paris,
Grasset, réed. Livre de poche, Col. Biblio-essais, # 1978, 1995, p.
158.
123
S. Mijolla-Mellor. Op. cit. pp. 22-23.
124
R. Rochlitz. Avant propos à S. Kracauer. Op. cit. 2001, p. 21.
125
T. Narcejac. Op. cit. p. 213.
126
T. Narcejac. Ibid. pp. 217, 221 et 222.
127
F. Rivière. «La fiction policière ou le meurtre du roman», in P.
Gamarra (éd.) op. cit. p. 21.
128
T. Narcejac. Op. cit. p. 130.
129
A.-M. Thiesse. Le roman au quotidien, Paris,
Seuil, Col. Points-Histoire, # H277, 2000, p. 157.
130
R. Hardy. Contrôle social et mutation de la culture religieuse
au Québec, Montréal, Boréal,
1999, pp. 182-183.
131
F. Lacassin. Op. cit. t. 1, p. 165.
132
F. Lacassin. Ibid. p. 214.
133
S. Kracauer. Op. cit. 2001, pp. 103-104.
134
S. Kracauer. Ibid. pp. 193-194.
135
M.-C. Banquart. Op. cit. p. 55.
136
J. Dupuy. Op. cit. p. 39.
137
S. Mijolla-Mellor. Op. cit. p. vii.
138
S. Mijolla-Mellor. Ibid. p. 10.
139
S. Mijolla-Mellor. Ibid. p. 126.
140
S. Mijolla-Mellor. Ibid. p. 141.
141
F. Lacassin. Op. cit. t. 1, p. 180.
142
S. Kracauer. Op. cit. 2001, p. 153.
143
T. Narcejac. Op. cit. pp. 205-206.
144
F. Lacassin. Op. cit. t. 2, p. 6.
145
H. Justin. Op. cit. p. 384.
146
T. Zeldin. op. cit. t. 3, pp. 43-44.
147
Citée in S. Mijola-Mellor. Op. cit. p. 197.
148
S. Mijola-Mellor. Ibid. p. 52.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire